Porca miseria. Le titre de l’ouvrage de Tonino Benacquista (« cochonnerie de misère » en traduction littérale) reprend le juron que proférait son père quand il était confronté à une difficulté quelconque et surtout lorsque le soir, ivre, il se heurtait aux portes de la maison familiale. Une fois ce père alcoolique effondré dans son lit, « un semblant de gaîté s’invit[ait] à table » écrit l’auteur, qui ajoute un peu plus loin : « à la nuit tombée, nous ressembl[i]ons à une famille ».
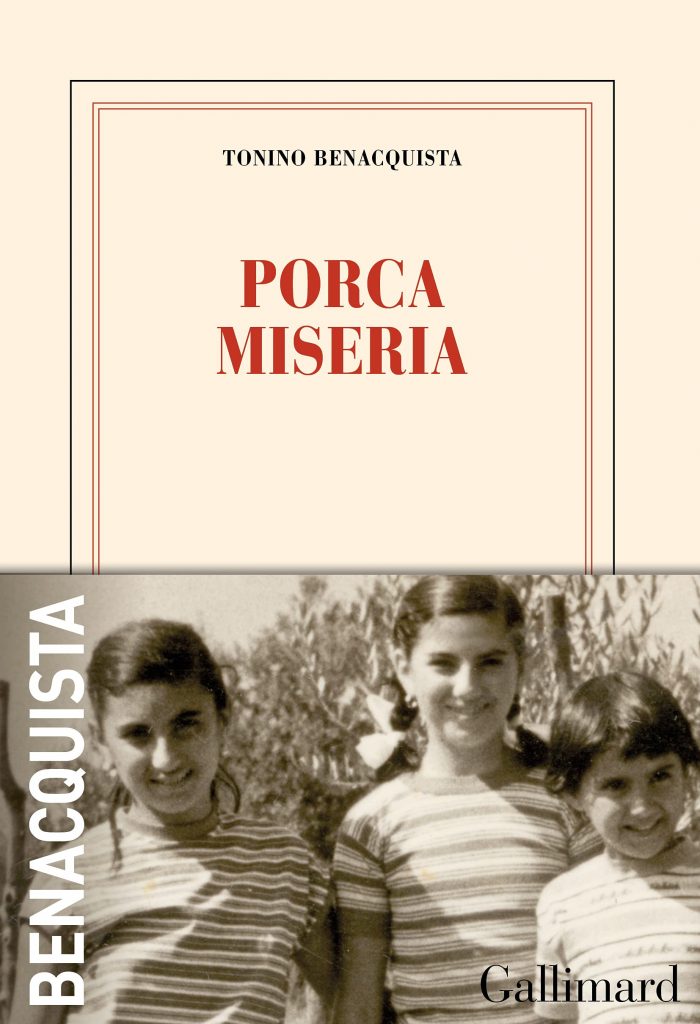
Auteur de romans policiers, de nouvelles, de scénarios de bandes dessinées et de films, Tonino Benacquista livre ici un texte autobiographique, à la fois mémoires personnels et roman familial, occasion pour lui de s’interroger sur son rapport au récit littéraire. En retraçant son parcours par lequel il a embrassé la féconde carrière d’écrivain que l’on connaît, il souligne combien son rapport à la littérature fut compliqué. Car chez lui l’écriture est venue avant le goût de la lecture.
Un cheminement vers la littérature semé d’obstacles
Les obstacles ayant jalonné ce cheminement vers la littérature furent nombreux. Ses parents, Elena et Cesare, ont quitté l’Italie pour s’installer en France en 1954. Ils étaient originaires du Latium, d’un village situé approximativement entre Rome et Naples. Installés dans la couronne sud de Paris à Vitry-sur-Seine, en banlieue rouge, ses parents – père ouvrier et mère recluse – étaient illettrés et ce sont les enfants (Tonino est le cinquième de la fratrie, le seul né en France en 1961 bien après son frère et ses sœurs nés entre 1943 et 1951) qui jouèrent un rôle de médiateurs entre eux et le monde extérieur. Pas de livres ni journaux à la maison ; les parents ne parlaient quasiment pas français ; sa mère étant incapable de demander son chemin dans la rue, c’est Tonino qui, encore très jeune, la guide pour se rendre chez le médecin.
Le parcours scolaire de Tonino Benacquista, replié sur lui en classe comme dans la cour de récréation, est difficile, émaillé de bulletins aux résultats médiocres et aux observations négatives des professeurs sur son travail. Si, eu égard à sa timidité, l’oral lui est insurmontable, c’est par l’écrit qu’il va « faire ses preuves » (« doit faire faire ses preuves à l’écrit » était une des remarques récurrentes sur ses bulletins). Il saisit là le moyen lui offrant accès à la parole. Il trouve un espace d’expression et de liberté avec les petits textes libres qui lui sont demandés par ses professeurs de français. Lors de devoirs en classe ou d’examens, y compris dans les matières scientifiques, il répond parfois par des textes de fiction. « Écrire, c’est se venger du réel » ; « faute de réparer, écrire c’est rétablir », explique-t-il. Se venger de la dure réalité familiale, marquée par l’addiction du père et l’état dépressif de la mère. Moyen de contourner son inhibition, l’écriture lui a offert un horizon, une ambition : elle lui a permis de démentir un destin d’enfant issu de l’immigration et d’un milieu social modeste au capital scolaire quasi inexistant. Un destin auquel en revanche n’ont pas échappé ses sœurs à qui leur père imposa une formation de sténodactylo aux cours Pigier, y compris à Anna, pourtant très douée à l’école.
Mais avant d’écrire, il lui fallut lire, ce qui fut tout sauf simple. Après quelques tentatives avec La Guerre du feu de J.-H. Rosny et Les Chroniques martiennes de Ray Bradbury, restées sans suite, ce fut au milieu de l’adolescence que sa résistance à la lecture s’évanouit lorsqu’il lut Une Vie de Maupassant auquel il consacre de beaux passages. Le plaisir de la lecture lui était enfin accessible.
Le lecteur fervent que je suis devenu rattrape le temps. Un chef-d’œuvre en appelle un autre, et la vision que j’ai de moi à l’heure du trépas, c’est un livre à la main, en proie à une épiphanie tardive suscitée par une phrase de Montaigne ou de Flaubert. Comment ai-je pu m’en passer jusqu’à aujourd’hui ?
p. 142
L’ambition de devenir écrivain surgit, elle, à la fin de l’adolescence avec la découverte de la Série noire de Gallimard. Après plusieurs boulots d’appoint (accompagnateur à la Compagnie de wagons-lits entre la France et l’Italie, gardien dans une galerie d’art) dans la vingtaine qui d’ailleurs lui ont inspiré le cadre de deux de ses livres (La Maldonne des sleepings, 1989 et Trois carrés rouges sur fond noir, 1990), il concrétisa son ambition, un peu avant la trentaine, de faire de l’écriture son métier, de « pouvoir vivre de [sa] passion pour le récit », précise-t-il.
Sous le signe d’une double culture
Récit de son cheminement vers l’écriture et la lecture, les mémoires de Tonino Benacquista ont pour toile de fond l’histoire de l’immigration italienne dans la France du second après-guerre, la France terre d’accueil qui lui a permis de devenir écrivain et à laquelle il rend hommage. Pas de traces de xénophobie anti-italienne dans Porca miseria. Il est vrai que, né en 1961, ses premiers souvenirs en France datent du milieu des années 1960. Concernant ses parents arrivés dix ans plus tôt, il indique qu’ils ont souvent été aidés dans leurs démarches administratives ou autres par une famille de voisins français. Pourtant, des marques d’hostilité aux Italiens n’étaient pas absentes dans la France de l’après-Seconde Guerre mondiale, même si elles furent certainement moins fréquentes que dans la période de l’avant-guerre. Pierre Milza a rappelé les agressions (insultes, jets de pierre) subies par l’équipe italienne lors du Tour de France cycliste de 1950 qui l’avaient conduite à se retirer de la course. Ralph Schor a montré que dans la région de Nice des sentiments anti-italiens étaient, à la même période, présents dans les milieux conservateurs (presse et forces politiques). Malgré tout, ces manifestations étaient en voie de disparition à partir des années 1950. Il faut voir là un effet de la croissance économique et du quasi-plein emploi ; peut-être une conséquence des premiers pas de la construction européenne ? Il convient de mentionner également l’achèvement du processus migratoire italien en France. Il est en effet pratiquement parvenu à son terme, la plus grande partie des Italiens ayant immigré en France entre les dernières décennies du XIXe siècle et la veille de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient en 1931 un peu plus de 800 000 sur 2,9 millions d’étrangers. À partir du milieu des années 1950, et sous l’effet du « miracle » économique, les migrations furent avant tout internes à l’Italie, depuis les régions méridionales vers celles du Nord et du Centre-Nord. Outre les aspects démographiques, économiques, sociaux et politiques de cette immigration, les historiens, à la suite de Pierre Milza (lui-même avec Voyage en Ritalie a conçu un ouvrage qui est à la fois une étude historique sur l’immigration italienne et un récit autobiographique sur les origines italiennes d’une partie de sa famille), en ont aussi abordé la dimension culturelle.
Pierre Milza, « L’image de l’Italie et des Italiens du XIXe siècle à nos jours », in R. Frank (dir.) Images et imaginaire dans les relations internationales depuis 1938, Cahiers de l’IHTP, n° 28, juin 1994, p. 71-82 et le chapitre 5 « Les incidents xénophobes » du livre de Fabien Conord, Le Tour de France à l’heure nationale, PUF, 2014, p. 157 à 192
Ralph Schor, « L’image de l’Italie dans la presse niçoise (1948-1953) », in J.-B. Duroselle et E. Decleva (dir.), Italia e Francia (1946-1954), Milan, ISPI/F. Angeli, 1988, p. 250-268.
Pierre Milza, Voyage en Ritalie, Paris, Plon, 1993.
Tonino Benacquista consacre plusieurs pages à réfléchir sur l’identité, sur la double culture dont il est le dépositaire. Il est incontestablement plus attaché à la France et à sa culture et estime que ce n’est qu’en France qu’il serait devenu écrivain : « Quel autre pays aurait donné à un enfant né de parents illettrés le goût d’écrire ? Ou lui donner à entendre son nom, venu d’ailleurs, prononcé sous les ors de la République ? », écrit-il. « Ce rapport aux livres et aux lettres, il l’a senti en France » a-t-il déclaré dans une interview. Toutefois, dans Porca miseria, il multiplie les références à la terre d’origine de sa famille. Il évoque à de nombreuses reprises ces confins du sud-est du Latium, terre de paysans, les cafoni. La région d’origine des Benacquista est très proche des Abruzzes et on pense à Fontamara, le roman qu’Ignazio Silone, dans l’exil antifasciste au milieu des années 1930, a consacré à la condition des cafoni de son village. Tonino Benacquista s’est beaucoup nourri de cinéma, notamment de la riche cinématographie italienne. Lorsqu’enfant il passait une partie de l’été dans le village familial, il fréquentait les cinémas où il voyait jusqu’à trois films par jour et pouvait profiter de la fraîcheur des salles obscures. Il mentionne Pain et Chocolat (1974), le film de Franco Brusati, où Nino Manfredi incarne un émigré italien en Suisse confronté à sa double appartenance (l’italienne est plus forte devant un match de foot quand l’équipe d’Italie marque un but). Il raconte que La Strada (1954) de Fellini était le film qui réunissait toute sa famille. Plus tard, adulte, il emmena ses vieux parents – qui rirent et en furent émus – voir à Paris Affreux, sales et méchants (1976) d’Ettore Scola.
Durant l’enfance, sa culture française est essentiellement une culture populaire faite de séries télévisées (Le Prisonnier) et de BD (Spirou, Pif Gadget, Astérix…) partagés entre camarades du voisinage.
Le livre est aussi un récit familial. Si, bien sûr, le rapport aux parents fut pour le moins compliqué et la vie de famille terne, le livre est empreint d’une immense tendresse envers les membres de la famille. Son frère et ses sœurs en sont les principaux destinataires, en particulier lorsqu’il dépeint la personnalité de chacun, décrit leurs traits physiques, ou encore quand, adulte, il « laisse éclater sa joie » quand ils lui rendent visite tandis qu’il « invente des stratagèmes pour retarder leur départ ». Tonino Benacquista émeut le lecteur en insérant dans son récit une lettre laissée par la plus jeune de ses sœurs, Yolande, peu avant de mourir d’une grave maladie. La lettre éclaire sur une personnalité très attachante que jusque-là ses frères et sœurs n’avaient pas réellement réussi à percer. Dans la mesure où il cherche à comprendre leur comportement, les parents n’échappent pas à la tendresse de l’auteur. Il indique que la vie de sa mère, pour qui le départ d’Italie fut une catastrophe, une « ruine » (une rouiiiina comme elle lançait à son époux les soirs de dispute), fut marquée par la « contrariété ». Quant à son père, qui ne lui a rien transmis, dit-il, il lui rend une forme d’hommage lorsque, récompensé du César du meilleur scénario pour un film de Jacques Audiard, il déclare au public : « J’ai entendu prononcer son nom toute la soirée. J’ai une pensée pour mon père. Il s’appelait César ». Enfin, le récit de Tonino Benacquista se charge d’une forte émotion lorsqu’il raconte comment, alors qu’il est un écrivain reconnu, il a traversé une longue période d’agoraphobie pendant laquelle il a « soigné la pathologie de [sa] mère par l’addiction de [son] père ».
À la fin de Porca miseria, il offre aux siens deux récits imaginant pour sa famille deux itinéraires où chacun aurait réalisé ses ambitions ou aurait, tout simplement, vécu la vie à laquelle il ou elle aspirait : l’un les mène aux États-Unis où un oncle de Tonino a fait fortune, l’autre les fait rester en Italie conformément au souhait de la mère. Manière pour lui de « se venger du réel » ; de témoigner également, une nouvelle fois, de sa tendresse envers les siens.
Pour citer cet article
Olivier Forlin, « Porca Miseria, un roman de Tonino Benacquista », RevueAlarmer, mis en ligne le 5 mai 2022, https://revue.alarmer.org/porca-miseria-un-roman-de-tonino-benacquista/