Du génocide des Tutsi au Rwanda, on connaît les machettes, la Radio télévision libre des Mille Collines (RTLM), la violence sexuelle systématique, les tueries intrafamiliales, les massacres jusque dans les églises et les milices interahamwe. On connaît moins ceux et celles qui se sont efforcés, armés ou à mains nues, de résister.
Quelques études leur ont toutefois été consacrées : François Robinet, « Les rescapés de Bisesero : résister, échapper, survivre au génocide des Tutsi », AOC, Paris, 2022, [en ligne :] https://aoc.media/analyse/2022/09/04/les-rescapes-de-bisesero-resister-echapper-survivre-au-genocide-des-tutsi/ ; African Rights et Jenny Matthews, Resisting Genocide: Bisesero, April-June 1994, Londres, African Rights, 1997, 110 p.
Tharcisse Sinzi est l’un d’eux et, a fortiori, l’un des rares à avoir survécu. Une combativité et une résilience que cet homme tutsi, né en 1960, doit en grande partie à sa pratique du karaté. Il fut l’une des deux ceintures noires de cet art martial que comptait le Rwanda des années 1990, et enseigne aujourd’hui encore cette discipline au pays des mille collines. C’est après avoir rencontré le journaliste français Thomas Zribi et avoir témoigné à un procès autour du génocide qui s’est tenu à l’été 2023 à Paris, que Tharcisse Sinzi s’est livré pour la première fois par écrit sur le sujet, dans son récit Combattre paru en mai 2025. Cette publication s’insère dans le champ, en expansion dans l’édition francophone, des témoignages des rescapés du génocide des Tutsi. Thomas Zribi y signe un prologue et quelques notes de bas de page.
Voir notamment Florence Prudhomme et Michelle Muller (dir.), Récits de rescapés du génocide des Tutsi en préfecture de Gikongoro, Paris, Classiques Garnier, 2024, 352 p.
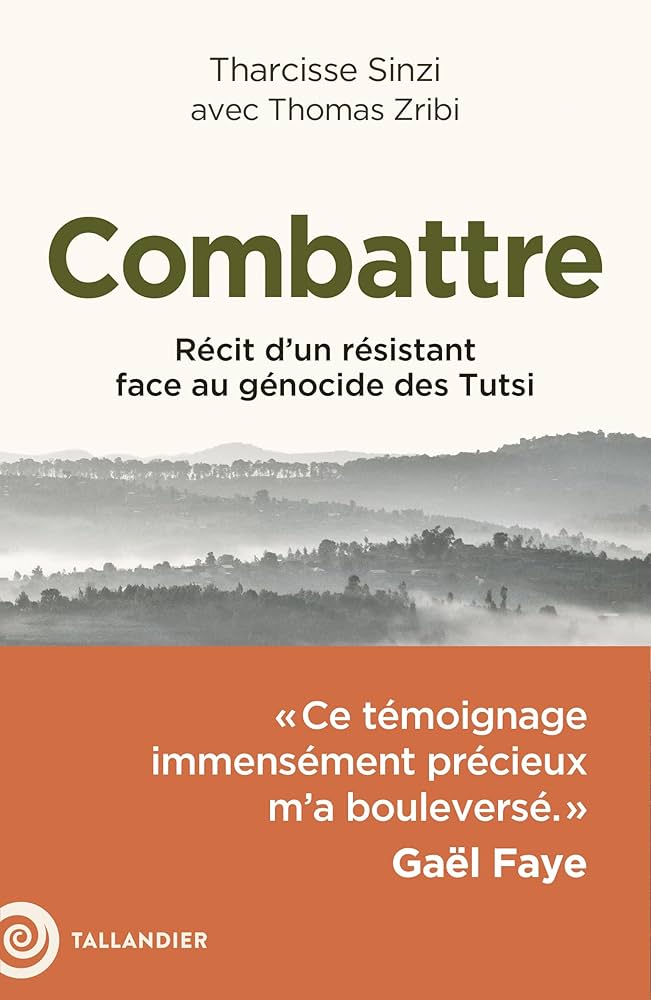
Être un karatéka tutsi au Rwanda
« Sur ma carte d’identité, le bourgmestre a rayé les mentions Hutu et Twa, me laissant l’ethnie la plus lourde à porter, Tutsi, celle de mon père » (p. 63). Si les dénominations de Hutu, de Tutsi et de Twa remontent à des temps anciens, c’est la colonisation qui leur a donné toute leur portée.
Tharcisse Sinzi débute son témoignage par un rapide retour sur l’histoire rwandaise, où ces dénominations ont longtemps renvoyé à des classes sociales plutôt qu’à des catégories ethno-raciales : les Tutsi étaient des éleveurs dont le nombre de vaches déterminait le degré de noblesse, les Hutu des cultivateurs, et les Twa des artisans et chasseurs de la forêt. La mobilité sociale était possible. « Les Belges », qui colonisèrent le Rwanda au lendemain de la Première Guerre mondiale, y ont « importé l’idéologie mortifère qui divisait les hommes en « races » » et ont, à grand renfort de « scientifiques » dépêchés sur place, « transformé nos classes sociales en ethnies, terme qui n’existe pas en kinyarwanda », faisant de chacune de ces catégories « un tampon administratif qui ne s’effaçait pas », rappelle Sinzi (p. 23). Les Tutsi, groupe minoritaire bien que largement plus grand que celui des Twa, seraient « plus grands, plus beaux, plus élancés et plus fourbes » (p. 23) que les autres, aussi les colonisateurs s’appuyèrent-ils sur eux, comme sur une élite sur laquelle reposerait l’indirect rule, pour gouverner leur empire colonial. Plus tard, dans les années 1950 où des mouvements indépendantistes se firent jour parmi les Tutsi, les colons changèrent leur fusil d’épaule (p. 29).
Bienvenu, ce rappel historique en ouverture, dans la veine de nombreux travaux publiés après le génocide, comme ceux de Jean-Pierre Chrétien ou Jan Vansina. L’auteur dit ainsi avoir compris sa propre appartenance à la supposée ethnie tutsi à l’âge de treize ans, lorsque des professeurs faisant l’appel demandèrent aux Tutsi de s’identifier : il remarqua du même coup que son ami Aimable n’en était pas un. Comme une manifestation concrète du resserrement progressif de l’« étau » autour des Tutsi. En 1973, il fut décrété que ces derniers ne devaient pas représenter plus de 10 % des entrants à l’école secondaire. Ainsi, Tharcisse Sinzi ne put pas y étudier. Et de rappeler les massacres commis dès 1959 et 1963 et la redistribution qui s’opéra alors d’une partie des terres des Tutsi à des familles Hutu.
Jan Vansina, Le Rwanda ancien. Le royaume Nyinginya, Paris, Karthala, 2001, 294 p. ; Jean-Pierre Chrétien, L’Afrique des Grands Lacs. Deux mille ans d’histoire, Paris, Champs Histoire, 2012, 416 p. ;Scott Strauss, « The Historiography of the Rwandan Genocide », dans Dan Stone (dir.), The Historiography of Genocide, Londres, Palgrave Macmillan, 2008, 640 p., pp. 517-542
Tharcisse Sinzi raconte ainsi que l’un de ses professeurs l’attrapait quotidiennement par les oreilles et lui criait de rejoindre ses frères Fidèle et Raphaël, partis plus tôt au Burundi. Cet État, « faux jumeau » du Rwanda où « les Tutsi sont restés au pouvoir après la colonisation » (p. 55), devint un refuge de plus en plus prisé de ces derniers. Tharcisse Sinzi ne fit pas exception. En 1977, dans ce pays, il fit ses premiers pas dans un club de karaté fondé par un Tutsi qui l’avait appris en Belgique. Un endroit fréquenté par de « jeunes Tutsi rwandais, réfugiés eux aussi, qui appréciaient ce lieu où ils pouvaient se retrouver et où l’on apprenait à se défendre » (pp. 58-59), raconte Tharcisse Sinzi.
De fait, la maîtrise du karaté s’avéra rapidement utile. Un été, il retourna au Rwanda accompagné de six autres Tutsi : à la force de leurs poings et de leurs pieds, ils parvinrent alors à échapper à l’arrestation par une milice, près de la frontière. « C’était la première fois que mes techniques de karaté me servaient en dehors du dojo », écrit-il (p. 61). Outre la capacité à se défendre, la maîtrise de cet art martial ouvrit à Tharcisse Sinzi bien des portes habituellement fermées aux Tutsi. En effet, au Rwanda, cet art martial était alors peu répandu et réservé à l’armée, faisant partie de la formation au combat dispensée notamment à l’université de Butare dans le sud du pays. Ceinture noire, Sinzi s’y rendit et y fréquenta de nombreux militaires à la ceinture bleue, ce qui le décida à travailler dans cette université. Alors que le vice-recteur l’en empêchait, ses camarades de karaté plaidèrent sa cause auprès de l’administrateur-trésorier, de nationalité canadienne, parvenant à le faire embaucher comme technicien de laboratoire et entraîneur de karaté. « Heureusement, le karaté m’a sauvé, une fois de plus », commente Sinzi (p. 65).
Sa maîtrise de l’art martial apparaît comme un laissez-passer, tant pour le franchissement des frontières rwandaises que pour sa propre carrière professionnelle dans le service public du pays. Toutefois, elle est chargée d’une certaine ambivalence quand on connaît la suite des événements. En effet, ses élèves de karaté étaient principalement, écrit-il, « des gendarmes et des militaires Hutu – les portes de l’armée étaient alors fermées aux Tutsi. Je ne sais si, parmi eux, certains ont participé plus tard au génocide. Je préfère ne pas y penser. Le karaté ne doit être utilisé que pour se défendre, c’est ce que j’ai toujours répété pendant les cours. Si cela leur a servi à tuer, c’est tout à leur déshonneur », affirme-t-il (p. 67).
Il n’empêche, écrit-il, que « pendant les entraînements, nous ne parlions pas d’ethnies. Personne ne me renvoyait, alors, à ma condition de Tutsi, j’étais l’entraîneur et rien d’autre » (p. 67). L’entraînement de karaté apparaît dès lors comme un havre, comme un espace détaché des problématiques ethno-raciales du pays. Pourtant, un jour, lorsque deux maîtres japonais se rendent au Rwanda pour y désigner quelqu’un comme deuxième dan, ces tensions semblent resurgir : Sinzi dut alors, pour espérer le devenir, affronter l’unique autre ceinture noire du pays, « un Hutu de Kigali » (p. 69) – dont il ne précise pas le nom. Ce dernier aurait fait croire aux maîtres japonais que le diplôme de Sinzi était un faux. « Était-ce de la rivalité ou de la haine anti-Tutsi ? Un peu des deux, j’imagine » (pp. 69-70). Aussi Sinzi a-t-il alors « décidé de gagner le combat », car « il fallait que le Hutu comprenne que j’étais plus fort que lui ». S’ensuivit un combat loin des règles de l’art, où Sinzi frappa « le plus fort possible » pour « faire tomber » son adversaire qui, en retour, « essayait de [lui] faire mal », tant et si bien que l’affrontement dégénéra en « bagarre de rue ». Comme un affrontement d’ordre racial qui n’aurait pas fait de vainqueur : les deux furent finalement désignés deuxièmes dan.
De manière révélatrice, comme s’il voulait installer une tension dramatique ou souligner le lien entre son destin et celui du Rwanda, Tharcisse Sinzi enchaîne le récit de ce combat indiscipliné avec celui du déclenchement de la guerre civile rwandaise en 1990, lorsque le Front patriotique rwandais, composé en grande partie d’exilés Tutsi, attaqua le Rwanda gouverné par Juvénal Habyarimana. Du jour au lendemain, l’atmosphère allait changer du tout au tout, des Hutu manifestant en traitant les Tutsi de « complices » du Front patriotique rwandais (FPR) et les collègues Hutu de Sinzi se montrant haineux, refusant désormais de partager le thé avec lui. Le régime ordonna aux habitants de rester chez eux, permettant aux gendarmes d’aller arrêter les Tutsi à leur domicile sans qu’ils aient de possibilité de fuite.
Convoqué par le procureur sans en connaître la raison, Sinzi perçut le danger qui pesait sur lui et, en amateur de films avec Chuck Norris, se dit « qu’il était temps d’imiter [s]on idole » (p. 79). Et de narrer le « film » qui se déroula alors dans son esprit : « j’allais tuer le procureur à mains nues » et semer ainsi la panique au parquet pour se donner une chance de fuir (p. 79). Profitant d’un moment d’absence du procureur, il découvrit sur son bureau une lettre d’un professeur de l’université le dénonçant comme prétendument membre du FPR. Sur le point de mettre son plan à exécution, Sinzi fut sauvé in extremis par une femme ayant mobilisé les parents d’élèves des écoles belge et française où il enseignait le karaté, parmi lesquels « des Blancs et des Rwandais haut placés » qui improvisèrent une manifestation devant le bâtiment du parquet (p. 81). Un deus ex machina rappelant, là encore, les ressorts d’un film d’action.
Plus tard, Sinzi raconte un second « film », qu’il ne réalisa finalement pas davantage que le premier. Quand commencèrent les tueries consécutives à l’assassinat du président Juvénal Habyarimana en 1994, il tenta dans un premier temps de fuir en pick-up vers son village avec d’autres personnes, dont un Hutu nommé Jonathan. Lorsque le véhicule fut arrêté à une barrière et que ses occupants s’attendaient à être envoyés vers le camp de Ngoma, il s’imagina attaquer les gendarmes… avant que Jonathan ne corrompe un militaire avec de l’argent retiré le matin même (pp. 108-111).
Mais le karaté se montra utile dans d’autres circonstances.
Résister à la « solution finale rwandaise »
« Qu’est-ce que vous faites ici ? Pourquoi n’avez-vous pas fui vers le Burundi ? » (p. 112), s’écria le père de Sinzi lorsque, six jours après le début des massacres, son fils revint au village de Nyagisenyi. Rappelant ainsi la spatialisation et les temporalités différenciées du génocide des Tutsi, précédemment mises en évidence dans l’imposante étude Aucun témoin ne doit survivre. Les massacres n’ont pas commencé partout au même moment ni avec la même intensité, aussi le retour de Sinzi s’insère-t-il dans un vaste déplacement de Tutsi d’une région à l’autre. En particulier, la « région la plus violente du pays », où « le génocide avait commencé dès le 6 avril au soir » (p. 112), est celle de Gikongoro, de l’autre côté de la rivière Mwogo. Trente-cinq ans plus tôt, pendant les massacres de l’année 1959, le père de Tharcisse avait organisé, autour de cette rivière, un « groupe de défense réunissant tous les hommes du village, Hutu et Tutsi », qui avaient ainsi « transformé les volontés d’épuration ethnique en guerre de territoire, leur région contre la nôtre » (p. 114). De massacres unilatéraux, les événements s’étaient transformés en affrontements armés.
Alison Des Forges et al., Aucun témoin ne doit survivre : le génocide au Rwanda, Paris, Karthala, 2004, 931 p.
C’est donc inspiré par l’exemple paternel que Tharcisse se décida à résister physiquement aux tueurs. La narration de cette résistance – qui doit beaucoup aux capacités martiales de Sinzi –, à travers deux épisodes distincts, est l’originalité majeure de Combattre.
Dans un premier temps, narre Tharcisse, son frère Frédéric et lui parvinrent, comme leur père avant eux, à réunir des hommes de leur village, des deux groupes ethniques, pour tenir la rivière Mwogo face aux tueurs tentant de passer le pont pour y poursuivre les massacres. La troupe hétéroclite, armée de machettes et de pierres mais « terrorisé[e] » (p. 116), tint bon quelques jours, « bien organisé[e] » (p. 117) et galvanisée par les discours de Sinzi.
Puis vint, le 19 avril, la diffusion à la radio d’un discours du président par intérim du Rwanda dénonçant la passivité des Hutu de la région de Butare, et désignant pour cibles ceux qui refuseraient de participer aux tueries. Un appel qui manifestait autant qu’il façonnait la racialisation croissante du conflit, alors même qu’il ouvrait la voie à des mises à mort de quelques Hutu aux côtés des Tutsi. Sans surprise, les rangs de la troupe de Sinzi n’en furent que plus clairsemés. Mais c’est lorsque les tueurs firent pour la première fois usage d’armes à feu, fournies par le régime qui « considérait que les tueurs n’étaient pas assez productifs dans le sud du pays » (p. 119), qu’elle se disloqua. Les résistants abandonnèrent le village pour espérer gagner le Burundi, accompagnés, pour certains, de leurs familles. Le père de Sinzi, lui, fut assassiné.
Le début de la fin ? L’avancée vers la frontière n’alla pas sans nouvelles pertes humaines puisque, contrairement aux attentes de Sinzi, les milices interahamwe, reconnaissables à leurs « feuilles de bananier sur leur corps, une sur la tête, une autre sur le bras » (p. 122), étaient sur leur route. Un « miracle » (p. 144) eut toutefois lieu au milieu des collines de l’Institut des sciences agronomiques du Rwanda (ISAR) Songa : des religieuses virent en aide aux fuyards, leur apportant à manger et à boire, raconte Sinzi. Se rappelant « Moïse qui conduit son peuple à travers le désert et reçoit la Torah des mains de Dieu en haut du mont Sinaï », il comprit alors, aux pieds de la plus haute colline de l’ISAR Songa, l’intérêt stratégique à gagner le sommet de celle-ci, position avantageuse contre les attaques : « là, nous pourrions trouver notre salut, nous organiser, rassembler nos forces, voir venir de loin nos assassins et les repousser » (p. 145).
Reprendre le combat plutôt que poursuivre une fuite incertaine : ainsi débuta, le 22 avril 1994, un second épisode de résistance aux ressorts eschatologiques et épiques, Sinzi se disant décidé à faire la guerre « comme les samouraïs d’Okinawa » (p. 146). Une référence – volontairement ? – approximative puisque, si les civils d’Okinawa ont résisté au débarquement américain en 1945, les samouraïs avaient, quant à eux, tiré leur révérence près de 70 ans plus tôt, s’inclinant eux aussi devant la puissance du feu à la bataille de Shiroyama.
Le foyer de résistance de l’ISAR Songa répondait à une organisation pensée, centrée sur la défense de la face nord de la colline, seul accès suffisamment peu escarpé pour être gravi par les miliciens. Chaque nuit, les femmes allaient ramasser des pierres, destinées à être lancées sur les attaquants au matin, par les hommes tirant profit de leur position en plongée. Si les derniers Hutu présents sur la colline, qui « croyaient encore que l’ethnie n’était pas le seul moteur des massacres » (p. 147) finirent par quitter les lieux à la première attaque, quand les génocidaires rappelèrent au mégaphone ne vouloir tuer que des Tutsi, le bruit des premières victoires défensives fut tel que, petit à petit, la colline fut rapidement rejointe par nombre d’autres Tutsi des environs ayant réussi à éviter les barrières. À son apogée, l’effectif massé sur la colline attint les 3400. Alors que la victoire militaire du FPR, seul moyen de mettre un terme au génocide, se faisait attendre, l’ISAR Songa s’avéra « l’une des rares lueurs d’espoir pour les Tutsi » (p. 150). Tant et si bien que le lien devint la cible de la propagande de la RTLM, « une priorité, une obsession pour nos tueurs » (p. 151).
Comme sur la rivière Mwogo, après la racialisation des rangs des défenseurs, c’est le passage d’un seuil de violence, celui des armes à feu, qui eut raison de la résistance sur la colline de l’ISAR Songa. Le 28 avril, au lendemain du survol des positions par un hélicoptère du régime, des tirs de mortier se firent jour, suivis d’hommes armés de fusils et de grenades. Y succéda une nouvelle fuite, en désordre et semée d’embûches, dont même Sinzi ne pouvait qu’« espérer » (p. 179) qu’elle menait au Burundi. En définitive, seules 118 personnes, parmi lesquelles Sinzi, parvinrent à se mettre en sécurité de l’autre côté de la frontière fluviale, moyennant la cession de leurs objets de valeur aux fonctionnaires burundais.
D’autres n’y parvinrent pas. Arrêtés près de la frontière par des Hutu inférieurs en nombre mais armés, ils firent l’erreur de se laisser faire, de s’asseoir et d’ainsi être achevés un à un puis jetés dans la rivière frontalière (p. 189). Comme une morale au récit de Tharcisse Sinzi : face à une mort certaine, il n’y a rien à perdre à lutter.
Retrouver l’humain
« Les périodes de crise peuvent te transformer, te faire oublier que tu es humain. Elles peuvent aussi exalter tes relations. J’ai avec mes amis de l’ISAR Songa des liens que je ne partage avec personne d’autre. Nous avons vu des choses impossibles à décrire et à comprendre pour quelqu’un qui n’était pas là », écrit Tharcisse Sinzi lorsqu’il narre l’organisation de la défense de la colline (p. 158).
L’humain et l’inhumain : telle est la dialectique centrale de son récit. Mais ce n’est pas dire qu’à des génocidaires inhumains se seraient opposés des victimes tutsi uniformément humaines : le tableau dressé par Sinzi est plus complexe.
La déshumanisation, l’animalisation des Tutsi fut, on le sait, centrale dans la rhétorique génocidaire hutu. On la retrouve dès les combats de la rivière Mwogo, où les tueurs arrivent en chantant : « Nous partons au travail, nous allons tuer les cafards Tutsi ! » (p. 116). Plus loin, Sinzi écrit que « pendant le génocide, les humains ont cessé d’être humains. On dit souvent qu’ils se sont comportés comme des animaux, mais les animaux sont bien moins cruels que les hommes » (p. 201), dans ce qui semble être un refus de retourner le stigmate, de désigner comme animal le coupable plutôt que la victime. Pourtant, lorsqu’il narrait plus tôt son face-à-face avec un Hutu armé d’un arc dans son village, il y précisait : « J’étais prêt à me jeter sur lui et à le tuer. Poursuivi par des bêtes, je réagissais comme un animal » (p. 126), cédant ici aux stéréotypes couramment associés à l’état naturel, sauvage.
De la sorte, le narrateur reconnaît avoir plus d’une fois été tenté de faire un usage de la violence dépassant la légitime défense, de se venger l’arme à la main. Confronté, dans un tribunal gacaca, à l’homme qui avait tué sa sœur et qui lui demanda alors « qu’est-ce que je peux faire pour vous ? », il lui répondit alors, narre-t-il lui-même, d’aller trouver une corde et de se pendre avec (p. 221). Si Sinzi renonça finalement à la vengeance envers les uns et les autres, c’est à la suite de discussions. L’une avec son oncle qui, peu après le génocide, le convainquit de reprendre le karaté et de « penser au futur plutôt qu’au passé » (p. 209), et l’autre avec un soldat du FPR nommé Emmanuel, qui lui démontra l’impossibilité mathématique de se venger sur tous les Hutu (p. 211). Des discussions banales en apparence, mais les mots justes dont Sinzi avait besoin à l’instant T pour dépasser l’irrationalité de sa propre colère.
Tribunaux coutumiers chargés d’une grande partie des procès consécutifs au génocide, entre 2005 et 2012. Ils jugèrent deux millions d’accusés et en condamnèrent plus de la moitié.
Autre trait pleinement humain disparu chez les victimes du génocide : l’empathie. « C’est une cicatrice invisible chez la plupart des rescapés : nos corps ont survécu mais nos âmes sont salies. […] Nous avons vécu de tels chocs que plus rien ne nous atteint. Depuis le génocide, je n’ai plus jamais pleuré, je n’ai plus jamais eu peur. […] J’essaie pourtant d’être un humain sensible comme les autres mais je n’y arrive plus. » (p. 139). Être confronté à l’inhumain nous rendrait-il inhumain ?
Chez les Hutu, ceux pour qui les meurtres de Tutsi étaient censés s’élever au rang de « travail » (mot largement commenté par les chercheurs et dont plusieurs occurrences ponctuent le livre), s’observe parfois une humanité inattendue, voire illogique. On l’a dit, c’est Jonathan, un Hutu, qui, au volant d’un pick-up, permit à Tharcisse Sinzi de quitter Butare. Et le narrateur de commenter : « Sans lui, nous aurions été exécutés le jour même. Lui le Hutu avait risqué sa vie pour sauver celle de cinq Tutsi ». Parmi ses autres passagers, un dénommé Jean-Léonard finit assassiné par « des militaires » qui, pourtant, épargnent sa femme et ses trois enfants. « Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils tuaient, et parfois, ne tuaient pas » (p. 111).
Chantal, fille du narrateur, trouva refuge, contre toute attente, chez « des Hutu qui participaient activement aux massacres ». « Tuer ne les empêchait pas de protéger une petite fille Tutsi. C’est l’un des mystères du génocide. Parmi les plus grands assassins, certains ont aidé des Tutsi. Pourquoi ? Pour se donner bonne conscience ? Pour que quelqu’un témoigne en leur faveur le jour venu ? » (p. 135). Des points d’interrogation pour le lecteur également. La petite fille fut finalement bel et bien tuée, mais beaucoup plus tard, lorsque sa famille d’accueil fuit l’avancée du FPR : « c’était une charge, une bouche à nourrir, une menace. Et à leurs yeux, elle n’était finalement qu’une Tutsi » (p. 136) : c’est, semble-t-il, un argument matériel qui a finalement conduit au meurtre. Dans le même village, un « vieux monsieur » mourut tué par « des Hutu qui ont fini par l’assassiner après l’avoir protégé. Pourquoi ont-ils changé d’avis ? On ne le sait pas » (p. 200).
Plus tard, après l’attaque au mortier de la colline, l’un des survivants, Gatari, passa pour mort après qu’un enfant échoua à le tuer, puis fut conduit par d’autres à une barrière de policiers municipaux. Ceux-là, plutôt que de l’abattre, le confièrent à une femme hutu désespérée, dont le mari et les six enfants, tutsi, et qui suppliait ces policiers de l’abattre elle aussi (pp. 175-176).
Si l’acte de tuer – et a fortiori de massacrer – apparaît souvent comme irrationnel, de tels exemples, sur un récit d’environ 200 pages, semblent témoigner d’actions de sauvetage dont la logique n’est pas toujours lisible, voire qui apparaissent elles aussi irrationnelles dans leur environnement immédiat. Des agissements contradictoires qui ne sont pas sans rappeler la notion de « zone grise » de Primo Levi, désignant l’ensemble des acteurs dont les comportements, en contexte génocidaire, semblent dépasser les figures manichéennes du bourreau et de la victime, participant plus ou moins directement à des crimes qui les impactent eux-mêmes, auxquels ils espèrent survivre.
LEVI Primo, Les naufragés et les rescapés : quarante ans après Auschwitz, Paris, Gallimard, 1989, traduit de l’italien par André Maugé, 199 p.
Peut-être sont-ce ces points d’interrogation qui conduisent Tharcisse Sinzi à conclure sur une note plutôt optimiste, estimant que ceux qui, comme lui, ont vécu le génocide sont « plus à même de pardonner », ayant quant à lui « appris à vivre avec [s]a peine et avec [s]es bourreaux » (p. 222). Convaincu que ses quelques « amis Hutu sont restés humains » (p. 229), il est décidé à leur laisser le bénéfice du doute – parmi eux se trouve pourtant un gendarme. « Je m’efforce de ne pas considérer tous les Hutu comme mes ennemis » (p. 222), écrit-il, comme pour souligner qu’il n’y parvient pas toujours : le pardon est une lutte intérieure, une volonté qu’il faut parvenir à faire triompher d’une colère qui rejaillit parfois. C’est aussi cela, combattre.
Orientation bibliographique
African Rights et MATTHEWS Jenny (photos), Resisting Genocide: Bisesero, April-June 1994, Londres, African Rights, 1997, 110 p.
AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, BECKER Annette, DUMAS Hélène, KUHN Samuel, ROBINET François (coord.), Dossier « Le génocide des Tutsi rwandais (avril-juillet 1994) et son après-coup », Historiens et Géographes, n° 457, Paris, Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie, 2022
AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, BECKER Annette, KUHN Samuel, SCHREIBER Jean-Philippe (dir.), Le choc. Rwanda 1994 : le génocide des Tutsi, Paris, Gallimard, 2024, 432 p.
DES FORGES Alison et al., Aucun témoin ne doit survivre : le génocide au Rwanda, Paris, Karthala, 2004, 931 p.
DUMAS Hélène, Le Génocide au village. Le massacre des Tutsi au Rwanda, Paris, Seuil, 2024 (2014), 400 p.
LEVI Primo, Les naufragés et les rescapés. Quarante ans après Auschwitz, Paris, Gallimard, 1989, traduit de l’italien par André Maugé, 199 p.
PRUDHOMME Florence et MULLER Michelle (dir.), Récits de rescapés du génocide des Tutsi en préfecture de Gikongoro, Paris, Classiques Garnier, 2024, 352 p.
ROBINET François, « Les rescapés de Bisesero : résister, échapper, survivre au génocide des Tutsi », AOC, Paris, 2022, [en ligne :] https://aoc.media/analyse/2022/09/04/les-rescapes-de-bisesero-resister-echapper-survivre-au-genocide-des-tutsi/
SIMBURUDALI Théodore, « Survivre au génocide des Tutsi au Rwanda », Revue d’Histoire de la Shoah, 2009, n° 190, 532 p., pp. 267-280
STRAUS Scott, « The Historiography of the Rwandan Genocide », dans STONE Dan (dir.), The Historiography of Genocide, Londres, Palgrave Macmillan, 2008, 640 p., pp. 517-542
VIDAL Claudine, « Enquêtes au Rwanda. Questions de recherche sur le génocide tutsi », Agone, 2014, n° 53, 208 p., pp. 103-142
Pour citer cet article
Alban Wilfert, « Combattre. Récit d’un résistant face au génocide des Tutsi, un témoignage de Tharcisse Sinzi avec Thomas Zribi », Revue Alarmer, mis en ligne le 10 octobre 2025, https://revue.alarmer.org/combattre-recit-dun-resistant-face-au-genocide-des-tutsi-un-temoignage-de-tharcisse-sinzi-avec-thomas-zribi/