Dans Appartements témoins. La spoliation des locataires juifs à Paris, 1940-1946, Isabelle Backouche, Sarah Gensburger et Éric Le Bourhis écrivent « l’histoire d’une spoliation oubliée », celle de milliers de locataires parisiens juifs dont les appartements non occupés – parce que leurs occupants avaient dû fuir ou avaient été arrêtés et déportés – ont été réaffectés à de nouveaux locataires, au mépris du bail signé et jamais résilié.
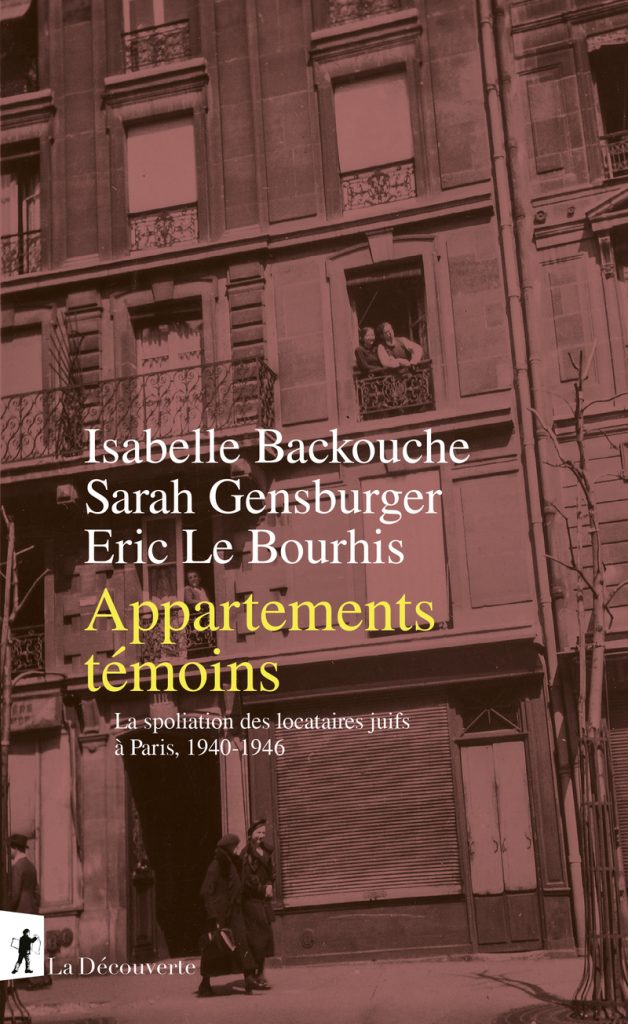
À la recherche des propriétaires et locataires juifs spoliés
Dès le titre, l’ouvrage propose de redéfinir les contours de la spoliation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, en y intégrant les droits locatifs. Jusqu’à présent, se fondant sur la définition juridique de la spoliation, seuls les biens ayant été volés et mis en vente (appartements, tableaux, meubles etc.), qui avaient fait l’objet d’une politique officielle, étaient considérés comme spoliés. La spécificité des droits locatifs des Juifs est que leur spoliation n’a été organisée par aucun texte officiel. C’est l’administration, en l’occurrence le service du logement de la Préfecture de la Seine à partir de mai 1943, en coordination avec les autorités occupantes, qui s’est chargé d’identifier et de réaffecter ces logements. À la croisée de l’histoire de la Shoah et de l’histoire du logement, l’un des premiers enjeux du livre consiste à reconstituer les circuits administratifs à l’origine de cette spoliation.
Pour ce faire, les trois chercheurs – deux spécialistes d’histoire urbaine et une spécialiste de la Shoah et de la mémoire – ont croisé deux types d’archives : des archives dites « ordinaires » avec les archives de la persécution. Tout a commencé par leur découverte d’un fonds conservé aux archives de Paris : le fonds Pérotin 901, intitulé « dossiers de réquisition de logements vacants en faveur de particuliers classés par ordre alphabétique, 1942-1944 ». Ce fonds a la particularité d’être à la fois une archive « ordinaire », celle d’une section du service de l’Habitation qui existait avant et après l’Occupation, et une archive de la persécution puisque la section était spécialisée dans la spoliation des Juifs (p. 416). Ce fonds conduit à aborder le sujet « par le bas », à partir des dossiers, afin de comprendre une politique à partir de ses impacts sur le terrain et sur les individus. À la manière d’enquêteurs, les trois chercheurs ont croisé ce fonds avec de nombreuses autres archives : ordinaires (mairies de banlieue ; recensements de population ; calepins du cadastre de Paris ; fichier immobilier établi à partir de l’ordonnance nationale du 11 octobre 1945 sur les locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés ; les registres matricules des écoles maternelles et élémentaires de la Ville de Paris) et de la persécution (archives produites par l’occupant ; le fonds du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) ; les fiches produites par les recensements successifs ou l’internement des Juifs dans les camps d’internement français ; des dossiers d’après-guerre sur les dommages de guerre, l’épuration, le recensement des crimes de guerre, les poursuites en justice de présumés collaborateurs). On le comprend, une telle enquête implique une moisson d’archives particulièrement dense, dont le croisement produit des effets de connaissances bien mis en valeur dans l’ouvrage.
La spoliation : une multiplicité d’acteurs
Comment s’est donc effectué le processus de spoliation des baux locatifs juifs ? En 1940-1941, l’arrivée des Allemands conduit d’abord à la réquisition de certains logements. Certains d’entre eux sont identifiés comme appartenant à des Juifs (chapitre 2). Sont-ils particulièrement ciblés ? Ce qui est certain, c’est qu’à partir de l’ordonnance qui ordonne le recensement des Juifs en zone occupée (27 septembre 1940) et l’interdiction qui est faite aux Juifs ayant fui en zone libre de revenir en zone occupée, la Kommandantur interdit la restitution des appartements réquisitionnés aux occupants juifs (p. 35). De nombreux intermédiaires français participent à l’identification des « logements juifs » inoccupés (mais juridiquement non « vacants » car la plupart des familles n’ont pas donné congé). Police, entreprises de travaux, propriétaires et concierges, préfecture de la Seine, mairies ainsi que leur personnel, fournissent aux Allemands des listes. Si la police française joue un rôle central dans la mise en œuvre de ces listes – ce sont aussi les commissariats qui mènent le recensement des Juifs résidents à partir d’octobre 1940 –,le Commissariat général aux questions juives entre aussi en jeu à partir de 1942. En opérant d’emblée une distinction entre les locataires juifs et les autres, « les réquisitions allemandes ouvrent une brèche importante » (p. 32) pour la suite. Très vite, les « logements juifs » sont dans le viseur des partis et organisations collaborationnistes qui entendent se les approprier et « justifient leur accaparement par un antisémitisme virulent » (p. 44). Le chapitre 3 explore ainsi la manière dont ces organisations, ainsi que les services de la politique antisémite au sein de l’administration de l’État français, ont cherché à tirer profit des locaux et appartements dits juifs.
Parallèlement, de nombreux propriétaires d’immeubles (à l’époque, le plus souvent, les immeubles étaient la propriété d’une seule personne) et les bailleurs du parc public entament des démarches pour expulser leurs locataires non solvables, notamment les Juifs ayant fui leur logement et n’ayant plus payé le loyer (chapitre 4). La situation de crise du logement à Paris, renforcée par les sinistrés à la suite des premiers bombardements alliés (Boulogne-Billancourt en mars-avril 1942) conduit par ailleurs à la mise en place d’une politique visant à faire circuler l’offre privée. La loi du 11 décembre 1940 impose une centralisation de l’information, les 100 mairies de la Seine devant transmettre les signalements de vacances à la préfecture ; l’arrêté du 29 janvier 1941 donne aux maires la possibilité d’enregistrer les locaux que leur propriétaire n’a pas déclarés. Dans ce contexte de chasse aux logements vacants et de pression sur les propriétaires, certains propriétaires vont même jusqu’à chercher à se débarrasser de locataires juifs absents mais qui payent encore leur loyer (chapitre 5). Jusqu’au printemps 1942, « l’espoir des gérants de se débarrasser des locataires juifs en s’adressant à une administration ad hoc est toutefois contrarié » (p. 78). En revanche, de plus en plus de contraintes pèsent sur les Juifs, qui se voient progressivement dépossédés de leur droit de propriété sur leurs meubles. Cela commence en 1941 : les propriétaires, gérants et gardiens d’immeuble ont l’interdiction de tolérer l’enlèvement des biens meubles des Juifs résidant en zone libre (ordonnance de la préfecture de la Seine). En juillet 1941, ils sont autorisés à enlever les meubles et à les mettre en dépôt après la résiliation du bail. Le 17 décembre 1941, une ordonnance allemande bloque les meubles juifs : les Juifs n’ont plus le droit d’en disposer sans l’assentiment d’un service du CGQJ. Enfin, le 7 février 1942, une ordonnance allemande interdit aux Juifs de changer de résidence.
À partir de 1942, « les autorités d’occupation s’emparent de tous les meubles et objets conservés dans les logements des familles juives absentes » (p. 84, chapitre 6), sans concertation avec l’État français dont les administrations s’y opposent puisqu’ils ne pourront plus « utiliser les meubles pour se payer des impôts dus » (p. 88). Entre mars 1942 et le 18 août 1944, 38 000 appartements loués par des Juifs sont ainsi vidés de leurs meubles par la Dienstelle Westen (DW), en charge de « l’Opération Meubles ». Ce faisant, les Juifs sont dépossédés de leurs meubles. Cependant, jusqu’au mois de mai 1943, le sort des appartements vidés par la DW n’est pas encore scellé, même si le contexte du marché locatif bloqué et les déportations qui s’accélèrent (rafle du Vel d’Hiv en juillet 1942) attisent les convoitises autour des « appartements juifs » (chapitre 7). Le CGQJ reçoit de nombreuses lettres signalant les appartements inhabités ou vidés de leurs meubles, informations qu’elle transmet à la DW. Dès l’été 1942, la DW autorise, au coup par coup, la relocation de certains appartements vidés, tandis que le CGQJ gagne de plus en plus de voix au chapitre dans le domaine (chapitre 8).
Au printemps 1943, le service de l’Habitation de la Préfecture de la Seine devient le « chef d’orchestre de la réaffectation » des logements vacants : « Dorénavant, une politique française, vichyste, mais locale, préside au devenir des appartements des parisiens juifs » (p. 126, chapitre 9). En mai une nouvelle section est créée au sein du service, elle est en charge des « locaux vacants et du relogement ». Si elle est d’abord dépendante de la DW et du CGQJ pour le choix des nouveaux locataires, en quelques mois elle prend en main la relocation. C’est la naissance du « service du Logement » de la rue Pernelle. Les chapitres suivants, passionnants, cherchent à faire revivre le quotidien et les acteurs de ce service de la préfecture de la Seine. On y découvre les locaux et le guichet du 2 rue Pernelle et ses employés (chapitre 10) et ses usagers aux profils divers, notamment des individus jusqu’à présent exclus des politiques du logement (chapitre 11). Le travail du service s’accompagne d’un véritable fichage des appartements juifs (chapitre 12) et s’appuie sur divers partenaires (chapitre 13).
Les bénéficiaires de cette politique sont divers : des sinistrés, des fonctionnaires (chapitre 14) mais aussi des locataires expulsés des îlots insalubres (chapitre 15). Certains d’entre eux « font la fine bouche » (chapitre 16) et cherchent à obtenir le logement qui leur convient le mieux, quitte à refuser certaines propositions. Un chapitre aborde spécifiquement le cas des voisins et du voisinage comme « rouage fondamental de la réaffectation des appartements juifs » (p. 242, chapitre 17). Qu’il s’agisse des concierges, des voisins et propriétaires qui diffusent les informations, ou des voisins qui candidatent pour améliorer leur confort, tous participent d’une politique de spoliation. Beaucoup entretiennent par ailleurs des liens avec les Allemands – qu’ils travaillent pour eux, les rencontrent via leur commerce, etc. – dont les autorités soutiennent leurs demandes de relogement (chapitre 18). Sont-ils antisémites ? C’est la question posée par le chapitre 19 qui s’intéressent aux pratiques des Parisiens. Ce qui est certain, c’est que beaucoup de Parisiens acceptent la disparition des Juifs et entendent en profiter. L’apparence de cadre légal « libère les ardeurs mises à satisfaire son propre confort » (p. 275).
Conserver ou recouvrer son logement : une lutte souvent vaine
Des Juifs essaient toutefois de lutter pour rester locataires (chapitre 20) : protestations auprès du propriétaire, paiement du loyer malgré l’éloignement, retour régulier dans un logement vidé, sont autant de stratégies pour ne pas s’en voir dépossédé. Mais ces actions se heurtent à une politique organisée de spoliation locative, qui aryanise les droits des Juifs sur leurs appartement (chapitre 21). Ce sont les autorités françaises qui pilotent l’aryanisation, en lien avec les autorités allemandes en charge du pillage. Cette politique connaît une accélération au printemps 1944 (chapitre 22), notamment à la suite de bombardements alliés qui font de nombreux sinistrés.
Que se passe-t-il après la Libération ? À leur retour à Paris à partir de la fin de l’été 1944, de nombreux Juifs constatent que leurs logements sont occupés par d’autres (chapitre 23). Des accords à l’amiable sont parfois trouvés – peu visibles dans les archives – mais de nombreux locataires juifs font aussi face à des nouveaux locataires ou des propriétaires qui leur adressent des fins de non-recevoir, voire se montrent ouvertement antisémites ou violents. Certains locataires juifs se saisissent donc de la justice pour récupérer leurs biens. La justice, en l’occurrence le tribunal de la Seine, se fonde sur le droit commun : un seul bail est légal, en l’occurrence le premier. L’essentiel des recours en justice sont donc favorables aux Juifs. La mise en application des décisions n’est toutefois pas possible et des relogés refusent parfois de quitter les logements, même si la police est censée pouvoir intervenir.
Certains locataires juifs décident de faire appel à l’administration. Ils se heurtent toutefois « à une administration préfectorale qui n’entend pas renier le travail accompli » et entend protéger un certain nombre de relogés (chapitre 24). L’administration trouve satisfaction dans une ordonnance gouvernementale du 14 novembre 1944 (chapitre 25). Celle-ci tend à privilégier les relogés sur les évincés, en identifiant des catégories qui ne peuvent pas être contraintes à quitter les logements, notamment les sinistrés. Comme l’écrivent les auteurs, le dispositif juridique construit par ces textes est paradoxal : « il reconnaît les évictions des droits locatifs comme des spoliations mais ne décide pas de leur annulation de principe et entérine l’état de fait qui en a résulté » (p. 355). Les Juifs qui se lancent dans des procès les perdent désormais la plupart du temps. Et ce cadre législatif tend à permettre l’expression d’un antisémitisme persistant dans la société parisienne, concluent les auteurs dans le dernier chapitre (chapitre 26). Ils évoquent la création d’associations de « locataires de bonne foi » qui entendent lutter pour leurs droits, c’est-à-dire ceux des individus qui ont bénéficié des appartements juifs « de bonne foi ». Ces associations n’hésitent pas à organiser des manifestations antisémites et xénophobes – insistant notamment sur les origines étrangères de beaucoup de Juifs locataires et sur la qualité de « victimes » des sinistrés – en plein Paris en 1945. Elles s’opposent ainsi aux procès en réintégration en faveur des Juifs. Si les Juifs trouvent du soutien du côté de certaines associations comme l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide (UJRE), les ordonnances qui viennent compléter celles de novembre 1944 ne leur permettent pas de récupérer leurs logements. Alors que la spoliation sous l’Occupation n’a pas fait l’objet de textes de loi, « c’est bien la loi, et l’adoption d’une ordonnance conçue pour limiter leur ‘réintégration’ dans leurs logements, qui a rendu permanente la spoliation dont ils ont été l’objet » (p. 384). Or, cette décision politique empêche de nombreux survivants et rescapés juifs de retrouver la place qui était la leur dans la société parisienne d’avant-guerre notamment parce que, pour beaucoup d’entre eux, leur logement était aussi leur lieu de travail.
Une histoire incarnée
Ainsi, ce livre nourrit et renouvelle l’histoire des spoliations des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et ce, de plusieurs manières. Il le fait, tout d’abord, en redéfinissant la notion de spoliation et en y incluant la question des baux locatifs, jusqu’alors laissée de côté dans la plupart des travaux juridiques ou historiques sur le sujet. Pour les auteurs, il s’agissait de « rendre visible ce qui était devenu invisible » (p. 383). Cette histoire ne serait pas complète sans que l’après-guerre y soit pleinement intégré : c’est en effet après la guerre que cette politique de spoliation a été définitivement entérinée par des textes de loi. Pour les auteurs, il ne s’agit pas ici d’un simple retour à la « légalité républicaine » qui « aurait cherché à traiter tout le monde de la même manière, mais de l’acceptation du gouvernement provisoire d’entériner cette spoliation des droits locatifs – à l’inverse des autres domaines de la spoliation qui ont, eux, fait l’objet d’une politique de réparation, certes imparfaite mais tangible » (p. 385).
Un autre apport du livre est relatif au travail autour des échelles d’analyse : les auteurs combinent ainsi constamment des études de cas à l’échelle des rues, des immeubles et des appartements avec des approches plus surplombantes, par les politiques mises en œuvre. C’est donc une histoire incarnée que nous lisons, dans des lieux et dans des vies (chaque chapitre commence en effet à une adresse et par une histoire individuelle), sans jamais perdre de vue la situation générale.
Plusieurs autres points gagnent à être soulignés, notamment l’attention des auteurs au langage et aux mots et expressions qu’ils emploient. Les guillemets d’abord mobilisés pour qualifier les « appartements juifs », ne le sont ensuite plus car, écrivent les auteurs, le terme est alors passé dans le langage courant sous l’Occupation. Cette attention au vocabulaire est intéressante en ce qu’elle révèle le basculement d’une réalité à une autre, d’un monde où l’antisémitisme fait partie du quotidien, où les Juifs sont devenus un « eux » pour beaucoup de Parisiens. Mais les Parisiens étaient-ils en majorité antisémites ? L’ouvrage ne cherche pas à répondre frontalement à la question mais plutôt à confronter les politiques à ce qu’en font les populations. Ce faisant, il opère un déplacement de point de vue. Il montre ainsi « le formatage des comportements individuels par une politique et les effets de conformisme qui en découlent » (p. 387). En s’intéressant aux pratiques concrètes, les auteurs montrent que l’opportunité d’obtenir un meilleur logement conduit beaucoup de Parisiens à se faire les complices d’une politique antisémite, voire d’en être les acteurs dans le cas de ceux qui dénoncent des familles.
On notera, pour conclure, que les auteurs invitent à la fin de l’ouvrage à plusieurs prolongements et développements des recherches. Ayant présenté leurs travaux dans le cadre d’un séminaire à l’École des hautes études en sciences sociales pendant plusieurs années, ils ont déjà eu l’occasion de transmettre des méthodes à des étudiants et étudiantes, notamment le fait de travailler sur des sources ordinaires et de les croiser avec celles de la persécution ou celles des tentatives de réparation. Ils suggèrent désormais de reconsidérer la place du logement dans l’histoire de l’Occupation, de s’intéresser à d’autres territoires qui auraient pu connaître une même opération, ou encore de creuser la période de l’après-guerre. Enfin, ils ouvrent une réflexion sur la mémoire de cette spoliation, notamment dans les familles, aussi bien celles des spoliés que des bénéficiaires des appartements. L’ouvrage n’a en effet pas creusé cette dimension, qui nécessiterait une recherche de fond, notamment fondée sur l’histoire orale. À bon entendeur !
Pour citer cet article
Zoé Grumberg, « Appartements témoins. La spoliation des locataires juifs à Paris, 1940-1946, un livre d’Isabelle Backouche, Sarah Gensburger, et Éric Le Bourhis », Revue Alarmer, mis en ligne le 25 novembre 2025, https://revue.alarmer.org/appartements-temoins-la-spoliation-des-locataires-juifs-a-paris-1940-1946-un-livre-disabelle-backouche-sarah-gensburger-et-eric-le-bourhis/