La traduction française de l’ouvrage de Saidiya Hartman, professeure d’anglais et de littérature comparée à l’université Columbia, a connu un certain écho au-delà des cercles académiques, faisant notamment l’objet de recensions dans des journaux comme Le Monde, Libération ou Télérama, et donnant lieu à un « grand entretien » lors des Rendez-vous de l’histoire de Blois 2024. L’autrice avait déjà acquis une importante notoriété aux États-Unis grâce à son livre précédent, Lose Your Mother (2007, également traduit en français sous le titre A perte de mère). Elle y entremêlait histoire de la traite atlantique du point de vue de l’esclave et de son expérience singulière, et récit de son propre voyage au Ghana, en quête de traces de son passé. Alors que ses précédents travaux traitaient justement de la période de l’esclavage, S. Hartman aborde ici une époque ultérieure, qui va de 1890 à 1935. Celle-ci correspond, pour les Noirs américains, à l’apogée de la ségrégation, à la Grande migration du Sud vers les villes industrielles du Nord et de l’Est et, corrélativement, à la naissance ou à la transformation de quartiers noirs existants en ghettos.
Saidiya Hartman, Lose Your Mother: A Journey Along the Atlantic Slave Route, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2007. Traduction française : À perte de mère – Sur les routes atlantiques de l’esclavage, Dijon, Les Presses du réel, 2023, traduit et préfacé par Maboula Soumahoro.
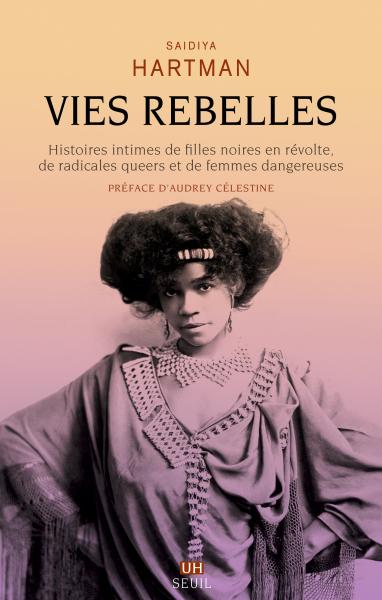
Un récit choral et immersif
On ne trouvera pas, dans l’ouvrage, de développements détaillés sur l’un ou l’autre de ces phénomènes ou même un cadrage chronologique. Il est composé de telle manière que chaque chapitre fasse entrer le lecteur, in medias res, dans la vie agitée d’un des personnages de la pièce – c’est ainsi que l’introduction les présente. S. Hartman ambitionne de restituer, au fil de ces portraits, ce qu’elle appelle « l’émeute intérieure » (p. 234) de jeunes femmes noires américaines des quartiers pauvres de New York et de Philadelphie. Toutes les protagonistes ne sont pas des anonymes : ainsi d’Ida B. Wells, célèbre militante contre le lynchage, ou de la comédienne Edna Thomas, figure du Black Theater à l’époque de la Renaissance de Harlem (années 1920). C’est néanmoins à des femmes peu ou pas connues, issues des classes populaires, que s’intéresse en priorité l’autrice. Certaines ont connu l’esclavage ou sont descendantes d’esclaves du Sud, et ont quitté la région depuis peu. Depuis les premiers travaux de James Grossman portant sur la ville de Chicago (1989), l’historiographie de la Grande migration a montré que le départ loin des plantations de coton s’était nourri à la fois de l’espoir de conditions économiques plus favorables et de la promesse d’un meilleur statut civique (notamment avec le droit de vote). Ces aspirations se sont heurtées, sur place, à des conditions de vie souvent plus difficiles que prévu, mais les retours vers le Sud furent rares. Ce mélange de rêves et de labeur, de soif de vivre et d’épreuves, qui fut le lot des femmes de cette génération du départ, fait la matière même du livre de S. Hartman.
James R. Grossman, Land of Hope: Chicago, Black Southerners, and the Great Migration, Chicago, University of Chicago Press, 1989. La Grande migration désigne le départ des Noirs américains hors du Sud ségrégué, vers le Nord, l’Est puis, de façon croissante, l’Ouest du pays, entre les années 1910 et 1970.
Sa démarche s’inscrit donc dans la lignée d’une histoire sociale s’attachant à retracer la vie des gens ordinaires, souvent oubliés, dont il est parfois difficile de retrouver la trace dans les archives. Ce programme est aussi celui d’un pan considérable de la production historique traitant des Noirs américains. Au-delà de cet objectif devenu somme toute classique, mais s’inscrivant ici dans les champs dynamiques du genre et de l’intime, c’est davantage la méthode qu’emploie S. Hartman pour y parvenir qui frappe, à la lecture de l’ouvrage. Les enjeux épistémologiques que soulève Vies rebelles concernent en particulier les modalités d’écriture, comme y insiste fort logiquement Audrey Célestine dans sa préface. Pour le dire plus simplement, le livre est d’une lecture très plaisante et révèle des qualités littéraires indéniables. C’est tout un monde enserré dans des ruelles étroites, avec ses immeubles exigus (les tenements), ses cabarets, ses bordels, ses amours interlopes et ses danses enfiévrées, qui surgit sous les yeux du lecteur. Cela se lit « comme un roman », trop peut-être ; c’est en tout cas ce qui suscite le plus d’interrogations.
Une frontière parfois floue entre histoire et fiction
S. Hartman ne fait d’ailleurs pas mystère du rôle important que joue l’imagination dans le récit de ces « histoires intimes ». On ne suggère pas par là qu’elle aurait une maîtrise insuffisante de la bibliographie ou une fréquentation superficielle des sources. Au contraire, sa familiarité avec la période et le groupe qu’elle étudie est évidente et se ressent à la façon dont, sans avoir l’air d’y toucher, elle introduit ici une référence à tel événement local, là une remarque sur l’urbanisation de tel quartier. Surtout, on est frappé de sa capacité à saisir le grain fin des relations raciales, des rapports de classe, de la quotidienneté. Le tout s’appuie sur un imposant appareil de notes ; S. Hartman a ainsi épluché archives judiciaires, policières, enquêtes sociales comme celle que le célèbre W. E. B. Du Bois a consacré, au début du siècle, aux Noirs de Philadelphie. Plutôt que de reproduire le point de vue des élites du temps, elle cherche à comprendre celui de ces femmes auxquelles elle donne la parole. Celles que les travailleurs sociaux ou les sociologues de l’époque décrivaient parfois comme des filles perdues ou immorales deviennent, sous cette plume généreuse, bien plus que cela : des copines flânant devant les vitrines ou échangeant des potins, des apprenties artistes rêvant de percer dans l’effervescence de la Renaissance de Harlem ou simplement des adolescentes tentant de se construire une vie moins brutale. La notion parfois galvaudée d’histoire par le bas (« history from below ») n’est pas usurpée ici.
W. E. B. Du Bois, The Philadelphia Negro: A Social Study, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1899. Traduction française : Les Noirs de Philadelphie. Une étude sociale, suivi de Enquête spéciale sur les Noirs employés dans le service domestique dans le 7e district, par Isabel Eaton, Paris, La Découverte, 2019, traduction, préface et appareil critique de Nicolas Martin-Breteau.
En bref, Vies rebelles est un ouvrage riche, prenant, émouvant même. Et cependant, il ne peut manquer de susciter un embarras, car l’autrice mêle régulièrement histoire et littérature et emploie parfois l’indicatif là où le conditionnel serait plus approprié. Il lui arrive de faire passer pour certain ce qui n’est en réalité que probable, et pour vrai ce qui est seulement vraisemblable. Un doute finit par saisir le lecteur quant à la nature du récit qui lui est proposé, doute que l’appareil critique ne dissipe pas entièrement car il n’est pas toujours possible de savoir précisément ce que l’autrice a tiré de tel dossier judiciaire par exemple. Le projet du livre, profondément politique et assumé comme tel, débouche sur une résurrection du passé qui passe par pertes et profits certains conseils de prudence du positivisme. Pour les arracher à l’oubli et leur rendre justice, S. Hartman redonne littéralement vie à ses personnages, quitte à leur prêter des pensées, des sentiments, des émotions qu’ils n’ont peut-être pas tout à fait eus. C’est ce qu’elle a elle-même théorisé, il y a quelques années, sous le nom de critical fabulation, que l’on peut traduire par « fabulation critique » ou « fiction critique ». Tout se passe comme si, au fond, la littérature était là pour suppléer, à l’occasion, aux impuissances de la science. En tout cas, Vies rebelles est susceptible de faire rebondir le dialogue entre les partisans d’hybridations de ce type et leurs opposants.
Saidiya Hartman, « Venus in Two Acts », Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism, 2008, vol. 12, no 2, p. 1‑14.
La seconde réserve que l’on peut adresser au livre concerne l’un de ses principes interprétatifs essentiels, ainsi présenté au début de l’ouvrage, en conclusion d’une section intitulée « Un mot sur la méthode » : « L’idée folle qui anime ce livre est que les jeunes femmes noires étaient des penseuses radicales qui imaginaient inlassablement d’autres façons de vivre et ne cessèrent jamais d’envisager les multiples chemins susceptibles de mener à un monde différent ». L’autrice, guidée par une forme de populisme théorique dans son souhait de rendre hommage à celles sur qui elle écrit, n’exagère-t-elle pas parfois leur degré de conscience politique, au point de leur donner le statut de « penseuses radicales » ? Elle semble parfois hésiter sur le contenu à donner à cette radicalité : il s’agit le plus souvent d’un désir de liberté sentimentale et sexuelle, et plus généralement de liberté quant au style de vie qu’elles entendent mener. S. Hartman assimile ce désir à une résistance quotidienne à un ordre oppressif, une somme de refus plus ou moins articulés. Faut-il cependant considérer que tout écart à la norme est d’essence politique, que, par exemple, tout refus de travailler dissimulerait une sourde opposition à la société productiviste dans son ensemble ? Dans certains passages, cette radicalité semble renvoyer à un projet plus concerté : ainsi S. Hartman décrit-elle la Grande migration comme une « grève générale » : « Ces esclaves voulaient mettre fin à l’économie du système de plantation, et c’est pour cette raison qu’ils quittèrent les plantations. » (p. 132-133). Les motivations plus individuelles (et aussi plus prosaïques), comme celle de trouver un emploi mieux rémunéré, s’effacent alors au profit d’un hypothétique projet révolutionnaire.
La notion de résistance quotidienne a connu une longue fortune historiographique. Elle fut employée dès les années 1940 à propos de l’esclavage : Raymond A. Bauer et Alice H. Bauer, « Day to Day Resistance to Slavery », The Journal of Negro History, 1942, vol. 27, no 4, pp. 388‑419.
Le terme d’esclave est ici métaphorique et non juridique : l’esclavage avait été aboli par le XIIIe Amendement de 1865.
Pour citer cet article
François-René Julliard, « Vies rebelles. Histoires intimes de filles noires en révolte, de radicales queer et de femmes dangereuses, un livre de Saidiya Hartman », Revue Alarmer, mis en ligne le 9 septembre 2025, https://revue.alarmer.org/vies-rebelles-un-livre-de-saidiya-hartman/