Dans son ouvrage publié chez CNRS Éditions en 2024 sous le titre Faire partie du club. Élites et pouvoir au Kenya, Dominique Connan nous plonge dans l’univers fermé des clubs du Kenya. C’est là, depuis le début du XXe siècle, que les élites sociales, économiques et politiques du pays se retrouvent pour manger, boire ou disputer une partie de golf, dans cet entre-soi qui caractérise la classe dominante. D’abord strictement réservés aux Européens de la colonie, les clubs ont progressivement accueilli les élites issues des autres groupes de population, sans jamais toutefois se départir de leur héritage raciste.
Comme le souligne l’auteur, « appartenir à un club est un marqueur de hiérarchies sociales et une pratique de distinction qui opère par la ségrégation de ses membres » (p. 15). L’originalité de sa démarche consiste précisément à dévoiler les mécanismes invisibles de la distinction, qui opèrent au sein de la classe dominante et contribuent à sa fabrique, en prenant comme point d’observation les espaces de socialisation de ce groupe. L’enquête menée entre 2008 et 2013 se déroule dans le huis clos des clubs : pour y pénétrer, l’auteur a donc dû s’affilier à plusieurs d’entre eux et se mettre à la pratique du golf. Cette posture du chercheur, qui « fait partie du club » sans pour autant partager l’éthos de la classe dominante du Kenya, n’est pas anodine. Inclassable et mal identifiable aux yeux des autres membres, au-delà de sa couleur de peau qui le range du côté des privilégiés dans un contexte postcolonial, sa présence suscite le questionnement, voire dérange.
L’ethnographie minutieuse que livre Dominique Connan, à partir de la position singulière qu’il occupe, permet au lecteur d’appréhender de façon concrète la manière dont s’organisent et se négocient socialement ces espaces. En effet, la description détaillée des rituels et des évènements qui se déroulent dans les clubs, description dont il convient de souligner la très grande qualité, étayée par de longs extraits d’entretiens menés auprès des membres et des agents des clubs, nous immerge dans l’ambiance de ces derniers tout en rendant visibles les luttes de pouvoir et les lignes de fractures invisibles (de l’extérieur) qui travaillent et structurent le processus complexe et non linéaire de formation d’une classe dominante.
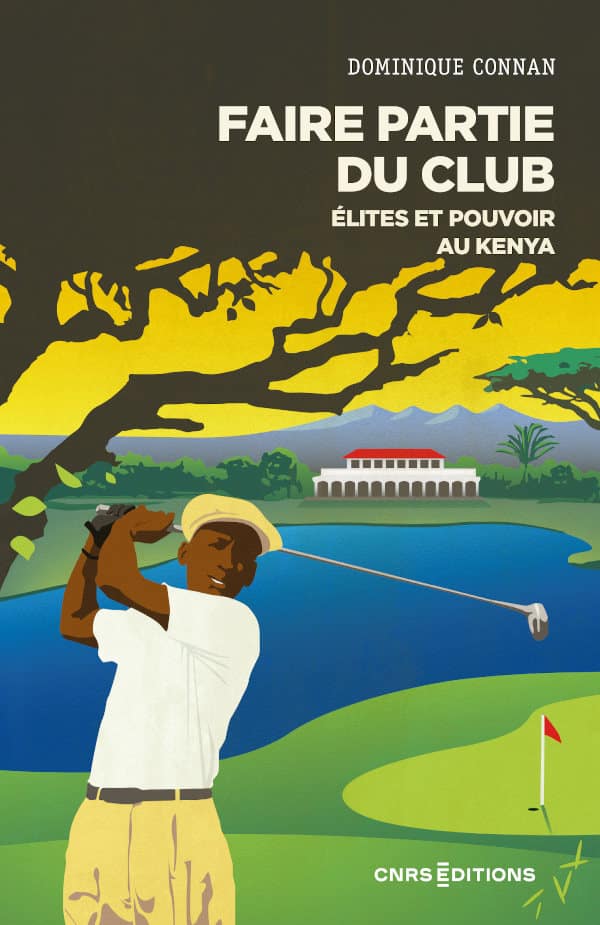
Distinctions coloniales et post-coloniales
Dans le premier chapitre, l’auteur retrace l’histoire des clubs, en soulignant leur hérédité coloniale et leur survivance après l’indépendance du pays en 1963. À l’origine, ils n’accueillaient que les différents segments de la société blanche, femmes et personnes pauvres incluses ‒ ce qui les distingue notamment des clubs de la métropole –, tout en rappelant à chacun sa place dans la hiérarchie de ce groupe racial. L’ouverture des clubs aux Africains et aux Indiens, dès les années 1950 et surtout après l’indépendance, suit le processus d’africanisation des structures de l’État (administratives, sociales et politiques). Alors que leur clientèle se diversifie et introduit dans les clubs ses propres codes de la distinction fondés sur l’appartenance ethnique ou la génération, l’éthos et le style de vie européen, auxquels aspire et s’identifie la première génération d’Africains éduqués (cadres d’entreprise, fonctionnaires ou professions libérales), demeure l’horizon des clubs. L’auteur y voit « la persistance des institutions de l’État colonial et de son économie politique » (p. 65) articulée autour de « l’étrange continuité de la coopération paradoxale entre les élites blanches et non blanches » (p. 43).
Le chapitre suivant montre comment les clubs contribuent à la formation d’une classe dominante en produisant et véhiculant de nouvelles subjectivations enracinées dans un ensemble de pratiques partagées. Le golf, en particulier, est ainsi analysé comme un espace et une pratique, investis à la fois symboliquement et matériellement par les nouvelles élites. Les années 1990 sont marquées par des mutations politiques, sociales et économiques majeures avec l’introduction du multipartisme et le démantèlement des structures paraétatiques qui font émerger de nouvelles figures de la réussite, sans pour autant fondamentalement modifier les structures de l’État et les modes d’accumulation des élites. Ces nouvelles élites globalisées souvent issues du secteur privé, plus jeunes, plus sportives ‒ dont la pratique du golf est l’un des signes de reconnaissance ‒, côtoient désormais dans les clubs, les big men de la génération précédente. Mais, comme le souligne l’auteur, ces subjectivités ne s’éliminent pas mais s’agrègent et se superposent, élargissant ainsi le répertoire des ressorts de la production de la distinction et de la hiérarchisation au sein de la classe dominante.
Plus loin, est explorée la manière dont les clubs fabriquent cette distinction. Dans le chapitre 3, Dominique Connan analyse les stratégies de distinction des clubs à partir de trois registres : les politiques d’admission et les stratégies d’adhésion et de désaffiliation de leurs membres, le capital symbolique de ces clubs qui renvoie à leur histoire plus ou moins longue et en particulier à leurs origines coloniales et raciales, et enfin leur patrimoine qui inclut à la fois les caractéristiques du bâti et de ses usages (sportifs notamment). Ces trois éléments déterminent des investissements matériels et symboliques spécifiques et nourrissent la forte hiérarchisation qui existe entre les clubs, que ce soit à Nairobi ou en région. Ces facteurs de distinction, qui mobilisent tant les registres de la tradition que ceux de la modernité, rejaillissent sur leurs membres souvent affiliés à plusieurs institutions. Ces derniers naviguent entre ces différents espaces de subjectivation dont les frontières ne sont jamais figées ni fermées. A l’instar des styles architecturaux ou décoratifs, illustrés par la riche iconographie de l’ouvrage, c’est l’hybridation qui prévaut encore en matière de distinction.
Si les membres de la classe dominante circulent entre ces différents espaces et ces différents registres par le jeu de leurs affiliations multiples, reste que les hiérarchies sont clairement établies à l’intérieur des clubs. Dans le chapitre 4, Dominique Connan montre, à travers des exemples précis et vivants, comment la structuration et l’usage social des espaces organisent la différence. La manière dont les différents groupes occupent les espaces des clubs, l’endroit où les membres s’asseyent, leur participation à certaines activités ou encore les moments où ils fréquentent les clubs, institutionnalisent les différences de race, d’éducation, d’appartenance ethnique, de genre ou de génération. Comme le souligne l’auteur, ces usages différenciés apparaissent comme les déclinaisons d’un style de vie commun permettant « la réalisation d’un ‘englobement des contraires’ élitaires au principe de leur collusion paradoxale » (p. 171).
Dans le dernier chapitre, l’auteur s’intéresse à la production bureaucratique de la distinction. Les règles et les conventions, qui sont au cœur du fonctionnement des clubs, permettent de faire tenir ensemble ces « habitus raciaux désaccordés » (p. 179). Derrière les règles et les règlements ‒ d’autant plus stricts que les groupes sont hétérogènes ‒ se lisent d’âpres luttes de pouvoir entre les groupes sociaux pour contrôler ces lieux et organiser leur sociabilité en fonction de leur propre imaginaire de la distinction. Car tous n’appartiennent pas au club de la même manière. Selon que l’on est membre ou employé, le contrôle des ressources matérielles et symboliques des clubs ne prend pas les mêmes formes. L’auteur souligne notamment comment la bureaucratisation et la professionnalisation grandissante de la gestion des clubs, qui participent de leur distinction, ferment à leurs employés des opportunités d’accès à leurs ressources.
Au carrefour de la classe et de la race
Au fond,l’enquête met en évidence trois éléments clés pour comprendre la structuration de la classe dominante au Kenya. Premièrement, derrière l’apparente homogénéité des façades coloniales et des pelouses parfaitement entretenues, la richesse du matériau d’enquête souligne la très grande hétérogénéité de la classe dominante aux identifications multiples, fondées à la fois sur la race, le capital foncier, les ressources matérielles et symboliques, l’ethnie, les pratiques sportives, le genre, les générations, les trajectoires, scolaires, sociales et politiques. Ces « dominants désunis » (titre du chapitre 4) mobilisent des imaginaires et des régimes d’accumulation et de légitimation, parfois concurrents, mais qui s’entremêlent plus qu’ils ne s’abolissent les uns les autres. Les clubs sont précisément les lieux de cette intrication qui rend impossible toute forme de désencastrement de la classe dominante. En rendant ainsi lisible la complexité du processus de fabrication d’une classe dominante par feuilletage , Dominique Connan bouscule le modèle classique « d’assimilation réciproque des élites » mis en évidence par Jean François Bayart.
Jean-François Bayart, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, 1989, pp. 193-226.
Deuxièmement, la permanence de l’inscription des clubs dans l’espace social et politique du Kenya, depuis le début de la colonisation, permet de lire les continuités de la construction de l’État. Malgré l’ampleur de leur transformation, les clubs sont le produit d’une histoire longue dont les trajectoires suivent les changements d’ordre (colonial et post-colonial) et de régimes politiques. Les ressorts de la distinction ont évolué au fil du temps sous l’effet des transformations sociales et politiques du pays, mais à chaque période correspond un type d’homme dont l’habitus s’incarne dans l’usage qui est fait de ces lieux. Du fermier blanc au golfeur, les clubs donnent à voir la sédimentation de ces « futurs antérieurs » (p. 299) qui correspondent à des projets politiques et des visions de la société, sans cesse réinventés. Microcosmes de la fabrique politique du pays, les clubs sont les lieux où se jouent les modernisations conservatrices, une constante de la trajectoire de l’État au Kenya, car c’est là que se conservent et peuvent converser tous ces imaginaires désaccordés.
Enfin, parmi les répertoires de la distinction, celui de la race occupe une place prééminente dans l’histoire et la trajectoire contemporaine des clubs. L’enquête souligne en effet à quel point « le racisme est constitutif de la sociabilité des clubs » (p. 181) qui puise ses racines dans les imaginaires coloniaux racistes et les styles de vies et préjugés qui y sont attachés. Si tous les groupes de population peuvent s’identifier à la classe dominante, tous n’y occupent pas la même place, comme le rappellent les propos ouvertement racistes des membres de certains clubs les plus prestigieux, rapportés par l’auteur. Si les Blancs du Kenya ne contrôlent plus les clubs, où ils sont partout minoritaires, les codes de conduite qui y prévalent, l’étiquette en d’autres termes, se réfèrent aux normes de savoir-être de ce groupe spécifique. L’assignation raciale trace une ligne de partage faussement invisible au sein des clubs, qui rend toute identification et toute forme d’assimilation impossible, proposant au mieux un partage raisonné et consenti de l’espace. Les clubs apparaissent alors comme les lieux de rencontres de la classe dominante où la rencontre n’a précisément pas lieu, puisque chacun est renvoyé à sa propre assignation raciale.
Les clubs, improbables gardiens de l’héritage de la colonisation au Kenya ?
Ces questions de l’assignation raciale et de l’imaginaire raciste entretenus par les clubs auraient mérité une plus grande attention de la part de l’auteur. L’analyse, à l’instar des clubs, donne à voir le racisme qui irrigue les clubs sans que cela ne se voie, en montrant comment leurs membres continuent de croire à ce discours raciste sans y croire, pour paraphraser la formule de Livio Boni et Sophie Mendelssohn. Si l’indépendance met fin à la domination blanche soutenue par la fiction coloniale raciste, celle-ci se poursuit derrière les grilles des clubs où les frontières de la distinction raciale semblent avoir été repoussées. Comment expliquer la continuité de cet ethos racial au-delà de la continuité des institutions coloniales ? Et pourquoi les clubs, où les Blancs sont minoritaires, continuent-ils de perpétuer la fiction coloniale du privilège blanc ? Ces questions ne font pas directement l’objet de l’ouvrage de Dominique Connan et n’enlèvent rien à l’excellente qualité de l’enquête, mais elles méritent tout de même d’être posées.
Livio Boni, Sophie Mendelsohn, La vie psychique du racisme. 1. L’empire du démenti, Paris, La Découverte, 2021, p. 157.
N’est-ce pas précisément cette sanctuarisation de la différence raciale qui donne sa spécificité aux clubs du Kenya et, peut-être par-là même, l’une des spécificités même de la fabrique de la classe dominante au Kenya ? Car, si l’on peut retrouver ces formes assumées de racisme ordinaire ailleurs en Afrique, le Kenya se distingue précisément par l’existence de ces clubs institutionalisant et prolongeant la fiction différencialiste sur laquelle s’est bâtie la domination coloniale. L’ouvrage n’offre malheureusement pas suffisamment de points de comparaisons pour permettre au lecteur de situer la trajectoire des clubs du Kenya dans un espace plus global et mieux appréhender leur spécificité.
Plus largement, en continuant de nourrir un imaginaire collectif raciste, qui s’enracine dans un discours différencialiste précisément mis en scène dans les usages différenciés de ces espaces pourtant partagés mais également par l’adhésion implicite de ses membres à ses normes et à ses identifications, le fonctionnement des clubs au Kenya, tels que nous le décrit Dominique Connan, offre une illustration de l’inachèvement du processus de décolonisation des esprits et des imaginaires et, par là, d’un autre aspect de la permanence des structures de domination héritées de la colonisation.
Pour citer cet article
Hélène Charton, « Faire partie du club. Élites et pouvoir au Kenya, un livre de Dominique Connan », Revue Alarmer, mis en ligne le 12/11/2025, https://revue.alarmer.org/faire-partie-du-club-elites-et-pouvoir-au-kenya-un-livre-de-dominique-connan/