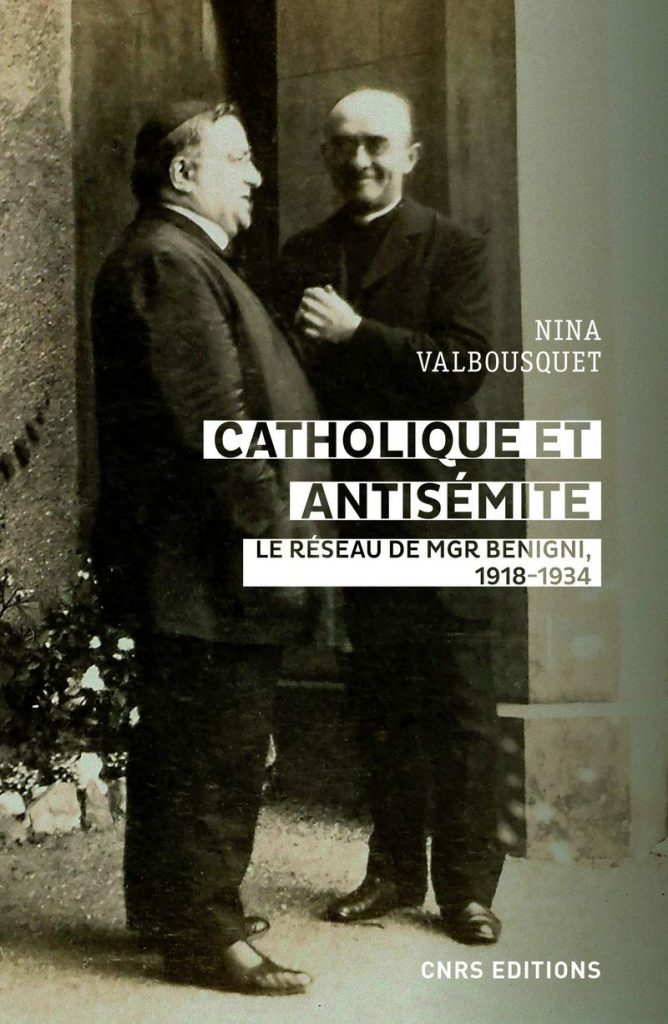
L’ombre de Barrès a sans doute trompé plus d’un regard. Non pas le Barrès du tournant du XXe siècle, empli de haine antidreyfusarde et théoricien d’un nationalisme imprégné de racialisme, mais bien l’auteur des Diverses familles spirituelles de la France, paru en 1917, où les Juifs, hier haïs, avaient gagné leur place par le sang versé. Ce revirement, significatif, n’avait en réalité pas force d’universalité. Comme si, entre l’« Affaire » et les années 1930, l’antisémitisme avait à ce point reculé qu’il en était devenu la survivance résiduelle d’un passé presque révolu.
C’est l’un des mérites du beau livre de Nina Valbousquet, membre de l’École française de Rome, déjà connue grâce à des travaux novateurs, que de nous replonger dans l’antisémitisme des années 1920, décennie plus décisive qu’on l’a longtemps pensé. L’autrice ne cède jamais à la prétention, souvent irritante, du devoir d’inventaire qui ferait de la décennie étudiée un épisode central de l’antisémitisme. Son ambition est différente, plus subtile. Un double objectif est poursuivi, documentaire d’abord : en décrivant le Sodalitium Pianum, plus connu sous le nom de Sapinière, ce réseau antisémite des catholiques intégraux dont Mgr Umberto Benigni (1862-1934), figure centrale de l’ouvrage, est l’un des animateurs zélés. Le second objectif est méthodologique : l’antisémitisme est saisi au prisme des circulations, des échanges et des transferts. Dans une approche transnationale, en d’autres termes. Les effets d’annonce ne manquent d’ordinaire pas dès qu’il s’agit de cette méthode. Rien de tel ici. S’appuyant sur les acquis récents en ce domaine, l’ouvrage subordonne toujours la méthode à la compréhension des phénomènes historiques. On ne peut que souscrire au propos suivant qui nous convainc par sa démonstration :
En adoptant un prisme uniquement national, italien ou français, l’antisémitisme des années 1920 apparaît faible et peu organisé politiquement, alimentant ainsi l’“illusion d’une disparition” de l’antisémitisme dans l’après-guerre. Une approche transnationale révèle au contraire la multiplicité des circulations antisémites au-delà des limites nationales pour cette période.
p. 11-12.
Il s’agit de la version abrégée et remaniée d’une thèse : Les réseaux transnationaux de l’antisémitisme catholique : France, Italie, 1914-1934 : Umberto Benigni et les catholiques intransigeants, sous la direction de Marie-Anne Matard-Bonucci et Marc Lazar, Institut d’Études politiques, 2016.
Notamment les liens entre focale transnationale et réexamen chronologique étudiés par HORN Gerd-Rainer et KENNEY Padraic (dir.), Transnational Moments of Change. Europe, 1945, 1968, 1989, Lanham, Rowman & Littlefield, 2004.
Même si l’étude s’inscrit dans le prolongement de tentatives déjà fructueuses et creuse des pistes quelquefois déjà esquissées – en particulier dans les travaux abondamment cités d’Émile Poulat – ce livre n’offre pas une monographie de plus sur l’antisémitisme. Il conduit le lecteur, et au-delà les chercheurs, à reconsidérer leur approche du sujet. De nombreux apports nourrissent cet ouvrage qui a conservé le précieux appareil critique de la thèse dont il est issu ; l’abondance des sources de première main ne s’en révèle que plus frappante.
Notamment Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau international antimoderniste : la « Sapinière » (1909-1912), Paris, Casterman, 1969 ; Catholicisme, démocratie et socialisme. Le mouvement catholique et Mgr Benigni de la naissance du socialisme à la victoire du fascisme, Paris, Casterman, 1977.
Nina Valbousquet retrace avec minutie le tissu étroit des relations, à géométrie et géographie variables, comme c’est le propre des réseaux, entre catholiques intégraux pour qui l’antisémitisme a constitué beaucoup plus qu’un simple ciment de circonstance. L’ouvrage de Nina Valbousquet commence par une analyse de la Sapinière (Sodalitium Pianum ou « Compagnie de Pie »), fondée par Umberto Benigni en 1909, sous le pontificat de Pie X, dont il épousait les idées. On en saisit clairement le portrait de groupe, les idées et les activités, ainsi que le déclin progressif, bien antérieur à sa dissolution en 1921. Ce réseau s’appuie sur des comités de taille réduite, dispersés en plusieurs pays (France, Belgique, Suisse, Allemagne, Empires russe et austro-hongrois) que fédèrent une Diète romaine où siègent, outre Benigni, l’abbé Maignen, membre, puis procureur général à Rome, des frères de Saint-Vincent-de Paul, « bastion du catholicisme social et de l’antilibéralisme en France » (p. 31), Mgr Speiser, le père Jules Saubat, qui s’était exilé en Italie en 1903 après les lois françaises contre les congrégations religieuses, et Gottfried Brunner, qui se spécialise dans l’enseignement et dans le travail d’archives. Les membres de la Sapinière, bien plus nombreux et souvent bien implantés dans le milieu de la « presse intégrale », s’échangent nombre d’informations et entretiennent d’étroits contacts. Le pape avait encouragé la Sapinière à mener « le bon combat de la foi, particulièrement contre les erreurs et les ruses du modernisme sous toutes ses formes ». Depuis l’avènement de Benoît XV en septembre 1914, la Sapinière était en réalité vidée de sa substance. Mais elle témoignait déjà de la grande fluidité et labilité d’un réseau à l’origine intra-ecclésial, qui se vit obligé, pour subsister, de tourner ses regards et intérêts vers l’extérieur. Chaque page de l’ouvrage ou presque foisonne de ces évolutions de rapports de force souvent instables.
Benigni avait d’ailleurs très bien compris ce qu’était un réseau et ce qu’il pouvait en tirer, à des fins de propagande antisémite notamment ; en 1922, il écrit au père dominicain espagnol Luis G. Alonso Getino :
« L’expérience faite depuis Pie X nous a montré que le mieux c’est de se contenter d’une entente amicale entre groupes, sans exiger de centralisation et des “cadres” qui ou restent sur le papier ou éclatent sous la pression de la réalité ».
p. 113.
Le nouveau réseau, qui prend en 1923 le nom d’Entente romaine de défense sociale, apparait beaucoup moins rigide dans ses structures que la Sapinière : certains de ses membres n’appartenaient pas nécessairement au clergé ni même, parfois, au catholicisme. On découvre avec intérêt les portraits d’acteurs aujourd’hui oubliés, relais parfois obscurs, aux multiples étiquettes, qui faisaient réseau, comme l’Américaine Leslie Fry ou le Russe blanc Boris Brazol, au rôle réévalué par l’auteur. Tous deux se tiennent aux avant-postes de la circulation de l’antisémitisme. Les hommes communiquaient et les écrits circulaient.
Un excellent chapitre montre toutes les ramifications à l’origine de la diffusion, dans de nombreux pays et grâce à de nombreux cercles plus ou moins liés, des Protocoles des Sages de Sion, avec comme figure de proue Mgr Ernest Jouin, proche de Benigni, qui publia la célèbre Revue internationale des sociétés secrètes, à la pointe de l’antisémitisme catholique. Archives à l’appui, l’autrice dévoile les coulisses de la fabrication du faux et celles de son usage décomplexé. L’Osservatore romano avait mis en doute, dès l’automne 1920, l’authenticité du brûlot. Cela avait-il de quoi réfréner Benigni ? « Plus j’étudie la question et plus je me persuade de la non-authenticité formelle et de l’immense valeur réelle de ce document », écrit-il à Mgr Ernest Jouin début 1921.
Les Protocoles marquèrent la transition entre deux positionnements, deux réseaux, deux moments de cette Internationale où l’on retrouvait un Benigni tantôt en première ligne, tantôt se dissimulant derrière des prête-noms comme au moment du lancement de l’Agenzia Urbs, une agence de presse catholique, fondée en 1923. À ce titre, les pages relatives aux tentatives du prélat pour bénéficier de relais dans les journaux italiens suscitent un intérêt particulier, car elles montrent le souci de conquérir et de banaliser, par la répétition, les motifs antisémites. L’esprit du temps avait changé : ne pouvaient adhérer à l’Entente nouvelle que des membres « issus d’une des nations aryennes ou aryanisées », comme l’indiquaient les statuts (p. 126). L’architecture du réseau évoluait aussi. Sa physionomie – n’était-il pas possible de la cartographier ? – impressionne par son étendue. Tous les acteurs qui l’animaient ne pesaient certes pas du même poids. L’absence de la Belgique et de la Pologne dans cette « nébuleuse », selon le terme de l’autrice fait l’objet d’une trop rapide allusion, reprise de Benigni qui considérait ces deux pays comme « pourries de démo-libéralisme » (p. 146). Sans doute y avait-il plus. Établir un réseau n’est jamais un but en soi : l’objectif, au-delà de relations qui pouvaient parfois servir, visait bien sûr une cause d’ampleur, « forger une opinion antisémite ». Nina Valbousquet reconnaît toutefois avec honnêteté que les effets nous demeurent imperceptibles, faute de sources. Se dessine d’ailleurs l’idée d’un entre-soi limité aux membres souvent respectés et influents ; Mgr Jouin n’est-il pas élevé au rang de protonotaire apostolique ad instar participantium en 1924 sur proposition de l’archevêque de Paris ?
Le lecteur n’est donc pas long à se laisser convaincre de l’existence d’« une conscience transnationale » (p. 283) qui habitait bel et bien les membres de ce réseau, soudé autour d’une Église catholique, elle-même supranationale par essence. Ce qui n’effaçait en rien les spécificités et traditions nationales propres à chacun, dont l’étude dans l’ouvrage se distingue par sa grande subtilité. Les transferts jouaient à plein. Avec Shulamit Volkov qui voit dans l’antisémitisme avant tout un « code culturel », l’autrice conclut que « plus qu’un programme politique, l’antisémitisme remplit davantage une fonction identitaire et de protestation » (p. 282). Ainsi le catholique anglais Walter McDermott refuse-t-il d’employer alors le terme d’« antisémitisme » dans ses publications car celui-ci était trop connoté négativement outre-Manche. L’antisémitisme des catholiques intégraux ne s’exportait pas sur le même schéma sous tous les cieux et se modifiait au gré des « appropriations » diverses au cœur des transferts.
VOLKOV Shulamit, « Anti-Semitism as a Cultural Code. Reflections on the History and Historiography of Antisemitism in Imperial Germany », Leo Baeck Institute Year Book, n° 23, 1978.
Dans cette perspective, voir l’étude pionnière de MATARD-BONUCCI Marie-Anne, « L’antisémitisme fasciste, un “transfert culturel” de l’Allemagne vers l’Italie ? », Relations internationales, n° 116, hiver 2003, p. 483-494.
Quel antisémitisme ce réseau reprenait-il et nourrissait-il, finalement ? Même si l’influence des historiens d’un antisémitisme en pratique et en action, comme Michael Marrus ou Valeria Galimi, se laisse aisément percevoir au gré de l’ouvrage, celui-ci ne peut faire l’économie d’une étude de discours. Une très intéressante généalogie des motifs antisémites prend forme et confirme le caractère souvent artificiel de la distinction entre antisémitisme et antijudaïsme. On attendait les catholiques intégraux versant tout entiers dans le second ; il n’en est rien. Leurs écrits, souvent de haute tenue car ils se veulent scientifiques et éloignés de toute expression vulgaire propre à l’ antisémitisme de rue » (p. 221), reprennent classiquement tous les poncifs de la haine politique et sociale « du juif », car il s’agit d’un archétype, celui du juif fantasmé et non d’individus pris dans leur complexité. La passion procède par simplification. Les convergences avec la droite réactionnaire ne manquent pas, car l’antisémitisme permet de ferrailler contre la modernité ; les révolutions seraient une œuvre juive. Tout le reste n’est que déclinaison. D’utiles développements réévaluent l’imprégnation, dès les années 1920, de l’antisémitisme en Italie – Benigni entre rapidement dans l’orbite fasciste – et aux États-Unis, où ils sont d’ordinaire sous-estimés ; l’antisionisme frénétique, dont les Protocoles portaient la trace, lui redonnait un élan certain. L’auteur insiste beaucoup sur la dimension sociale que Benigni et son réseau entendaient donner à leur lutte contre les Juifs, en minimisant plus qu’évacuant les aspects raciaux et religieux. Faut-il cependant prendre ces professions de foi à la lettre ? L’antienne sur le « Kahal », terme cher à Benigni, la redondance de la référence au Talmud par opposition au Pentateuque, part de l’ « Ancien Testament » que les catholiques ne pouvaient attaquer comme fondement du judaïsme, le projet de Mgr Jouin de traduire le Choulhan Aroukh, recueil de la Loi juive mis au point par Joseph Karo au XVIe siècle : ces indices montrent que la part proprement religieuse de cet antijudaïsme-antisémitisme n’est peut-être pas si secondaire. L’autrice rappelle que les théoriciens de cette haine intégrale s’évertuaient à nier la continuité entre judaïsme et christianisme et n’envisageaient en rien la conversion des Juifs comme souhaitable ou envisageable, si ce ne fût à très long terme. Si les réactions de Benigni et son réseau face aux manifestations de philosémitisme font l’objet de développements intéressants, on aurait aimé savoir ce qu’il en était face au thème du « judéo-christianisme » qui s’affirmait à cette époque.
La dernière partie de l’ouvrage semble ainsi manquer parfois d’armature historiographique – mais l’autrice a peut-être manqué de place – sur la théologie de la substitution, par exemple, sur l’antisémitisme politique ainsi que sur l’antisémitisme latin, alors que la latinité a aussi fourni plus d’un argument aux philosémites de l’époque. Les « tendances fascisantes » (p. 271) de la RISS, dans les années 1930, auraient gagné à être approfondis car le propos comme les archives sont neufs. Remarques moins dictées par le regret que par la curiosité. La confrontation à la littérature existante sur certains de ces aspects aurait sans doute permis de faire encore mieux ressortir la spécificité du discours antisémite des catholiques intégraux.
MARRUS Michael R., « The Theory and the Practice of Antisemitism », Commentary, n° 74/2, 1982, p. 38-42 ; GALIMI Valeria, L’antisemitismo in azione. Pratiche antiebraiche nella Francia degli anni Trenta, Milan, Unicopli, 2006.
Voir par exemple SEBBAN Joël, « La genèse de la “morale judéo-chrétienne”. Étude sur l’origine d’une expression dans le monde intellectuel français », Revue de l’Histoire des religions, n° 229, 2012, p. 85-118.
Il sera donc difficile pour tous ceux qui travailleront sur l’antisémitisme de ne pas consulter cette remarquable étude appelée à faire référence et qui montre que le « moment nazi » n’a pas inauguré la haine transnationale des Juifs. Nina Valbousquet a donc raison d’évoquer une « expérience véritablement matricielle » (p. 289), même si ses proportions paraissaient bien plus modestes que ce qui s’ensuivit. L’autrice, qui a le sens de l’archive, poursuivra à n’en pas douter, comme le laisse deviner une conclusion pleine de perspectives, sur cette voie. Un premier pas vers une « histoire mondiale » de l’antisémitisme ?
Pour citer cet article :
Jérémy Guedj, « Catholique et antisémite. Le réseau de Mgr Benigni – Rome, Europe, États-Unis, 1918-1934, un livre de Nina Valbousquet », RevueAlarmer, mis en ligne le 23 octobre 2020, https://revue.alarmer.org/catholique-et-antisemite-le-reseau-de-mgr-benigni-rome-europe-etats-unis-1918-1934-de-nina-valbousquet/