Avec Là où tout se tait, le journaliste et romancier Jean Hatzfeld poursuit sa série de livres (le sixième depuis 2000) consacrés au génocide des Tutsi du Rwanda. On y retrouve les collines de Nyamata dans le Bugesera au sud du pays, qui fut l’un des épicentres des massacres d’avril 1994, avant que les troupes du Front patriotique rwandais (FPR) ne missent fin aux tueries dans cette région au milieu du mois de mai : 51 000 morts sur les quelque 59 000 Tutsi de l’endroit, comme le rappelle l’auteur à deux reprises (p. 83 et 220).
Conformément aux usages académiques, cette recension n’indique pas de marqueur de nombre ou de genre pour les termes Hutu et Tutsi, sauf dans les citations de l’ouvrage qui en utilisent.
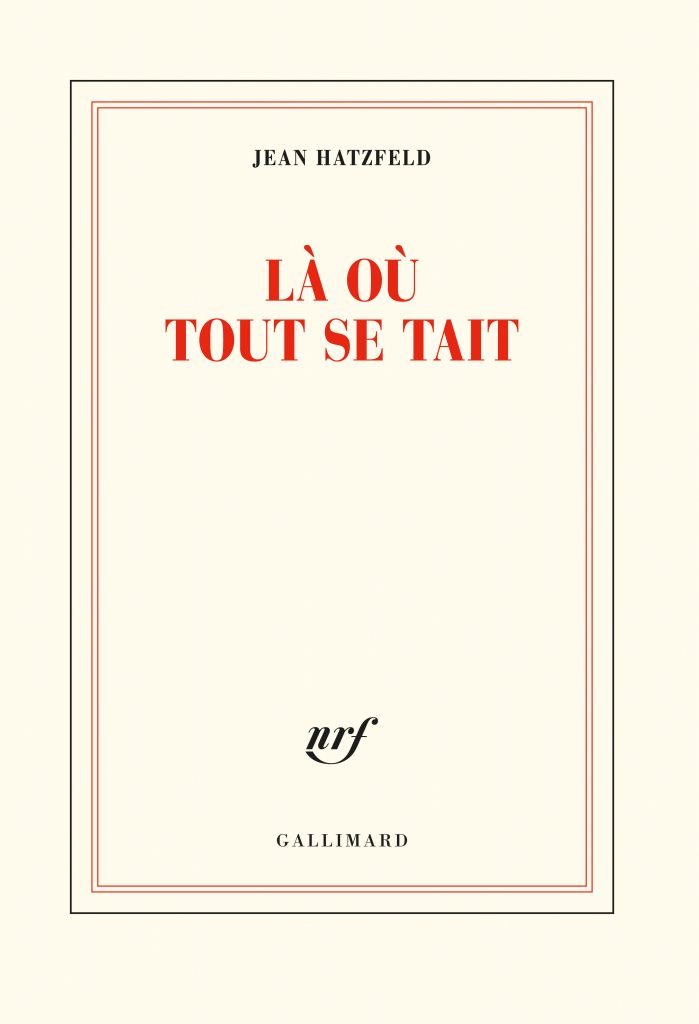
Après s’être intéressé aux récits de femmes et d’hommes rescapés, aux tueurs ou encore aux enfants de la génération d’après, son attention se porte cette fois sur les histoires de sauvetages par des Hutu, hommes et femmes également, ayant résisté, caché, protégé, parfois au péril de leurs vies, des Tutsi, de leur entourage ou non. De ces actes de sauvetage, il souligne d’emblée les avoir auparavant négligés,
Respectivement : Dans le nu de la vie. Récits des marais rwandais, Paris, Seuil, 2000 ; Une saison de machettes, Paris, Seuil, 2003 ; Un papa de sang, Paris, Gallimard, 2015.
bien qu’on ait l’intuition que [ce sont de] belle[s] histoire[s], et malgré les échos qui resurgissent à chaque fois que l’on traverse l’endroit où elle[s] [se sont] déroulée[s].
p. 13
L’ouvrage répond en quelque sorte à cette interrogation liminaire : pourquoi cette négligence, la sienne et peut-être aussi celle des communautés rescapées qu’il fréquente assidûment depuis plus de 20 ans ?
Une galerie de portraits à Nyamata
La première (et la plus longue) partie du livre – « Une gentillesse invincible » – est construite autour d’une série de neuf portraits, parfois doubles, chacun raconté par plusieurs témoins (une vingtaine dans tout l’ouvrage, présentés en quelques mots et dont certains étaient déjà présents dans les livres précédents de Jean Hatzfeld). Ces portraits donnent un aperçu de la diversité des actes de sauvetage et du sort réservé à leurs autrices et auteurs, pendant et après le génocide. Ainsi du vieil Isidore Mahandago, assassiné dès le 14 avril pour avoir exhorté un groupe de tueurs à cesser de verser le sang de leurs voisins tutsi. Ou encore d’Eustache Niyongira qui protège tout le long du génocide son épouse tutsi Édith Mukayiranga, ainsi que trois sœurs et une partie des nièces et neveux de celle-ci. À l’approche des troupes du FPR, il commence par suivre la file des fuyards, parmi lesquels nombre de génocidaires, mu notamment par une rumeur accusant ces dernières d’« oblig[er] les captifs hutus à déterrer les restes de leurs victimes pour les manger » (p. 52). Puis il revient sur sa colline, sauvé cette fois par son épouse venue le chercher jusqu’à Gikongoro plus à l’ouest. Vingt-cinq ans après, elle voit encore en lui le principal artisan de son salut et de celui de ses proches :
En dépit de son incontestable intérêt, il a été décidé de ne pas évoquer dans cette recension la seconde partie de l’ouvrage – « Le trou de chez Eustache » – assez peu reliée au reste du livre et qui revient sur les fosses et leurs exhumations successives après le génocide.
Quand même, on est entrés dans la maison au nombre d’une douzaine de Tutsis, un nombre égal en est sorti. Dieu seul décide notre venue au monde et notre départ, mais la sentinelle devant la maison, c’est Eustache.
p. 60
Une autre histoire est celle de Marcienne Nyiragashoki et Marcel Sengati, apportant des vivres aux Tutsi qui tentent d’échapper aux tueurs, en en cachant même, en même temps que leurs quatre enfants, trois garçons et une fille, participent à divers degrés au génocide. Marcienne et Marcel ont finalement été tués, lui le 15 avril, elle le 30. La rumeur affirme, sans que les procès gacaca n’aient complètement levé le voile sur cette affirmation, que le groupe ayant exécuté Marcienne dans les marais était commandé par son propre fils. Jean Hatzfeld évoque aussi le cas de François Karinganire, qui fut bourgmestre de Kanzenze (dont fait partie Nyamata) de 1980 à 1991. Il fut destitué cette année-là pour son caractère trop timoré alors que la guerre avait commencé. « D’apparence, il ressemblait aux autres hommes, sauf que lui, il ne criait pas », explique Marie-Louise Kagoyire (p. 90). Lui aussi a été tué au début du génocide avec son épouse tutsi qu’il avait refusé de livrer. On dit par ailleurs qu’il avait auparavant usé de sa position d’autorité pour signer de faux laissez-passer permettant à de jeunes hommes de rejoindre le FPR au Burundi. Plusieurs figures féminines se détachent, parmi lesquelles celle de Valérie Nyirarudodo, dont le propre neveu, Joseph-Désiré Bitero, commandait les interahamwe de la région et dont le mari tutsi et trois des huit enfants sont tués le 11 avril, premier jour du génocide à Nyamata. Infirmière et sage-femme, elle continue toutefois ses activités. Lorsque les milices investissent la maternité (où 300 personnes seront assassinées) et l’enjoignent de quitter les lieux, elle parvient à emmener avec elle, outre ses enfants survivants, Honnête, la première fille d’une femme qui venait d’accoucher d’un autre nourrisson.
Nom des tribunaux communautaires chargés de juger les crimes de génocide après 2001.
Cette date de nomination est indiquée dans : Ministère de l’Intérieur et du Développement communal, Bilan des 25 ans d’indépendance du Rwanda : 1962-1987, Kigali, juillet 1987, p. 84.
Milice du parti présidentiel. Désigne par extension l’ensemble des tueurs.
Jean Hatzfeld insiste surtout sur le silence qui entoure la mémoire de ces femmes et de ces hommes, particulièrement de celles et ceux qui ont perdu la vie en raison de leur geste. Jean-Népomucène Karangwa et Jean-Baptiste Munyankore, tous deux rescapés, expliquent par exemple que le nom d’Isidore Mahandago n’est pas même évoqué dans les commémorations et qu’aucune croix n’est plantée pour lui au cimetière. « Pourquoi ? parce qu’il ne s’est jamais trouvé une personne pour le citer respectueusement » (p. 27). Même constat pour François Karinganire (p. 100) ou encore Marcienne Nyiragashoki et Marcel Sengati, dont la fille, elle-même condamnée à cinq ans de prison, déplore qu’il n’y ait pour ses parents
plus de mémoire […]. Je ne sais pas pourquoi les autorités n’ont même pas gravé leurs noms sur le monument des victimes à la file des autres.
p. 81.
C’est d’ailleurs l’un des grands intérêts de l’ouvrage que d’interroger ce qui fonde la reconnaissance, ou plus souvent la non-reconnaissance, de ces sauveteuses et sauveteurs dans le Rwanda post-génocide.
« Les gardiens du pacte de sang »
Deux histoires singulières se détachent ici. D’abord, celle de Jean-Marie Vianney Setakwe décédé en février 2019 à l’âge de 82 ans, et qui avec sa compagne Espérance Uwizeye (laquelle est aussi la fille de sa première femme) a permis à trois jeunes Tutsi de survivre en leur indiquant un chemin pour échapper à une barrière sur la route et en les cachant dans son champ de sorgho. Pour raconter son geste, le vieil homme explique s’être surtout « écarté » du mot d’ordre partagé consistant à tuer les Tutsi : « Moi, je me suis écarté. Je me suis montré humble, mais au fond j’ai évité à pas silencieux » (p. 130).
Et d’ajouter toutefois plus loin, pour souligner le risque pris :
Moi, je n’ai tué personne, rien pillé, même une chèvre ou une tôle de secours. J’ai refusé la mort chez moi, j’ai choisi la traîtrise ethnique, j’ai proposé une gentillesse secourable dans un moment risquant sans balancer. Risquant comment ? tu cachais un Tutsi dans tes sorghos, tu méritais un coup de machette. C’était péché capital.
p. 134-135.
Pour cet acte de « traîtrise ethnique », lorsqu’il suit la file de celles et ceux qui fuient l’arrivée du FPR en mai et reste deux ans dans les camps du Masisi à l’Est de la République Démocratique du Congo, il doit encore garder un silence absolu sur son geste : « est-ce que les interahamwe n’avaient pas emporté dans le camp leurs menaces avec leurs fautes ? » (p. 133)
L’autre histoire singulière est celle de Silas Ntamfurayishyari. Ancien militaire (il a à ce titre participé aux combats contre le FPR dans le Nord-Est en 1991 et 1992), il s’est distingué, avec un collègue affecté comme lui au camp militaire de Gako, à proximité de Nyamata, pour avoir fait passer la frontière burundaise, située à une vingtaine de kilomètres, à plusieurs groupes de Tutsi. Démasqué et menacé, Silas Ntamfurayishyari finit par fuir à son tour au Burundi. Revenu au Rwanda, et ayant rejoint l’armée du FPR, il épouse Providence Mukagashugi, l’une des femmes qu’il a sauvées et avec qui, nous dit celle-ci, il avait déjà des projets de mariage avant le génocide. Le sauvetage n’est ici pas complètement fortuit, ainsi que le signale Providence Mukagashugi :
Anaclet Ngororabanda, décédé pendant la guerre des abacengezi (le terme abacengezi, « les infiltrés », est le nom donné aux forces rebelles pendant la guerre de 1997-1998 au nord du pays).
Non, Silas ne m’a pas trouvée par hasard comme il vous l’a dit. […] On se connaissait de façon qu’il se sentait trop bousculé de me savoir promise à la mort. Ça m’a honorée.
p. 167.
Et Jean Hatzfeld de s’interroger, sans amoindrir pour autant les gestes salvateurs :
Est-ce qu’il est pour autant un Juste au strict sens du mot, une personne ayant risqué sa vie pour sauver un Tutsi sans aucun intérêt ni contrepartie d’aucune sorte ? mystère, et ce mystère pourrait s’appeler l’amour.
p. 151
Si les histoires de Silas Ntamfurayishyari et Jean-Marie Vianney Setakwe se détachent, c’est parce qu’elles sont les deux seules de l’ouvrage à bénéficier d’une véritable reconnaissance officielle. Silas Ntamfurayishyari reçoit une première distinction de l’ association de rescapé·e·s Ibuka à Kigali en 2007. Honoré également par l’Association des veuves du génocide (Avega), son statut de « figure exemplaire » lui fait bénéficier d’une forme de « notabilité » (p. 150-151). Militaire, il est ainsi sélectionné pour faire partie d’un détachement de Casques bleus rwandais au Soudan. Surtout, en 2015, il est reconnu à Kigali comme l’un des 34 abarinzi b’igihango (« les gardiens du pacte de sang ») à l’échelle nationale, le seul de tout le Bugesera. Ce titre, octroyé par la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation, est une sorte de médaille qui distingue celles et ceux que l’institut israélien pour la mémoire de la Shoah Yad Vashem qualifierait de Justes, à ceci près que les personnalités vivantes ainsi honorées au Rwanda se distinguent autant par leurs actes de sauvetage que par leur participation aux procédures judiciaires gacaca et aux politiques de réconciliation édictées par l’État. Jean Hatzfeld signale en effet que Silas Ntamfurayishyari témoigne beaucoup, dans les commémorations, à l’invitation de communautés religieuses ou d’établissements scolaires, pour des journalistes ou des chercheuses et chercheurs aussi, suggérant que ses témoignages auraient fini par s’uniformiser au gré de leurs répétitions (p. 151).
Le Rwanda est un important contributeur aux opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations unies.
Six autres ont été nommé·e·s depuis, ce qui porte à quarante le nombre total d’abarinzi b’igihango reconnu·e·s nationalement.
Jean Hatzfeld ne précise pas toutefois que parmi les personnalités mentionnées dans la liste des abarinzi b’igihango figurent certaines qui ont payé de leur vie leurs actes de sauvetage et ne sont donc de facto pas honorées pour leur posture de « modèles actifs […] au sein de la communauté hutue » post-génocide (p. 127). Pour un aperçu, voir ce rapport de la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation, Abarinzi b’igihango mu Rwanda, Kigali, 2018.
Jean-Marie Vianney Setakwe figure également sur une liste d’abarinzi b’igihango, mais établie cette fois à une échelle locale. L’initiative est venue d’un des jeunes garçons qu’il a sauvés en 1994, devenu depuis conseiller du FPR. Si Jean-Marie Vianney Setakwe a bénéficié lui aussi d’une cérémonie officielle en 2016, il souligne qu’on ne lui a « pas offert de vache quand même », tout au plus quelques bières pour célébrer (p. 134-135). À sa mort en 2019, aucune personnalité d’Ibuka Nyamata ou du service de l’unité et de la réconciliation n’est venue à l’enterrement. Seul Jean-Baptiste Munyankore, représentant local d’Ibuka, a dit quelques mots : « il nous a aimés, nous l’avons aimé, il aimait l’amitié » (p. 137). Cette reconnaissance reste toutefois plus importante que celle dévolue à sa compagne Espérance Uwizeye, qui l’avait quitté entretemps et dont lui-même omettait dans ses témoignages de souligner le rôle dans le sauvetage des trois Tutsi. « J’ai laissé. De toute façon, une médaille sans la somme, je m’en fiche », affirme-t-elle (p. 147). Par petites touches, et sans jamais forcer le trait ni l’analyse, Jean Hatzfeld nous donne ainsi à voir ce qui pourrait presque constituer une hiérarchie de la reconnaissance parmi les sauveteuses et sauveteurs.
Ressorts sociaux et individuels des actes de sauvetage
À la lecture transversale de ces neuf portraits, deux questions surgissent tout particulièrement : pourquoi ces – si rares – actes de sauvetage ? Et pourquoi leur faible place dans les mémoires et commémorations locales, en dehors de ces deux cas singuliers ? À la première de ces deux questions, Jean Hatzfeld ne propose pas de réponse simple et univoque. Faut-il le suivre lorsqu’il explique dans un rare moment d’analyse totalisante que :
la frénésie des tueries a empêché l’implantation normalement hésitante et empirique de réseaux de sauvetage. Elle a privé les esprits de moments pour se ressaisir, de plages de flottement nécessaires pour se retrouver soi-même face à la tourmente, elle a détruit les espaces de repli où des personnalités moins soumises à la force du communautarisme ethnique auraient pu se sonder […] ; des moments où des personnes indécises auraient pu déambuler, se chercher, se tester et trouver du courage avant d’affermir leurs décisions, parfois tâtonner avant de faire le choix de s’écarter du conformisme ambiant ?
p. 85-86
Peut-être pas puisque l’on saisit en creux combien les actes de sauvetage s’inscrivent au contraire parfois dans des parcours de vie. Avant 1959, Isidore Mahandago avait été au service du chef Athanase Kanimba, dans le territoire de Gitarama, et continuait manifestement à y voir une marque d’honneur et de fierté. Marcienne Nyiragashoki et Marcel Sengati sont vantés par celles et ceux qu’ils ont sauvés pour leur gentillesse de longue date, avec les familles hutu comme avec les familles tutsi. Quant à Valérie Nyirarudodo, originaire d’une famille hutu du Bugesera, n’avait-elle pas épousé un homme issu d’une famille tutsie exilée depuis le nord au moment de la révolution et de l’indépendance, « sans se préoccuper des tensions familiales que leurs noces allaient provoquer » (p. 104) ? Il serait vain bien sûr de prétendre dresser un fil direct entre ces liens antérieurs – qui témoignent surtout de l’interpénétration des Hutu et des Tutsi avant le génocide – et les actes de sauvetage. Au moins peut-on postuler que ces interconnaissances ont conditionné autant la réussite des massacres que les quelques possibilités de survie.
Sur l’acte de sauvetage lui-même et les ressorts de ce qui constitue une décision individuelle – souvent isolée et porteuses de risques, ainsi qu’en témoignent dans l’ouvrage les exemples de sauveteuses et sauveteurs assassinés pendant le génocide – celles et ceux qui ont survécu donnent quelques éléments pour expliquer leur geste. Dieu et la foi sont souvent présents, ou du moins quelque chose relevant du mystique, comme chez Valérie Nyirarudodo expliquant avoir entendu une voix, celle de la marraine de sa mère, l’enjoignant à sauver Honnête (p. 112). Et d’ajouter plus loin :
Je ne manque pas de remercier Dieu de m’avoir épaulée. Je lui suis reconnaissante car il m’a créée comme je suis, et qu’il m’a donné un cœur compatissant au bon moment et le courage pour ne pas renoncer
p. 121.
Dieu et la foi sont aussi évoqués par Silas Ntamfurayishyari mais il ajoute :
celui qui a choisi et décidé, c’est bien moi, grâce au bon exemple observé dans ma famille. […] J’ai ramassé de la volonté pour contrer de mauvaises tentations. Comme quoi ? comme la résignation, ou la prudence ou la peur. Dans une situation sanglante, la volonté surpasse la foi religieuse et l’instruction.
p. 161.
Cette insistance sur la volonté et l’autonomie d’un acte de courage fait écho à la place occupée par Silas Ntamfurayishyari, « figure exemplaire » (p. 150), dans les discours et politiques de réconciliation dont l’un des ressorts est de mettre en exergue des parcours individuels ayant transcendé la frontière ethnique durant le génocide. Cette remarque n’oblitère pas la possibilité d’actes de pure bonté, comme celui de Joseph Nsengiyomva, qui protégea deux familles tout au long des massacres et qui constitue le dernier des neuf portraits, comme s’il fallait que tout s’achève sur cette figure morale d’un homme de bien :
Il possédait un cœur gentil. Il a écouté son courage qui ne manquait pas, il a donné la priorité à sa pitié ou sa compassion envers des personnes vulnérables avec qui il vivait en harmonie. Pour lui, ça été nécessaire de les sauver, de protéger du vivant.
p. 178.
Les silences de la mémoire
Quant à la seconde question posée en creux par Jean Hatzfeld – pourquoi la si faible place des actes de sauvetage dans les mémoires et commémorations locales, en dehors des cas singuliers de Jean-Marie Vianney Setakwe et Silas Ntamfurayishyari – ce sont encore les témoins interrogés qui donnent quelques pistes. Sur celles et ceux qui sont morts d’abord, plusieurs soulignent ce qui semble être un doute tenace quant à leur action. Ainsi cette remarque d’Innocent Rwililiza :
Ces Justes, tu verras qu’ils sont difficiles à décrire. Les morts, eux seuls savent. S’ils ressuscitaient, ils pourraient bien pointer un doigt accusateur sur ces Justes, parce qu’ils ont vu plus que nous. Est-ce que nous pouvons ne pas ressentir de soupçons sur tout le monde ?
p. 30.
Ces doutes font écho à la frontière parfois ténue qui sépare certains actes de sauvetage et des formes de participation au génocide. Édith Mukayiranga ne dit-elle pas elle-même avoir douté, avec ses sœurs, de son mari Eustache
parce qu’il se montrait tremblant timoré. […] On se disait que lui aussi pouvait nous délaisser. On y pensait entre nous sans savoir en parler.
p. 51.
De même, Valérie Nyirarudodo, cachant Honnête dans sa famille parmi laquelle se trouvent des génocidaires, n’évoque-t-elle pas son frère Théophraste, « grand tueur » mais cachant un père et son enfant avant que ceux-ci ne soient découverts et tués par son propre fils (p. 112-113) ?
Plus généralement, les témoignages de rescapé·e·s insistent sur ce qui semble être une méfiance partagée à l’encontre des Hutu après le génocide. Les exemples en ce sens abondent : rejet de la présence d’Eustache Niyongira dans les cabarets fréquentés par les rescapés en dépit de son rôle positif (p. 58-59), médisances douze ans durant de la famille de Providence Mukagashugi lorsque celle-ci épouse Silas Ntamfurayishyari, pourtant son sauveur (p. 166-167)… Quant à Jean-Baptiste Munyankore, qui avoue ne pas pouvoir « inviter un Hutu dans les souvenirs de deuil », il souligne le décalage entre la politique nationale de réconciliation – à laquelle il se plie volontiers – et le refus d’évoquer les « Hutus valeureux » morts en 1994 :
On a accepté de mélanger les vivants tutsis et hutus pour la réconciliation nationale ; moi-même je suis très volontaire en réunions de pardon. Les morts, toutefois, c’est grand-chose. On ne peut s’amuser à du cache-cache avec eux. On se dit : si les tueurs refusent de prononcer à haute voix le nom de leurs victimes, pourquoi on vanterait le nom de leurs Hutus valeureux ? C’est de la malice. On a commencé à récompenser les vivants méritants, parce que nos encadreurs l’ont demandé, pas les morts. Au fond, c’est une négligence ethnique de notre part.
p. 28-29.
En creux, Jean Hatzfeld poste la question des réalités de la réconciliation, politique publique sans doute essentielle, mais qui ne préjuge pas des relations sociales effectives sur les collines. Cette remarque d’un autre rescapé heurte ainsi les mesures – très positives – de la réconciliation évaluées au Rwanda par un baromètre mis en place en 2010 :
Commission nationale pour l’unité et la réconciliation, Rwanda Reconciliation Barometer, Kigali, 2010 et 2015.
Pas un [Hutu] ne s’est présenté secourable lorsque je galopais à perdre le souffle dans la forêt pour sauver chaque minute de vie. Raison pour laquelle je n’ai jamais cherché la personne que l’on pourrait dire méritante. Si on s’en fiche, c’est qu’il reste un peu de haine en profondeur..
p. 29
Impossible dès lors de ne pas citer cette phrase qui clôt l’ouvrage : « De toute façon, aucun pardon n’est possible » (p. 212).
Conclusion
En dépit de l’intérêt du livre, quelques réserves peuvent être formulées. On en sait assez peu d’abord sur les conditions de l’enquête de Jean Hatzfeld – de sa « recherche » comme il le dit lui-même (p. 173) – et on doit se contenter de quelques allusions fugaces sur la manière dont il travaille à Nyamata dans les pages liminaires à chacun des portraits. Ici, on comprend que les entretiens ont lieu dans un cabaret (p. 34), là on voit furtivement apparaître un traducteur, au demeurant jamais nommé (p. 126). L’absence d’informations sur les méthodes et les aides à la traduction embarrasse d’autant plus que Jean Hatzfeld use – et abuse parfois – de néologismes et de structures lexicales ou grammaticales qui confinent à l’exotisme, sans qu’il ne justifie a minima ces choix par des traductions littérales depuis le kinyarwanda, dont la richesse rend effectivement possible une inventivité linguistique sans doute plus importante que le français. Le cas le plus frappant est celui du terme « avoisinant » (pourquoi ne pas dire voisin ?) que l’auteur utilise depuis Dans le nu de la vie, mais l’on pourrait citer de nombreux autres exemples tels le verbe « ronder » (p. 40) ou l’expression « le grand nombre n’est pas très tueur » (p. 155). Jean Hatzfeld enfin semble faire assez peu de cas de la recherche académique et des savoirs accumulés sur le génocide des Tutsi, ce qui n’est pas gênant en soi mais suscite l’embarras dans des repères chronologiques (p. 218-221) où il continue à qualifier le FPR de « troupes tutsies » (la composition du mouvement est en réalité infiniment plus complexe) et donne un nombre très largement sous-estimé de jugements gacaca sur l’ensemble du territoire – 22 609 quand il faut les compter par centaines de milliers, voire pas loin de deux millions selon les sources à disposition.
Ces critiques ont déjà été formulées, par exemple par Catherine Coquio dans Rwanda. Le réel et les récits, Paris, Belin, 2004.
Reste que Là où tout se tait, comme l’ensemble de l’œuvre de Jean Hatzfeld, n’est pas un livre de sciences sociales et ne saurait être lu comme tel. À travers une galerie de portraits, on a donc à disposition un très beau livre, tant sur les sauvetages (sujet au demeurant peu traité par l’historiographie) que sur la survie en général, faite de hasards, de transactions financières et matérielles, et de rencontres fortuites. Valérie Nyirarudodo ne dit d’ailleurs pas autre chose : « La bonté, rien de plus fragile » (p. 124).
En français, on signale notamment les chapitres de Lee Ann Fujii, Charles Kabwete Mulinda, Scott Straus et Emmanuel Viret dans : Claire Andrieu, Sarah Gensburger et Jacques Sémelin (dir.), La Résistance aux génocides. De la pluralité des actes de sauvetage, Paris, Presses de Sciences Po, 2008. Ou encore : Valérie Rosoux, « La figure du Juste au Rwanda : héros, traître ou inconnu ? », Érès. Revue internationale des sciences sociales, n° 189, 2006, p. 525-533.
Pour citer l’article
Florent Piton, « Là où tout se tait, un livre de Jean Hatzfeld », RevueAlarmer, mis en ligne le 4 mars 2021, https://revue.alarmer.org/la-ou-tout-se-tait-un-livre-de-jean-hatzfeld/