Victor Klemperer (1881-1960) a publié en 1947 un livre fondamental sur la langue nazie, Lingua Tertii Imperii ou LTI. La langue du Troisième Reich. On sait que ce livre est le fruit de l’observation patiente des faits de langue de la part d’un homme dont c’était le métier – il était professeur de philologie romane – et qui était visé, dans l’exercice public de son métier et dans sa vie tout entière, par la politique nazie. Interdit d’enseigner et de publier, Klemperer « ne cessa pas (…) de lire son temps et l’espace – politique, social, journalistique, quotidien, fantasmatique – de sa propre mise au ban », écrit Georges Didi-Huberman (p. 26).
Victor Klemperer était un homme patient, méticuleux et déterminé. Comme beaucoup d’intellectuels de son temps, il tenait un journal, et ce sont des observations consignées entre la montée du nazisme et la fin de la guerre qu’il a tiré la matière de LTI. Et comme dans bien des journaux personnels de cette période, le sens de son geste d’écriture a progressivement changé face aux persécutions et sous la menace constante de la mort. Parce que cette menace pesait aussi sur ce qui était au cœur même de sa vie – la parole que l’on observe et l’écriture qui rend compte de cette observation –, parce que la menace sur la vie était aussi une menace sur l’écriture comme activité et sur ses produits (les manuscrits, eux-mêmes menacés de confiscation et de destruction), l’écriture est devenue l’enjeu même de la survie. De diariste, mémorialiste de lui-même, Klemperer s’est fait témoin pour l’histoire, et son journal est devenu l’espace de fabrique et d’inscription de ce témoignage.
C’est l’entrée du 11 juin 1942 qui donne son titre et son exergue au livre de Georges Didi-Huberman : « (…) le journal, je vais le poursuivre, coûte que coûte. Je veux porter témoignage jusqu’au bout ». De ce dépôt testimonial, Victor Klemperer, survivant, a donc fait la base d’une œuvre savante singulière – « un monument historique et philologique » (p. 27), qu’on pourrait aussi considérer comme une grande œuvre d’anthropologie linguistique.
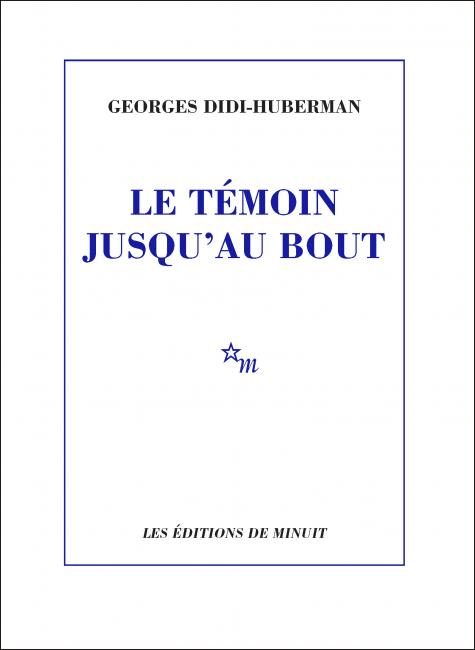
« Ecouter la langue immonde »
Georges Didi-Huberman a lu LTI et le Journal de Klemperer, publié en Allemagne en 1995, trente-cinq ans après la mort de son auteur et traduit en France en 2000. « Il faut un certain courage pour affronter toute l’intensité de ce texte », concède Didi-Huberman à propos du Journal. L’intensité, la densité et la longueur, puisque les deux tomes publiés au Seuil (1933-1941 et 1942-1945) représentent près de 2000 pages : « j’avais baissé les bras devant la myriade de ces moments cruciaux, petits et grands » (p. 52). Et puis il a repris la lecture, et a entrepris de la faire partager à ses propres lecteurs. La question du partage, et du partageable, est, au juste, au cœur de l’entreprise de Klemperer lue et partagée par Didi-Huberman. D’emblée, il est question de partage et d’émotions (p. 9-12) : des émotions qui nous incitent à sortir de nous-mêmes, à partager, à accepter l’autre. « Partager, regarder, résister » sont les trois verbes qui caractérisent, selon Didi-Huberman, la posture et le style anti-totalitaire de Klemperer. Et le partage revient encore, en fin de parcours, quand Didi-Huberman rapproche, après d’autres, les réflexions de Klemperer de celles d’Hannah Arendt sur la résistance spirituelle au totalitarisme.
Ce qui intéresse Georges Didi-Huberman dans le Journal de Klemperer, c’est la détermination à observer, à consigner les faits « effectifs » – dans la langue, hors de la langue –, mais ce sont surtout les émotions, l’accueil du pathique et de la dimension affective de son existence. Le livre évoque donc la tyrannie affective et la politique nazie des émotions – ce monde de la disjonction affective, sans « et pourtant » ni « pourquoi » dont le philologue interroge la langue pauvre, emphatique et brutale. Klemperer intéresse donc Didi-Huberman pour la « décision critique » d’« écouter la langue immonde », pour son « style obstinément voué au partage », son humour, et surtout par sa manière de lier, dans son journal, l’observation minutieuse et inlassable des faits de langage, des faits de persécution, et l’exposition des émotions, des sentiments : une écriture des « faits d’affects », que Georges Didi-Huberman considère scrupuleusement.
Écrire les émotions
Le Témoin jusqu’au bout est une traversée et un partage de l’œuvre de Victor Klemperer, comme Éparses, en 2020, était un « voyage » dans les papiers du ghetto de Varsovie (les archives Ringelblum) . Est-ce un livre sur le témoignage ? L’attention minutieuse de Klemperer pour ses propres émotions – sa « moisson d’humeurs » quotidienne comme il l’appelle en janvier 1945 (p. 78) –, le relevé de ses états de confusion, de désorientation, de peur, d’angoisse, de détresse, de dépression…, la description de l’oppression de l’attente (le « sentiment du “combien de temps encore” », p. 82) attestent la persistance du projet diariste dans les épreuves : si Klemperer se fait aussi chroniqueur des persécutions, s’il s’accroche à son projet philologique, il n’en demeure pas moins à l’écoute des vibrations de son moi. On peut dire que la lecture de Georges Didi-Huberman fait entendre cette persistance, et montre quelle puissante ressource, spirituelle et concrète, a pu constituer le maintien d’une telle pratique en toutes circonstances. Une ressource d’opposition – continuer à écrire coûte que coûte, y compris les petites choses de cette vie de tous les jours qui n’en est plus une – et une ressource pour la réflexion – construire un lieu scripturaire en retrait (p. 130) pour continuer à observer le monde et garder, en quelque sorte, la maîtrise du temps. En ce sens, la lecture de Georges Didi-Huberman fait apparaître Klemperer en témoin de sa propre écriture, d’une écriture prise dans une historicité propre (celle de la pratique du journal intime depuis la fin du XVIIIe siècle), une écriture que les événements affectent et qui est mobilisée, dans son expressivité spécifique, dans cette historicité longue, pour y faire face.
Georges Didi-Huberman, Éparses. Voyage dans les papiers du ghetto de Varsovie, Paris, Éditions de Minuit, 2020.
De ce fait, Le Témoin jusqu’au bout est bien davantage un livre qui traverse la question – historique – de l’écriture de témoignage, qu’un livre sur le témoignage. Il constitue Klemperer en chroniqueur des « faits, des actes, des exactions » mais aussi en archiviste de ses émotions, jusqu’à lui prêter cette intention, qui au demeurant ne peut être que postulée : « Mais pourquoi fallait-il témoigner de ses émotions ? (…) La réponse implicite de Klemperer, qui n’aura eu ni le temps ni l’envie de faire une quelconque théorie psychologique, est que les émotions méritent d’être rappelées au même titre que tous les autres documents pour l’histoire » (p. 77). À l’historien ou au théoricien des émotions, Klemperer, le philologue affecté, aura donc préparé une documentation, une archive d’états affectifs, de « faits d’affects ».
Fait d’histoire et document pour l’histoire
La lecture de Didi-Hubermann souligne donc l’articulation intime, chez Klemperer, d’un projet intellectuel et l’exigence d’un « partage de la sensibilité ». Mais Le Témoin jusqu’au bout semble parfois tiraillé entre le désir de rendre compte de la singularité de Klemperer – analyste d’une langue totalitaire et chroniqueur des fluctuations et des partages de son moi – et l’esquisse d’une double montée en généralité. Tout d’abord le livre semble tendre vers ce qu’on pourrait appeler une théorie du témoin, ou une théorisation éthique du témoignage comme écriture sensible contre « la tyrannie politique » (p. 151), dont Klemperer serait le modèle, sans pour autant que son entreprise testimoniale et philologique soit confrontée à d’autres projets comparables. On pense au « dictionnaire » des mots nazis entrepris par Nachman Blumental (1902–1983), Slowa niewinne [Les mots innocents], dont seul le premier volume, couvrant les lettres A à I, fut publié en Pologne en 1947. Blumental était un philologue juif polonais, il avait survécu en Union soviétique ; revenu en Pologne à la fin de la guerre, il n’eut de cesse d’étudier les documents nazis pour dévoiler le fonctionnement pervers de la langue. Son travail témoigne aussi de la tension entre l’implication émue d’un homme qui avait perdu tous les siens et la mise à distance savante. On souhaiterait à Blumental, dont les archives ont récemment été déposées au YIVO à New York, un lecteur partageur, qui permettrait d’articuler au-delà des cas particuliers l’implication affective et la mise à distance chez tous les savants survivants, de Klemperer à Blumental en passant par H. G. Adler, le grand historien de Theresienstadt, où il avait été détenu.
Nachman Blumental, Słowa niewinne, Commission centrale historique juive de Pologne, 1947. Voir Karolina Szymaniak « “No Innocent Words”: Nachman Blumental’s Metaphorology Project and the Cultural History of the Holocaust », East European Jewish Affairs, n°51:1, p. 106-126, DOI: 10.1080/13501674.2021.1956180
https://yivo.org/Archive-Blumental et sur l’expérience vécue de Nachman Blumental : Katrin Stoll, « Traces of the Holocaust in Nachman Blumental’s Archive: The Murder of Maria and Ariel Blumental in Wielopole Skrzyńskie During the German Occupation », Yad Vashem studies, 49/2 (2021)
Theresienstadt 1941–1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft, Tübingen, J.C.B Mohr, 1955. Adler a aussi cherché à partager son expérience personnelle dans un roman : Un voyage (1960), trad. fr., Christian Bourgois, 2001.
L’autre proposition généraliste du livre de Georges Didi-Huberman se lit sous la forme d’une explicitation de ce qui serait resté à l’état « implicite » dans les conceptions de Klemperer : cette idée que « les émotions méritent d’être rappelées au même titre que tous les autres documents pour l’histoire » (p. 77), ou, pour reprendre la quatrième de couverture, que les « émotions constituent en elles-mêmes des faits d’histoire, voire des gestes politiques ». Et c’est ici que la netteté du propos de Georges Didi-Huberman se dilue quelque peu : entre le « fait d’histoire » et le « document pour l’histoire », il y a l’épaisseur de l’acte qui fait écriture de l’expérience vécue ; il y a le mouvement du diariste qui, face à la persécution et à la souffrance collective, comprend et constitue son écriture personnelle en document pour l’histoire. Et Klemperer, ici, n’est pas singulier : qu’on pense, parmi tant d’autres, aux explorations affectives d’Hélène Berr à Paris durant l’automne 1943, à son « phrasé d’affect », pour reprendre l’expression proposée par Georges Didi-Huberman, qui articule constamment la chronique de la « souffrance du monde », les menus événements de la vie quotidienne et la recherche de caractérisation des états fluctuants de son moi : anxiété, inquiétude, tourments, exaltation, dilatation du moi face à la beauté d’un texte, d’une musique, d’un paysage. Chez elle aussi se formule la tension entre le nécessaire retrait du monde – « singleness of mind », dit-elle – et le rappel de la « Mort qui pleut sur le monde » ; chez elle aussi, la volonté de témoigner pour l’histoire se constitue au cœur d’une pratique diariste préexistante et, pour elle aussi, l’entreprise d’ « écrire toute la réalité et les choses tragiques que nous vivons en leur donnant toute leur gravité nue » apparaît comme « une tâche difficile et qui exige un effort constant ». Ce qui est « fait d’histoire », ici, ce n’est pas l’émotion, mais la mobilisation d’une écriture pour faire-témoignage de cette émotion ; ce qui est « document » pour l’histoire, ce sont les ressources intellectuelles et scripturaires mobilisées (la philologie chez Klemperer, la littérature chez Berr, « l’effort constant » de la pratique diariste chez l’un et l’autre) et la manière de les mobiliser pour ce faire-témoignage.
Etudiés par Alessandra Garbarini dans Numbered Days. Diaries and the Holocaust, New Haven, Yale University Press, 2006.
Hélène Berr, Journal, (Tallandier, 2008), Seuil « Points », 2009, p. 247.
Ibidem, p. 184.
Pour citer cet article
Judith Lyon-Caen, « Le Témoin jusqu’au bout. Une lecture de Victor Klemperer, un essai de Georges Didi-Huberman », RevueAlarmer, mis en ligne le 21 juin 2022, https://revue.alarmer.org/le-temoin-jusquau-bout-une-lecture-de-victor-klemperer-un-essai-de-georges-didi-huberman/