La monographie Vainqueurs et invaincus, divisée en trois parties et treize chapitres, vise à comprendre le rôle que les présidents étatsuniens successifs ont joué dans le traitement de la « question indienne » – terme utilisé tout au long de l’histoire étatsunienne par les acteurs et commentateurs de la politique fédérale indienne, souvent interchangeable avec le terme de « problème indien » et critiqué pour l’essentialisation des affaires indiennes, comme une anomalie, qu’il semble impliquer – et à mieux cerner l’importance qu’ont eu leurs convictions personnelles à l’égard des autochtones tout au long de l’histoire des États-Unis.
Le travail que l’ethno-historienne Joëlle Rostkowski nous propose est une histoire « par le haut », ou top-down, qui, nous le verrons, a ses limites. Néanmoins, le choix de se focaliser sur les présidents étatsuniens reste original, la plupart des ouvrages sur la question s’étant concentrés sur l’approche du gouvernement fédéral dans son ensemble, sur des périodes bien restreintes, ou plus récemment, du point de vue des sources autochtones. Peu de présidents ont eu un impact direct sur les affaires indiennes (à l’exception peut-être d’Andrew Jackson ou de Ulysses S. Grant), mais les choix qu’ils firent, notamment aux postes de Commissaire des Affaires indiennes ou Secrétaire de l’Intérieur, eurent une influence notable sur l’évolution des relations entre allochtones et autochtones. L’autrice offre ainsi aux lecteurs et lectrices un ouvrage complet et accessible au néophyte qui souhaite en apprendre plus sur les grandes étapes de l’histoire des relations entre gouvernement fédéral étatsunien et nations autochtones.
On peut ici citer les travaux de Francis Paul Prucha, notamment The Great Father: the United States Government and the American Indians, Lincoln, University of Nebraska Press, 1986.
On peut citer ici Roberta Ulrich, American Indian Nations from Termination to Restoration, 1953-2006 (Lincoln: University of Nebraska Press, 2010).
Par exemple, Ned Blackhawk, The Rediscovery of America: Native Peoples and the Unmaking of U.S. History (New Haven: Yale University Press, 2023); David E. Wilkins et Heidi Kiiwetinepinesiik Stark, American Indian Politics and the American Political System (New York: Rowman and Littlefield Publishers, 2017).
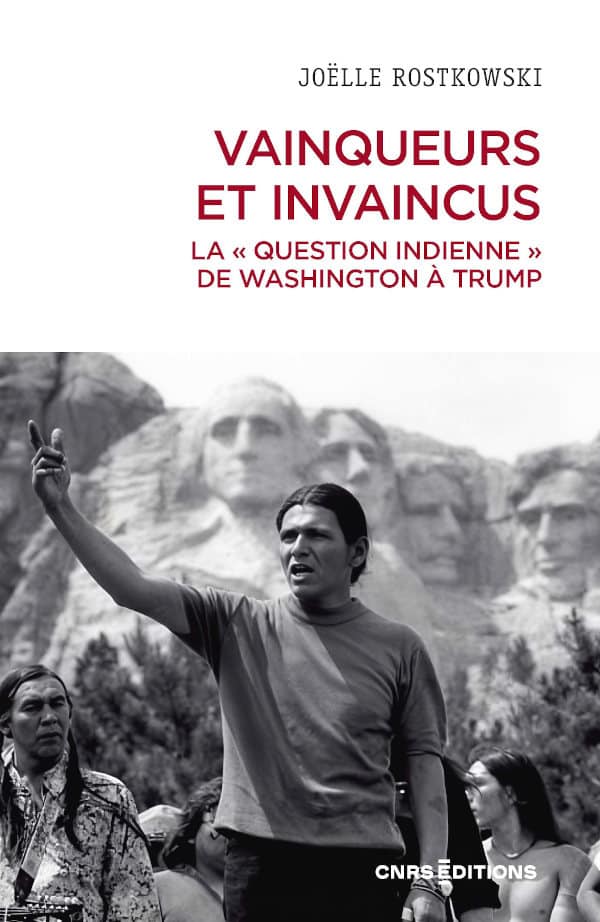
Des empires européens aux débuts des États-Unis : les histoires d’une colonisation
Bien que l’autrice borne son étude par la présidence de George Washington (1789-1797) et le deuxième mandat de Donald Trump, elle commence son ouvrage par une utile recontextualisation de l’histoire étatsunienne dans le contexte plus large de la colonisation européenne d’Amérique du Nord et des conflits territoriaux qui en découlèrent.
Elle entame ainsi son analyse en présentant les entreprises colonisatrices espagnole, britannique et française et leurs propres relations avec les nations autochtones d’Amérique du Nord. Ces échanges plus ou moins fructueux engendrèrent des alliances ainsi que des conflits avec les peuples autochtones, épisodes largement documentés par les colons (notamment la guerre des Pequot, la guerre du roi Philip…) et qui ont participé à la mythification de l’histoire de la « conquête » ainsi qu’à la valorisation du caractère extraordinaire de la nation étatsunienne. Tout ceci servit de justification pour la colonisation du territoire et de ses habitants, la nation étatsunienne s’étant investie de la mission divine de propager son mode de vie à travers le continent. C’est dans ce contexte colonial que George Washington fit ses armes avant de devenir le premier président des États-Unis.
La guerre des Pequots (1636-1638) opposa une alliance de colons de la Nouvelle-Angleterre et les nations Narragansett et Mohegan aux Pequots vivant dans la région. Les origines du conflit sont multiples (conflits entre colons anglais et autochtones, intertribaux…). La cause immédiate fut néanmoins le meurtre présumé de deux colons par des alliés des Pequots et les représailles violentes des colons du Massachusetts. Le conflit s’intensifia jusqu’à mener à la presque totale annihilation des Pequots. Pour une recherche récente sur le sujet, voir Charles Orr, The History of the Pequot War (Paris : Adansonia Publishing, 2019).
La guerre du roi Philip (1675-1678) opposa, quant à elle, les colons de la Nouvelle-Angleterre à une coalition de tribus autochtones guidée par Metacom, un Wampanoag. Le conflit fut le résultat de violation de traités de la part des colons anglais et résultat en la victoire de ces derniers. Pour plus d’informations, voir James D. Drake, King Philip’s War: Civil War in New England, 1675-1676 (Amherst: University of Massachusetts Press, 2000).
Joëlle Rostkowski revient ainsi sur les origines de la guerre de Sept Ans (1756-1763) sur le théâtre américain, et le rôle que Washington eut dans ce contexte : en Amérique du Nord, le conflit commença dès 1754. Se posait alors la question du contrôle de la vallée de l’Ohio. En effet, le futur premier président des États-Unis grandit et évolua dans un environnement entouré d’autochtones et n’eut aucun scrupule à s’approprier leurs terres, comme beaucoup de ses contemporains. Il était, après tout, issu d’une famille surnommée les « dévoreurs de terres » par les Iroquois (p. 58). À l’issue de la guerre, ses ambitions expansionnistes le poussèrent à protester contre la Proclamation de 1763. Celle-ci empêchait les colons britanniques de s’installer au-delà des Appalaches afin de limiter les conflits avec les nations autochtones, conflits qui s’avéraient très coûteux pour la Couronne britannique. Washington était alors très impliqué dans la spéculation foncière, notamment à travers la Mississippi Land Company, et ce rôle eut des conséquences directes sur sa façon de gérer la « question indienne ». Son approche, tournée principalement vers la volonté de favoriser l’acquisition de terres, au détriment éventuel des nations autochtones avoisinantes, ne lui était pas spécifique. Elle était largement partagée parmi les pères fondateurs de la nation étatsunienne. Dans les premières années de la jeune nation, Washington oscilla donc entre guerre et diplomatie pour arriver à ses fins.
L’ordonnance du Nord-Ouest de 1787 promettrait par la suite une « bonne volonté absolue » de la part du gouvernement fédéral étatsunien envers les nations autochtones, mais la pratique s’accorda difficilement avec la théorie (p. 87). L’autrice souligne alors l’écart lisible entre les déclarations publiques de Washington, qui allaient dans le sens de cette bonne volonté, et ses écrits privés qui définissaient les autochtones comme des sauvages et des loups qu’il fallait repousser ou éliminer pour laisser place à la « civilisation ». Bien que Henry Knox, secrétaire de la guerre de Washington, proposât de « conquérir leur affection » (p. 89), la politique sur le terrain se traduisit par des campagnes de d’expropriation de la terre, d’assimilation forcée et de signature de traités plus ou moins sous la contrainte. Cette vision de Washington, son traitement des affaires indiennes ayant été peu étudié, donne à voir une image plus complexe du premier président étatsunien, loin de vision très mythifiée, presque sacrée, qui domine encore aujourd’hui. Certes, Washington essayait de préserver la paix, mais uniquement dans la mesure où elle coïncidait avec les intérêts fonciers et économiques des États-Unis. Si les autochtones s’avéraient trop récalcitrants, il ne manqua pas d’user de la force pour les convaincre.
John Adams (1797-1801), qui succéda à Washington, utilisa sensiblement les mêmes tactiques et développa des politiques ambivalentes et peu cohérentes qui complexifièrent un peu plus les relations entre nations autochtones et gouvernement fédéral (pp. 96-100). Les incessants allers-retours du gouvernement en matière de politiques ne permirent pas de développer une approche cohérente de la « question indienne ». De même Thomas Jefferson (1801-1809), lui-même très tourné vers l’expansion de sa nation agraire modèle et vers l’exploration des terres de l’Ouest (l’expédition de Lewis et Clark) fit preuve de duplicité et d’opportunisme envers les autochtones. L’autrice souligne alors que le troisième président des États-Unis entretenait une vision de la démocratie fondée sur la petite propriété terrienne (p. 116), et donc sur la dépossession et/ou l’assimilation systématique des autochtones. Son successeur, le virginien James Madison (1809-1817), se montra, quant à lui, indifférent au sort des autochtones et continua les politiques précédemment mises en place. Selon Joëlle Rostkowski, sa seule réelle contribution fut de se montrer favorable au métissage, une position controversée qui lui valut de nombreuses critiques. Il est vrai que l’époque fut marquée par la croyance en une hiérarchisation des « races » et que beaucoup voyaient le métissage comme une souillure de la « civilisation » blanche.
L’expédition de Lewis et Clark (1804-1806), mandatée par Thomas Jefferson, visait l’exploration des terres nouvellement acquises lors de l’achat de la Louisiane à la France, jusqu’au Pacifique. Elle avait pour objectif de recenser les tribus autochtones rencontrées en chemin ainsi que les ressources naturelles disponibles, et de cartographier les terres qui pourraient, par la suite, devenir étatsuniennes. L’expédition ouvrit la voie à la colonisation et au développement du commerce (principalement de fourrure) avec les autochtones dans les années qui suivirent. Pour plus d’informations, voir les journaux de Lewis et Clark mis en ligne par l’Université du Nebraska : https://lewisandclarkjournals.unl.edu/ (consulté le 14/11/2025).
C’est sous la présidence de James Monroe (1817-1825) que Joëlle Rostkowski identifie une accélération de la conquête de l’Ouest et un durcissement de la politique fédérale indienne. En effet, la présidence de Monroe est généralement considérée comme une « ère de bons sentiments » (the Era of Good Feelings) car elle fut marquée par un apaisement des tensions internationales, notamment avec l’empire britannique. Néanmoins, cet apaisement s’accompagna d’une expansion vers l’Ouest et le Sud, commencée avec le Compromis du Missouri : trouvé en 1820 au Sénat, il mena à l’adhésion dans l’Union du Missouri esclavagiste et la création de l’État du Maine anti-esclavagiste en contrepoids, ainsi qu’à la mise en place d’une ligne de démarcation interdisant la création de nouveaux États esclavagistes au nord de la frontière sud du Missouri pour les adhésions à venir. La doctrine Monroe, qui condamne toute intervention européenne dans les Amériques, et donc auprès des autochtones, et l’organisation de la Floride, cédée par l’Espagne aux États-Unis en 1819 et organisée en territoire étatsunien en 1822, y contribuèrent également. Ainsi s’accentuèrent le fractionnement des terres autochtones collectives et l’assimilation par l’éducation des nations autochtones de l’Est, alors que les nations de l’Ouest, encore peu connues et peu côtoyées par les colons étatsuniens, étaient considérées comme hostiles mais fascinaient la société dominante (notamment avec le mythe du « noble sauvage »).
En résumé, la première partie de l’ouvrage de Joëlle Rostkowski dresse un portrait des premières années de la jeune nation étatsunienne centré sur des politiques d’expansion et de diplomatie à tâtons. Elle souligne le manque de cohérence dont la majeure partie des présidents de cette époque firent preuve et positionne la question foncière au centre de l’équation : derrière les traités, l’assimilation ou les conflits, c’était la terre que les colons étatsuniens convoitaient.
La conquête de l’Ouest : le temps des (l)armes
La seconde partie de l’ouvrage, intitulée « Les piliers de la discorde 1815-1890 », revient sur tout le XIXe siècle et sur les nombreux conflits qui marquèrent la période dite de « conquête de l’Ouest ».
L’autrice traite tout d’abord de la présidence de John Quincy Adams (1831-1848) et de sa vision de la politique indienne comme étant « frauduleuse et brutale » (p. 142). Particulièrement impliqué dans la résolution des conflits territoriaux entre États fédérés et nations autochtones, le sixième président des États-Unis était, selon l’autrice, favorable à l’extinction des droits territoriaux des autochtones et à leur déportation pour les extirper de l’espace national. Il était néanmoins contre la création d’un État autochtone indépendant à l’Ouest. Pour lui, il n’était pas question d’annexer des territoires autochtones par la force mais de passer par des voies légales d’acquisition de terres : la signature de traités et l’achat de territoires. Vers la fin de son mandat, il se montra de plus en plus préoccupé par le sort des autochtones, en particulier ceux du Sud-Est (Cherokees, Creeks, Choctaws, Chickasaws et Seminoles), et ne put trancher la question de l’intégration ou de la déportation de façon claire.
Son successeur fut moins hésitant. Andrew Jackson (1829-1837) adopta une position beaucoup plus tranchée que ses prédécesseurs, étant ouvertement opposé à la signature de traités et soutenait la déportation des autochtones. En bon homme du Sud, il favorisait les droits des États fédérés et voyait d’un mauvais œil le pouvoir fiduciaire du gouvernement fédéral. Il fut, selon les mots de l’autrice, le « président de la majorité blanche » (p. 149). Il fit savoir que le gouvernement fédéral n’avait pas le pouvoir de s’opposer au pouvoir législatif des États lorsqu’il approuva l’Indian Removal Act de 1830, texte de loi qui imposait la déportation aux nations autochtones du Sud-Est (principalement de Géorgie) vers un « territoire indien » à l’ouest du fleuve Mississippi. C’est sous sa présidence que les autochtones du Sud-Est traversèrent l’une des plus sombres périodes de leur histoire, les Pistes des larmes cherokee, choctaw, chickasaw… L’approche d’Andrew Jackson, aujourd’hui très controversée, fit des émules parmi ses contemporains. Ainsi, l’autrice revient sur les présidences de Martin Van Buren (1837-1841), de William Henry Harrison (1841), désigné par l’autrice comme « l’un des plus redoutables adversaires » des autochtones (p. 158) et de John Tyler (1841-1845) comme étant une période d’expansion territoriale et de durcissement de la politique fédérale indienne.
Les Pistes des larmes furent les noms donnés au déplacement forcé des « Cinq tribus civilisées » du Sud-Est (Cherokee, Choctaw, Creek, Chickasaw et Seminole) vers l’ouest du fleuve Mississippi, dans l’actuel Etat d’Oklahoma. Il est estimé que plus de 60 000 personnes furent ainsi déplacées de force, nombreuses trouvant la mort sur le chemin. Pour une étude de l’histoire de la nation cherokee, voir Lionel Larré, Histoire de la Nation Cherokee (Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux, 2014) ; pour une étude du déplacement forcé des Creeks, voir William W. Winn, The Triumph of the Ecunnau-Nuxulgee: Land Speculators, George M. Troup, State Rights, and the Removal of the Creek Indians from Georgia and Alabama, 1825-38 (Macon : Mercer University Press, 2015).
À cette époque, le maître mot était l’expansion, qui visait à étendre l’influence et le pouvoir des États-Unis, mais également à régler les tensions qui existaient entre États du Sud et États du Nord, notamment autour de la question de l’esclavage. Cet accent porté sur l’expansion impliqua l’intensification des conflits avec les nations autochtones de l’ouest. Ainsi, sous les présidences de James Knox Polk (1845-1849) et de Zachary Taylor (1849-1850), les États-Unis s’élargirent considérablement avec l’annexion du Texas en 1845 et les terres conquises à l’issue de la guerre américano-mexicaine en 1848. Joëlle Rostkowski considère que l’émergence de la spéculation foncière et la ruée vers l’or sur ces territoires constitue le point culminant des tensions entre les nations autochtones et les colons étatsuniens dans le Sud-Ouest du pays actuel. C’est là l’un des points forts de cet ouvrage, qui propose une recontextualisation systématique des politiques fédérales indiennes et permet de les comprendre de manière plus fine.
Exacerbation, assimilation, négation : un demi-siècle de tensions
Dans les deux décennies qui suivirent, marquées par l’accroissement des tensions autour de l’esclavage et la guerre de Sécession (1861-1865), peu de décisions furent prises au niveau fédéral en matière de politique indienne. À l’Ouest et dans les réserves, les autochtones se retrouvèrent à la merci d’agents corrompus et des États fédérés qui profitèrent du manque de supervision du gouvernement fédéral pour perpétrer toutes sortes d’abus à leur encontre. L’autrice s’intéresse à la présidence d’Abraham Lincoln (1861-1865), et notamment à sa gestion du soulèvement des peuples autochtones dakotas (une des branches de l’Oceti Sakowin, ou Sept Conseils de Feu, plus communément connus sous le nom de Sioux) de 1862 dans le Minnesota qui mena à l’exécution de 38 d’entre eux à Mankato, encore aujourd’hui la plus grande exécution publique de l’Histoire étatsunienne. Elle souligne également la signature du Homestead Act de 1862 qui permettait aux squatteurs de revendiquer la propriété d’une terre s’ils pouvaient prouver l’avoir occupée pendant plus de cinq ans. Cette loi permit, au fil du temps, d’attribuer des terres autochtones aux petits colons et chercheurs d’or, ce qui eut pour conséquence d’accroître les conflits à l’Ouest.
Lorsque Ulysses S. Grant (1869-1877), héros de la guerre de Sécession, fut élu président, il mit en place sa « Politique de Paix » qui, paradoxalement, coïncida avec l’exacerbation des « guerres indiennes » à l’Ouest. Joëlle Rostkowski propose de la redéfinir comme une « politique de pacification » (p. 208) car le gouvernement fédéral n’offrait la fin des hostilités qu’à ceux qui acceptaient les conditions imposées, à savoir la déportation dans les réserves et l’assimilation forcée et totale. Pour les esprits plus rebelles, Grant proposait la guerre acharnée. Joëlle Rostkowski revient ainsi sur différentes étapes de ces conflits (le massacre du camp Grant de 1871, la guerre de Red Cloud de 1866-1868, la bataille de Little Big Horn de 1876…) et sur les traitements qu’en firent les hommes qui succédèrent à Grant à la présidence du pays.
Le massacre de Camp Grant de 1871 eut lieu sur le territoire de l’Arizona et fut perpétré par des colons de Tucson, leurs alliés mexicains et tohono o’odham à l’encontre d’un village apache installé à proximité. Plus d’une centaine d’Apaches furent tués et les agresseurs jugés non-coupables. Voir Chip Colwell-Chanthaphonh, Massacre at Camp Grant: Forgetting and Remembering Apache History (Tucson, University of Arizona Press, 2007).
La guerre de Red Cloud, du nom du célèbre chef oglala lakota, opposa une coalition de Lakotas, Arapaho et Cheyennes du nord à l’armée étatsunienne, dans l’actuel Montana et Wyoming. Elle se déroula entre 1866 et 1868 et se termina avec la signature du traité de Fort Laramie qui établit la Grande Réserve Sioux.
La bataille de Little Big Horn (ou Greasy Grass) fut un affrontement entre un régiment de l’armée étatsunienne mené par le Général George Armstrong Custer et une coalition de Lakotas et de Cheyennes. La bataille faisait suite aux intrusions répétées de colons à la recherche d’or sur les terres des autochtones (définies par le traité de Fort Laramie de 1868) et à l’escalade de la violence dans la région. Elle se solda en la défaite de l’armée étatsunienne et la mort du Général Custer, connu sous le surnom de « tueur d’Indiens ». Voir Dee Brown, Enterre mon cœur à Wounded Knee : la longue marche des Indiens vers la mort (Paris : Albin Michel, 2009).
De manière générale, l’autrice identifie les présidences de Rutherford B. Hayes (1877-1881), James A. Garfield (1881), Chester A. Arthur (1881-1885), Grover Cleveland (1885-1889/1893-1897) et Benjamin Harrison (1889-1893) comme une période d’assimilationnisme paternaliste et d’intensification du morcellement des terres autochtones, notamment avec le passage du Dawes Act de 1887. Cette loi visait à règlementer l’attribution des terres autochtones, notamment en subdivisant les terres tribales en parcelles individuelles, imposant ainsi la propriété privée sur les réserves dans une tentative d’effacement de toute forme tribale de propriété collective.
La période fut marquée par une croyance de plus en plus tenace en la disparition inévitable des autochtones. Ils furent renvoyés au passé mythique des États-Unis et la « question indienne » ne fut plus si brûlante, bien que de nombreux journalistes aient rendu compte des atrocités perpétrées par le gouvernement, l’armée ou des milices à leur encontre. Ainsi, le XIXe siècle fut principalement celui des tensions et de la répression violente des autochtones aux États-Unis. La fin du siècle semblait présager leur disparition totale du paysage étatsunien et des préoccupations du gouvernement fédéral.
Une difficile route vers l’auto-détermination
Joëlle Rostkowski identifie néanmoins un renouveau dans sa troisième partie intitulée « L’éclipse et la lente reconnaissance ». On peut ici regretter que l’autrice considère la période progressiste comme une éclipse alors que cette période fut marquée par une activité foisonnante pour les autochtones, notamment avec la création de la Society of American Indians au niveau national. L’approche « par le haut » que l’autrice adopte semble ici avoir ses limites car elle la fait passer à côté d’un chaînon important de la lutte militante qui permit la « lente reconnaissance » qu’elle identifie plus loin.
La Society of American Indians fut la première organisation militante pan-indienne fondée et composée quasi exclusivement d’autochtones (parmi les figures les plus connues, Zitkala-Sa, Charles Eastman, Arthur C. Parker, Angel De Cora…). Elle fut active de 1911 à 1923, notamment à travers la publication de sa revue, The American Indian Magazine et son travail de lobbying auprès des instances gouvernementales. Pour plus d’information, voir Lucy Maddox, Citizen Indians: Native American Intellectuals, Race, and Reform (Ithaca: Cornell University Press, 2005).
Plusieurs chercheurs des deux côtés de l’Atlantique se sont attelés, ces dernières années, à la réhabilitation des militants de la Society of American Indians et de l’importance de la période charnière de l’ère progressiste dans l’évolution du militantisme autochtone aux Etats-Unis. Voir les travaux récents de Lionel Larré; Maddox, Citizen Indians; Cristina Stanciu, The Makings and Unmakings of Americans: Indians and Immigrants in American Literature and Culture, 1879-1924 (New Haven: Yale University Press, January 2023).
Il est vrai que les présidents n’eurent alors cure du sort des nations autochtones qui peuplaient le territoire. William McKinley (1897-1901) fut ainsi totalement indifférent au génocide des autochtones californiens qui étaient forcés de travailler dans les mines, prostitués et chassés par les colons. Après lui, Theodore Roosevelt (1901-1909), bien que très impliqué dans les mouvements de conservation de la nature, ne se préoccupa pas vraiment des autochtones et s’opposa à la reconnaissance de leurs droits territoriaux. Joëlle Rostkowski fait alors ressortir le manque d’intérêt et de reconnaissance que ces présidents montrèrent à l’égard des autochtones. Leur adhésion au mythe du vanishing Indian,selon lequel les autochtones avaient disparu ou allaient disparaître à l’aube du XXe siècle, y fut certainement pour beaucoup. Ainsi l’autrice recontextualise ces prises de position dans une chronologie plus large mêlant anthropologie de sauvetage et célébration du « Noble Peau-Rouge » (p. 252) dans la culture populaire.
Les présidences de Woodrow Wilson (1913-1921) et de Calvin Coolidge (1923-1929) semblent toutefois marquer une certaine rupture avec l’indifférence au passé, relève l’autrice. C’est sous leur impulsion que la voie vers la citoyenneté fut ouverte aux autochtones et que le gouvernement fédéral s’intéressa aux conditions de vie dans les réserves. En effet, le rapport Meriam (1929) rendit compte des conditions de vie désastreuses sur les réserves et de la nécessité de changer d’idéologie comme de pratique dans la politique indienne fédérale. Cette prise de conscience fut effective sous les mandats de Herbert Hoover (1929-1933) : celui-ci avait grandi auprès des autochtones, ce qui, selon l’autrice, explique son intérêt atypique pour les autochtones, si on le compare à celui de ses prédécesseurs.
À sa suite, Franklin D. Roosevelt (1933-1945) mit en place l’Indian New Deal, une succession de réformes fédérales visant à se défaire de l’assimilation et mettre en avant les capacités de gouvernance des tribus autochtones. Ainsi cette période marqua la transition entre politique d’assimilation forcée et chemin vers l’auto-détermination. Le morcellement des terres autochtones fut abandonné et des gouvernements tribaux furent mis en place. Bien que le bien-fondé de cette réforme suscitât des débats auprès des autochtones, la période marqua tout de même l’avènement d’une nouvelle acception de la politique fédérale indienne, du moins pour un temps.
En effet, à la fin du mandat de Roosevelt, la politique fédérale à l’égard des peuples autochtones connut un tournant radical : on revint à l’individualisation et à l’assimilation forcée. Ceci se fit notamment par la politique de termination, qui cherchait à abolir le statut de tutelle entre le gouvernement fédéral et les autorités tribales et à considérer les autochtones comme n’importe quelle autre minorité. Ceci provoqua une levée de boucliers chez les autochtones qui s’organisèrent en un mouvement militant d’ampleur nationale qui traversa les années 1960 et culmina sous la présidence de Richard Nixon (1969-1974). Ce dernier reconnut l’auto-détermination comme politique officielle du gouvernement étatsunien. Cette tendance à la reconnaissance des droits des autochtones se poursuivit jusqu’à la présidence de Ronald Reagan (1980-1988) qui imposa de nombreuses restrictions budgétaires. Celles-ci amoindrirent l’efficacité des mesures prises pour améliorer la vie des autochtones durant les décennies précédentes.
La question indienne tributaire des alternances politiques
C’est à partir des années 1980 qu’on commence à entrevoir une certaine logique partisane de traitement de la « question indienne ». George H. W. Bush, vice-président et successeur (1988-1992) de Ronald Reagan, renoua avec les tendances antérieures à ce dernier et reconnut la relation de gouvernement à gouvernement qui existait entre le gouvernement fédéral et les nations autochtones. Bill Clinton (1992-2000), qui se rendit sur la réserve de Pine Ridge au Dakota du Sud, souhaita lui aussi renforcer ces relations et la politique d’autodétermination du gouvernement en invitant les nations autochtones reconnues par le gouvernement fédéral à la Maison-Blanche et en publiant un mémorandum sur la défense des lieux sacrés autochtones. Cette période fut également marquée par l’internationalisation du combat pour la reconnaissance des droits des autochtones : reconnaissance des traités, du principe d’auto-détermination des peuples, nécessité de rétributions/rapatriement…
À partir de George W. Bush (2000-2008), l’approche des présidents ressembla à un perpétuel va-et-vient, une sorte de tricotage-détricotage infini des mesures mises en place par l’un ou l’autre parti au pouvoir. Cette nouvelle tendance coïncidait avec la polarisation partisane du discours politique sur de nombreux aspects autres que la politique indienne, notamment autour des budgets des programmes sociaux, des impôts ou autour de questions comme l’avortement ou les armes. Joëlle Rostkowski fait ainsi état d’une relative marginalité de la « question indienne » sous la présidence de Bush fils, qui n’eut pas d’effet notable sur la situation.
Au contraire, Barack Obama (2008-2016) sembla redoubler d’efforts pour remettre la « question indienne » sur le devant de la scène. L’autrice cite ses multiples visites dans des réserves pendant ses campagnes, la mise en place de réunions annuelles avec les leaders autochtones à la Maison-Blanche, sa prise en charge des problèmes liés aux disparitions des femmes autochtones ainsi que de la question des rétributions et des risques environnementaux liés aux forages sur les réserves, avec notamment sa gestion du mouvement #NODAPL. Ce dernier, né sur les réseaux sociaux, s’opposait à la construction de l’oléoduc Dakota Access : un camp vit le jour pour empêcher la construction de l’oléoduc sur la réserve de Standing Rock, et les militants exigèrent la suspension de la construction de l’oléoduc Dakota Access.
La crise des femmes et filles autochtones disparues (Missing and Murdered Indigenous Women and Girls) n’est pas nouvelle mais s’est particulièrement accentuée ces dernières décennies. Outre le fait que les femmes autochtones ont trois fois plus de chance de mourir d’une mort violente (majoritairement infligée par des non-autochtones) que les autres femmes, le flou juridique et juridictionnel qui règne sur les réserves (quelle instance doit traiter de ces cas ? La cour tribale, fédérale, ou d’Etat ?) empêche la collecte effective de données, la résolution de ces crimes, et fait ainsi flotter un voile d’impunité sur les crimes perpétrés à l’encontre des femmes autochtones. Voir Sarah Deer, The Beginning and End of Rape: Confronting Sexual Violence in Native America (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017).
Ces efforts, salués par une grande partie des organisations autochtones, furent ensuite mis de côté sous le premier mandat de Donald Trump (2016-2020) qui ordonna la relance des travaux des oléoducs Dakota Access et Keystone XL et réduisit drastiquement le monument national de Bears Ears dans le Nevada et celui de Grand Staircase Escalante en Utah (chacun étant un espace sacré pour des nations autochtones) pour l’ouvrir à l’exploitation pétrolière. Joe Biden (2020-2024) rétablit ensuite le statut protégé de Bears Ears et Grand Staircase Escalante et remit en pause la construction de l’oléoduc Keystone XL. Joëlle Rostkowski parle alors d’une tendance à « faire et défaire » (p. 392) ces dernières décennies qui se confronte à une résistance accrue des autochtones aux diverses tentatives de mainmise du gouvernement fédéral. L’autrice conclut ainsi son étude sur l’agentivité des autochtones et leur pouvoir d’influence auprès des différents présidents des États-Unis.
Vainqueurs et invaincus permet donc de retracer l’histoire des relations entre gouvernement fédéral et nations autochtones et de mieux cerner le rôle qu’eurent les présidents successifs dans l’évolution de la « question indienne » aux États-Unis. À travers un travail important d’archives dans l’histoire tortueuse et complexe des relations autochtones-allochtones du pays, cet ouvrage représente un premier pas idéal pour tout lecteur ou lectrice qui s’intéresse à cette histoire fascinante et mouvementée.
Les lecteurs et lectrices avisés observeront néanmoins les limites de l’histoire « par le haut », composée de vignettes centrées sur les présidents, proposée par Joëlle Rostkowski : elle manque parfois de perspectives alternatives et ne prend que peu en compte l’expérience autochtone des évènements et politiques ici analysés. Un fait regrettable compte tenu de l’historiographie récente autour de l’histoire des relations entre États-Unis et nations autochtones, marquée par une certaine prise de distance avec l’histoire centrée sur les acteurs allochtones de l’histoire étatsunienne.
Voir, entre autres, Ned Blackhawk, The Rediscovery of America: Native Peoples and the Unmaking of U.S. History, New Haven, Yale University Press, 2023, 616 p. et Roxanne Dunbar-Ortiz, Contre-histoire des États-Unis, Marseille, Wildproject, 2018, 336 p. (traduit et préfacé par Pascal Menoret). En version originale, An Indigenous Peoples’ History of the United States, Boston, Beacon Press, 2014, 296 p. A également été publié récemment Roxanne Dunbar-Ortiz, Contre-histoire des États-Unis, Marseille, Wildproject, 2018, 336 p. (traduit et préfacé par Pascal Menoret). En version originale, An Indigenous Peoples’ History of the United States, Boston, Beacon Press, 2014, 296 p.
Pour citer cet article
Claire Anchordoqui, « Vainqueurs et invaincus. La ‘question indienne’ de Washington à Trump, un livre de Joëlle Rostkowski », Revue Alarmer, mis en ligne le 19 décembre 2025, https://revue.alarmer.org/vainqueurs-et-invaincus-la-question-indienne-de-washington-a-trump-un-livre-de-joelle-rostkowski/