La mort d’Yves Boisset le 31 mars 2025 a été l’occasion de saluer une carrière unique dans le cinéma français. Son cinéma très prolifique et populaire, notamment dans les années soixante-dix, donne l’occasion de se plonger dans une époque. Si l’on s’intéresse à la question des migrations et du racisme, Dupont Lajoie apparaît comme une archive de grande qualité car il est rare qu’un film puisse faire émerger une figure archétypale de la société. Le « Dupont Lajoie » a incarné ainsi ce Français moyen, « beauf », phallocrate et qui n’aime pas les étrangers, en particulier les « Arabes », allant jusqu’à adopter les pires comportements et commettre l’irréparable. Sa bêtise franchouillarde s’exprime de préférence sur le zinc d’un bistrot ou bien au camping à travers des mots, des insultes mais pas seulement : le passage à l’acte entre violence inattendue, mépris et lâcheté. Tourné en 1974 et distribué en février 1975 par la société Sofracima avec une musique de Vladimir Cosma, ce film est un véritable miroir de la société française de l’époque, comme un coup de poing qui révèle le racisme aux Français.
L’Avant-Scène Cinéma, n°589, janvier 2012 avec un dossier consacré à Dupont Lajoie avec les dialogues.
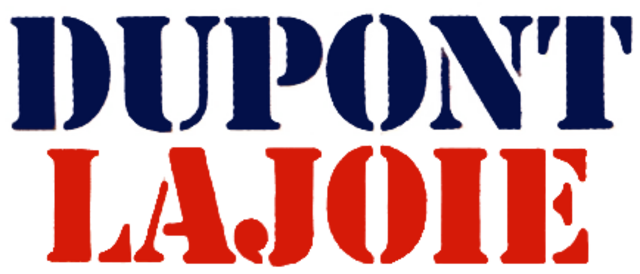
Écrire un film sur le racisme
Né en 1939, Yves Boisset connaît une importante notoriété au début des années soixante-dix en incarnant un cinéma politique engagé « à gauche » et le plus souvent inspiré de faits réels. Aborder les sujets qui fâchent, tel est son leitmotiv : après avoir évoqué la police (Un Condé en 1970) et l’Affaire Ben Barka (L’Affaire en 1972), le réalisateur s’intéresse à la Guerre d’Algérie en 1973 à travers R.A.S. qui aborde la façon dont l’armée française a traité l’insoumission de certains appelés. Alors que, pendant le tournage de ce film, des acteurs algériens font état du racisme qu’ils subissent dans l’Hexagone, Yves Boisset, déjà largement sensible aux faits divers racistes ayant défrayé la chronique entre 1971 et 1973, décide de réaliser un prochain long-métrage à ce sujet. Il s’entoure de plusieurs scénaristes : Jean Curtelin pour l’aspect « comédie » et Claude Veillot pour la dimension plus tragique. Voilà deux faces de la même réalité du film. Il s’adjoint également les auteurs de « polars » Jean-Pierre Bastid et Michel Martens, qui avaient déjà envisagé un roman sur le sujet sans avoir publié. L’ambition est de dénoncer le lourd climat raciste qui s’accentue début des années soixante-dix contre les Arabes, en stigmatisant les Français « ordinaires » porteurs de cette haine au quotidien qui confine avec médiocrité et bêtise.
Voir l’autobiographie d’Yves Boisset, La Vie est un choix, Paris, Plon, 2011.
Fausto Giudice, Arabicides, une chronique française (1970-1991), Paris, La Découverte, 1992.

Une comédie qui vire au drame
Le choix fort et efficace d’Yves Boisset est d’installer la première partie du film sur le ton de la comédie avec le concours d’acteurs très populaires employés habituellement dans ce registre tels Jean Carmet, Ginette Garcin, Pierre Tornade, Robert Castel, Victor Lanoux, Jacques Villeret ou encore Jean-Pierre Marielle. Puis, brutalement, le film bascule dans le drame le plus sordide.
Le scénario s’articule autour de familles issues des classes moyennes qui, sous couvert d’un conformisme de bon aloi, développent des comportements racistes pouvant engendrer des actes d’une terrible gravité. Georges Lajoie (Jean Carmet), cafetier parisien, personnage débonnaire et plutôt jovial, est cependant rongé par quelques obsessions qui ne tardent pas à se manifester à l’écran : il n’hésite pas à « reluquer » les femmes et surtout, il ne supporte pas les immigrés. Comme chaque année à l’occasion des vacances d’été, Lajoie ferme son bar et part avec femme et enfant dans leur villégiature de rêve, un camping de Sainte-Maxime (Var), où il retrouve des amis de longue date, familiers de ce rendez-vous au bord de mer sous le soleil du mois d’août. Tout semble parfait cette année-là : baignade, barbecue, pétanque, pastis, jeux et soirée dansantes sont au programme. Cependant, non loin du camping, la présence d’un chantier employant des « Nord-Africains » en dérange plus d’un. Un premier coup de semonce, sous forme d’altercation, se produit pendant un bal au camping, lorsque Lajoie s’en prend violemment à ces travailleurs venus danser « un peu trop près des femmes ». Puis, un acte tragique précipite les choses : un après-midi, Lajoie aperçoit la fille de l’un de ses amis (Isabelle Huppert) qui, toute seule, nue, profite du soleil non loin du camping. Il s’approche et, dans un moment d’égarement, il l’aborde et ne tarde pas à tenter de l’embrasser. Face à la résistance de la jeune fille, pris de folie, il la viole et la tue. Pour se disculper, il transporte à la hâte le corps près des baraquements des immigrés laissant croire que le crime a été commis par les Arabes. Le drame se noue. Ses amis, désemparés ou anéantis par ce crime le croient bien volontiers.
Une ratonnade à l’écran
Le film change alors de nature. On en vient au cœur du projet d’Yves Boisset : filmer une ratonnade pour mieux la dénoncer par la fiction et l’émotion. La police vient enquêter et, à sa tête, le commissaire (Jean Bouise) émet des doutes sur la culpabilité des « Arabes » et se montre suspicieux envers les résidents du camping. La nervosité gagne les familles mais aussi les Algériens, inquiets d’éventuelles représailles qui ne tarderont pas à survenir. Face à l’attentisme de la police, les esprits s’échauffent. Encouragé par Lajoie, un « ancien d’Algérie » (Victor Lanoux), un soir, fédère les énergies pour que justice soit faite. Il faut organiser une expédition punitive contre les immigrés. Malgré l’opposition de deux personnages, un Pied-Noir (Robert Castel) qui gère le camping et le chef de l’entreprise de chantier, un Italien (Pino Caruso) dont les parents avaient subi jadis le racisme, tout un groupe armé de bâtons et de barres de fer se lancent à l’assaut des baraquements des travailleurs immigrés. La ratonnade est filmée pas à pas jusqu’à l’exécution de celui que Lajoie désigne comme le possible meurtrier (Abderrahmane Benkloua). Les spectateurs assistent, au cinéma, à des actes similaires à ceux qui se multiplient alors dans l’Hexagone.

Face à cette flambée de violence, se pose la question des coupables. Outre les responsabilités liées à la mort de l’ouvrier algérien, le commissaire découvre progressivement la culpabilité de Lajoie et s’apprête à procéder aux arrestations. Mais ce fonctionnaire intègre ne pourra pas résister à la « raison d’État ». À la suite de pressions du ministre de l’Intérieur et la promesse d’une belle promotion, il est contraint d’étouffer l’affaire. Aucune poursuite ne sera engagée ni contre Lajoie, ni contre les acteurs de la ratonnade : comme c’était souvent le cas dans la réalité, le meurtre de l’ouvrier algérien restera impuni.
Quel épilogue ?
Comme il l’a plusieurs fois évoqué, incertain sur le message à délivrer, Yves Boisset a tourné deux fins différentes. La première – celle qui n’a pas été retenue – est l’impunité totale de Georges Lajoie qui, de retour à Paris, n’éprouve pas de remords apparents et reprend sa vie routinière de patron de bistrot raciste, même si sa femme n’est pas dupe et qu’ils ne retourneront plus au camping de Sainte Maxime. La seconde est plus violente : le frère de la victime de la ratonnade (Mohamed Zinet) que l’on voyait déjà en route vers le marché d’Aligre au début du film, atteint sa destination au bout du scénario. Le spectateur s’attend au pire : il entre dans le bar de Lajoie et le tue à bout portant de deux coups de carabine. Le choix de cette fin par Yves Boisset a été dictée après avoir « testé » le film auprès de divers publics, notamment des travailleurs immigrés. Au risque d’alimenter les comportements anti-arabes, son côté spectaculaire entérine l’impression d’une escalade de la violence face au désespoir et à l’injustice dont les travailleurs immigrés sont victimes. Ainsi, Boisset délivre un message efficace contre les préjugés : sans nuance et de manière un peu manichéenne, il invite les Français à réfléchir sur le racisme ordinaire qui, selon lui, ronge la société. Culpabilisant, son message est une critique de l’attitude répandue des Français à l’égard des travailleurs immigrés faite de haine, d’ignorance et de bêtise.
Voir Droit et Liberté mensuel du MRAP, n°337, 21 mars 1975, pp.6-7 entretien avec Katia Laurent. Voir aussi, bien plus tard, l’émission d’Europe 1, « Secrets de tournage », 27 juillet 2014 animée par Bruno Cras et consacré à Dupont Lajoie en présence d’Yves Boisset.
Mohamed Zinet (1932-1995) est une figure du cinéma algérien, jouant souvent le rôle de l’immigré dans les films français.
Henri Lefèvre dans Cinéma 75, mars 1975, estime que le film use d’un style trop manichéen, didactique et donc artificiel. Certaines scènes sont critiquées, notamment la dernière, celle du meurtre de Lajoie par l’immigré choqua dans la mesure où elle risquait de provoquer un réflexe anti-arabe ; cf. aussi Joël Magny, dans Télé-Ciné, avril 1975, p.10 ; France-Pays arabes, avril 1975 et Le Monde, 10 août 1975.
La réalité dépasse-t-elle la fiction ?
La réalité dépassant parfois la fiction, le tournage de Dupont Lajoie s’est déroulé dans un contexte de succession d’incidents racistes : à Hyères, Tourtour et surtout dans un camping de Fréjus près de la plage de Saint-Aygulf, où se déroulent la plupart des scènes, l’équipe est mal accueillie en raison de la présence d’acteurs arabes. Les lieux seront même en partie touchés par des jets de cocktails molotov. Certains restaurants refusent de les servir et certains hôtels ne veulent pas les héberger, prétextant ne pas être un « dortoir de bicots ». Des municipalités sollicitées interdisent carrément le tournage dans leur commune. Boisset raconte que, pour filmer la ratonnade, il a eu recours non seulement aux acteurs principaux mais aussi à de nombreux figurants parmi les vacanciers du camping qui auraient joué leur rôle avec une conviction peu commune : « Quand on a tourné la scène, j’ai dû les arrêter, sinon ils auraient tué l’acteur algérien… ». Leur racisme interloque Boisset : « Pour leur participation au tournage, je leur expliquais qu’une fille a été violée et que les gens du camping croient que c’est un ouvrier nord-africain mais c’est faux et ils me répondaient ‘faudrait voir !’, je leur répliquais ‘mais c’est le scénario’ et ils surenchérissaient ‘oh vous savez avec ces types-là tout peut arriver’ ».
Droit et Liberté, 21 mars 1975, op. cit.
Propos recueillis dans Cinémaction, n° 8, 1979.
Droit et Liberté, 21 mars 1975, op. cit.
Plus grave, de réelles violences viennent émailler le tournage. Mohamed Zinet, le seul acteur professionnel maghrébin du film, n’a pas pu finir le tournage : agressé par quatre individus en quittant le plateau, il doit être hospitalisé. Quant à Abderrahmane Benkloua – la victime du film – quelques jours après avoir tourné la fameuse scène, il est agressé à son tour à Toulon par une bande connue pour ses exactions racistes. Assommé à coup de bouteilles et de matraque, il reçoit deux balles de revolver dans le ventre. Laissé pour mort, il parvient à survivre et, après un long séjour à l’hôpital, à reprendre sa carrière d’acteur. Lorsqu’Abderrahmane Benkloua a voulu porter plainte, la police l’en a dissuadé, estimant qu’il ne fallait pas provoquer ces individus. Compte tenu de tous ces incidents, certains observateurs comme l’écrivain marocain Tahar Ben Jelloun considèrent que cette histoire se place en-deçà de la réalité, tant l’univers misérable des immigrés n’est pas connu du grand public : à ce titre, le film vient à point nommé et s’avère nécessaire.
Propos de l’écrivain Tahar Ben Jelloun dans ce sens dans Le Monde, 27-28 avril 1975.
Jean Carmet, acteur (trop) parfait ?
L’une des grandes forces du film Dupont Lajoie réside dans la distribution, qui comprend des acteurs reconnus et talentueux ayant su se renouveler pour l’occasion et entrer dans leurs rôles respectifs. Parmi ceux-ci, Jean Carmet (1920-1994), pour sa première tête d’affiche, se montre remarquable de justesse au point de glacer le spectateur et de susciter le malaise. Cantonné jusque-là aux rôles de gentils et de comiques, il se retrouve imposé à la production – peu convaincue au départ – par Yves Boisset, avec qui il entretient des liens d’amitié, pour l’interprétation de Georges Lajoie. L’opportunité lui est ainsi donnée de montrer ses talents d’acteur sous un nouveau jour. Après avoir hésité pendant deux mois, Carmet accepte le rôle. Comme à son habitude, il s’immerge au plus profond dans la peau du personnage, parvenant à habiter à la perfection ce raciste si veule et détestable, aux antipodes de sa personnalité. Yves Boisset explique la difficulté qu’il a eue à tourner la scène du viol qui rendait Jean Carmet malade. Ce dernier confie plus tard que, après chaque journée de tournage, il prenait de multiples douches ou bains pour se « laver » de Lajoie. Mais, plus globalement, ce rôle laisse des traces dans la vie de l’acteur. Tatiana Vialle, sa belle-fille, nous apprend dans un récit romancé, évoquant sa mémoire 25 ans après sa disparition, sa difficulté à sortir de la peau de Lajoie. Si certains saluent la prouesse d’acteur, d’autres, parmi les spectateurs antiracistes, font fausse route en le considérant comme coupable d’avoir rendu anodin, « presque sympathique », un personnage ignoble. Il est régulièrement pris à partie dans la rue, insulté voire menacé. Des projectiles sont même lancés contre sa maison, dans la banlieue parisienne.
Europe 1, « Secrets de tournage », 27 juillet 2014, op. cit.
Tatiana Vialle, Belle Fille, Paris, Nils, 2019 et Jérôme Garcin, « Dupont Lajoie, ce rôle qui tourna au cauchemar pour Jean Carmet », L’Obs, 3 janvier 2019.
Un film inscrit dans le temps
D’abord interdit au moins de 16 ans par la Commission de censure, après quelques coupes, le film n’est finalement interdit qu’aux moins de 13 ans en raison des scènes de viol et de ratonnades. Les critiques sont mitigées : certains regrettent qu’Yves Boisset n’ait pas osé mettre en scène des ouvriers français, le racisme n’émanant pas seulement de la petite bourgeoisie. Autre faiblesse du film pour d’autres, les travailleurs immigrés, victimes impuissantes, n’ont aucune épaisseur dans le scénario. Face à cette critique, le cinéaste se justifie : « Je ne montre des immigrés que ce que les Français en connaissent ». Le caractère peu nuancé du propos suscite aussi quelques réprobations. Par ailleurs, certains directeurs de salle, craignant des séances à forte fréquentation d’immigrés, tentent de déprogrammer le film comme le directeur du cinéma Pathé de la place Clichy. Enfin, des pressions voire des menaces sont proférées en divers endroits pour empêcher la diffusion du film. Certaines projections sont annulées par peur de représailles.
Cinémaction, été 1979, op. cit.
Cependant, malgré tous ces écueils et quelques incidents ou échauffourées lors de certaines séances, le succès de Dupont Lajoie est immédiat : au cours des deux premières semaines de sa sortie parisienne, 200 000 spectateurs viennent voir le film. Au total, le nombre d’entrées s’élève à environ un 1,5 million : le film a été programmé pendant plusieurs mois à l’affiche des salles de cinéma. Présenté au festival du film de Berlin en avril 1975, le film obtient l’Ours d’argent. Une vaste tournée est entreprise par Yves Boisset et Jean Carmet pour présenter le film en province comme au cinéma Royal à Lyon ou au Rex à Metz. Puis, la notoriété s’accroît et le film devient une référence durable pour le public français pour deux raisons : les multiples rediffusions à la télévision, notamment dans le cadre de débats autour du racisme, et sa circulation dans des établissements d’enseignement ou dans les associations antiracistes. Utiles sur le plan pédagogique, ses multiples rediffusions ont eu tendance à figer le racisme dans l’époque des années 1973. Diffusé dans les années 1990 ou 2000, son effet reste intact, les spectateurs ou téléspectateurs, notamment les plus jeunes, considérant que l’attitude de Lajoie est intemporelle.

Le Progrès, 16 avril 1975.
Le Républicain Lorrain, 16 mars 1975.
Voir lors de la rediffusion sur Antenne 2 en avril 1978, L’Humanité, 6 avril 1978, Le Point du jour, 10 avril 1978 ou dans le cadre des Dossiers de l’écran en octobre 1981, L’Humanité-dimanche, 10 et 18 octobre 1981.
Une scène du film symbolisait ce besoin d’éducation de l’opinion, les coupables de la ratonnade sont convoqués par l’inspecteur de police (Jean Bouise) dans une salle de classe. Rappelant la scène du Corbeau de Henri-Georges Clouzot où les suspects réunis dans une école devait écrire le texte de la lettre anonyme, on y devine une cinglante mise en cause des Français, obligés de réapprendre les principes élémentaires de la vie en société, notamment la tolérance.
Observateur des faits divers tragiques de 1973, Yves Boisset a su s’emparer, avec courage et détermination, du thème du racisme pour livrer une œuvre forte, ayant laissé une trace durable dans les esprits. Dupont Lajoie reste assez isolé dans le paysage cinématographique français car, hormis peut-être Train d’enfer de Roger Hanin en 1984 mais sur un registre différent, aucune autre production ne l’a rejoint dans un tel traitement du sujet, celui du racisme ordinaire et quotidien, véritablement pris de front. Pour l’historien, le mérite de cette œuvre est de fournir une figure-type du raciste de ce début des années soixante-dix.
Pour citer cet article
Yvan Gastaut, « Quand Yves Boisset explore les ressorts du racisme ordinaire : Dupont Lajoie (1975) », Revue Alarmer, mis en ligne le 16 septembre 2025, https://revue.alarmer.org/yves-boisset-racisme-ordinaire-dupont-lajoie-1975/