Depuis la mort en 2018 de Robert Faurisson, figure emblématique du négationnisme français, une question centrale s’impose : que devient le négationnisme aujourd’hui ? Certains avaient pu croire que la disparition de ses principaux représentants, la diffusion des grands procès de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que la mise en place de moyens de répression contribueraient à son effacement progressif. Or, bien loin d’avoir disparu, le négationnisme arbore de nouvelles apparences.
À l’ère des réseaux sociaux, les thèses négationnistes se diffusent plus rapidement, se fragmentent en une pluralité de formes et s’adossent souvent à des contextes politiques nationaux ou transnationaux marqués par la montée des régimes illibéraux, des droites radicales et de nouvelles formes de nationalisme.
Le 221e numéro de la Revue d’Histoire de la Shoah, intitulé « Distorsions de la Shoah et nouveaux négationnismes », entend précisément saisir ces évolutions. Si l’accent reste mis sur le génocide des Juifs d’Europe, trois contributions élargissent le champ aux génocides arménien et des Tutsi, permettant d’interroger les similitudes et les spécificités des processus de négation ou de distorsion. Ce numéro, sous la direction de Jean-Marc Dreyfus et Audrey Kichelewski, s’inscrit dans une historiographie déjà riche, marquée par les travaux fondateurs de Pierre Vidal-Naquet, Henry Rousso, Valérie Igounet ou Deborah Lipstadt, mais aussi par des recherches plus récentes comme celles de Stéphanie Courouble-Share sur la circulation internationale des réseaux négationnistes.
Pierre Vidal-Naquet, Les assassins de la mémoire. « Un Eichmann de Papier et d’autres essai sur le révisionnisme, Paris, Le Seuil, 1987 ; Henry Rousso, Le Dossier de Lyon III. Le rapport sur le racisme et le négationnisme l’Université Jean-Moulin, Paris, Fayard, 2002 ; « Les racines du négationnisme en France », Cités. Philosophie, politique, histoire, 2008, n° 36 : Le vertige du mal, p. 52-61 ; Valérie Igounet, Histoire du négationnisme en France, Paris, Seuil, 2000 ; Le négationnisme en France, PUF, 2020 ; Deborah Lipstadt, Denying the Holocaust. The Growing Assault on Truth and Memory, New-York, Free Press- Maxwell Macmillan, 1993 ; Stéphanie Courouble-Share, Les idées fausses ne meurent jamais. Le négationnisme, histoire d’un réseau international, Lormont, Le Bord de l’eau, 2021.
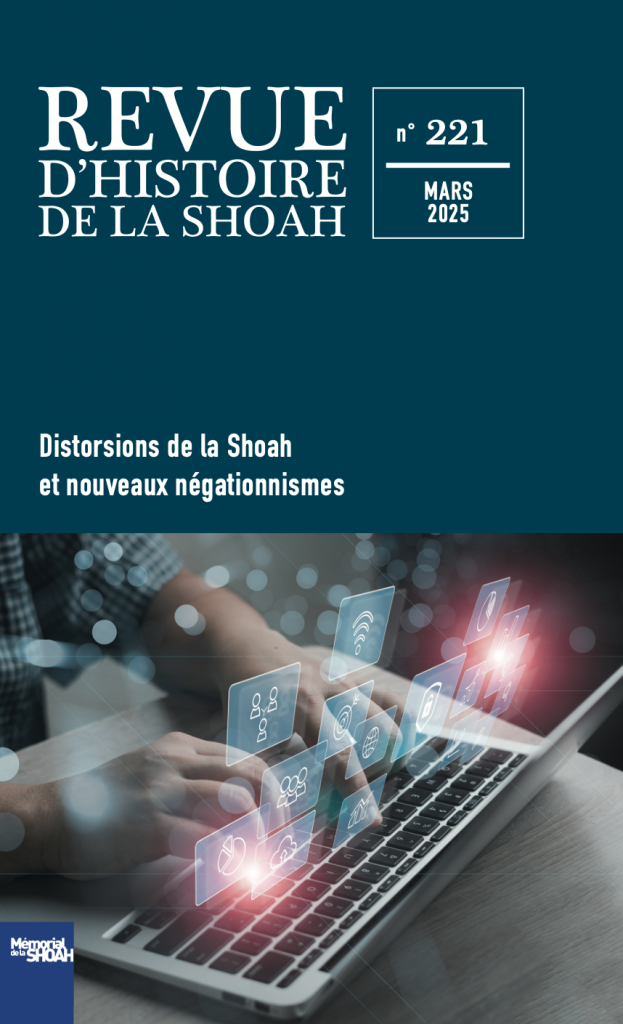
L’intérêt de ce volume est double. D’une part, il propose un panorama de situations nationales qui illustrent combien le rapport au passé demeure un enjeu politique majeur. De l’autre, il invite à réfléchir à la pertinence des termes utilisés pour décrire ces phénomènes : « révisionnisme », « négationnisme », « distorsion »… autant de mots dont les usages varient et qui ne recouvrent pas toujours les mêmes réalités. Cette dimension terminologique constitue l’un des aspects centraux de ce numéro riche d’enseignements, dont nous rendrons ici compte thématiquement.
Définir le phénomène : débats terminologiques et enjeux conceptuels
L’un des mérites majeurs du numéro est d’ouvrir sur une réflexion lexicale et conceptuelle. Car avant de combattre le négationnisme, encore faut-il savoir de quoi l’on parle. Les mots ne sont jamais neutres, et les termes employés pour désigner la négation des crimes de masse jouent un rôle essentiel : ils orientent la perception du phénomène, déterminent les réponses politiques et juridiques, et influencent aussi la recherche scientifique.
Annette Becker, dans sa contribution inaugurale, retrace l’histoire des mots utilisés pour dire – ou justement ne pas dire – le génocide. Elle rappelle que l’histoire du terme « génocide », forgé par Raphaël Lemkin en 1944, illustre bien ce pouvoir des mots : il ne s’agit pas seulement de décrire une réalité, mais aussi de la rendre pensable, et donc condamnable. À l’inverse, les négationnistes ont souvent exploité les imprécisions ou les zones d’ombre de la recherche pour introduire le doute.
Comme le souligne Annette Becker, il existe une relation paradoxale entre le travail scientifique et les thèses négationnistes : les mensonges de ces derniers obligent les chercheurs à affiner leurs analyses, à mieux distinguer les catégories, à répondre aux objections fallacieuses. L’article interroge également le rapport entre propagande, mémoire et vérité historique. En convoquant Marc Bloch et ses réflexions sur la Première Guerre mondiale – et plus particulièrement sur les « fausses nouvelles » –, Annette Becker met en évidence la création d’une « pathologie du faux » (p. 37) qui permet au négationnisme d’exister et de prospérer. Rappelant enfin les résolutions prises internationalement pour lutter contre le négationnisme et la distorsion de l’histoire de la Shoah, elle souligne le paradoxe important – et qui divise toujours parmi les historiens de la répression par la justice. En effet, les procès sont, ou ont été selon les différents codes de procédure, l’occasion d’une tribune pour les négationnistes, où ils pouvaient se grimer en martyrs de la liberté d’expression.
Stéphanie Courouble-Share prolonge et approfondit ce questionnement. Elle rappelle que le terme « révisionnisme » désigne à l’origine une démarche scientifique légitime : l’histoire étant une discipline critique, elle procède nécessairement par révisions, retours aux sources et nouvelles interprétations. Mais c’est précisément en s’appropriant ce mot que les négateurs ont cherché à donner une légitimité académique à leurs thèses. Robert Faurisson se présentait volontiers comme un simple « révisionniste », soucieux d’examiner les preuves « sans tabou ».
Face à cette confusion, l’historiographie a introduit à la fin des années 1980 le terme de « négationnisme », forgé par Henry Rousso dans Le Syndrome de Vichy. Ce mot avait l’avantage de souligner l’aspect frontal et idéologique de la négation. Mais il présente lui aussi des limites : il renvoie à un déni pur et simple, alors que nombre de discours contemporains relèvent plutôt de la minimisation, de la banalisation ou de l’instrumentalisation. D’où l’intérêt du concept de « distorsion », adopté en 2013 par l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Celui-ci englobe un spectre plus large de comportements : relativiser l’importance du génocide, en nier certains aspects, exagérer la responsabilité d’autres acteurs, ou l’utiliser pour justifier des positions politiques.
Stéphanie Courouble-Share ne tranche pas entre les termes, mais elle ouvre une réflexion nécessaire sur la précision lexicale. Elle montre combien l’évolution du vocabulaire reflète l’évolution même du phénomène.
En mettant en évidence cette « confusion sémantique » (p. 248), les deux articles soulignent que la lutte contre le négationnisme ne peut se limiter à une confrontation de faits et de chiffres. Elle doit aussi passer par une clarification conceptuelle, indispensable pour éviter que les mots des négateurs contaminent le langage scientifique.
Les cas nationaux : réécritures et usages politiques de l’histoire
La deuxième partie du numéro rassemble un ensemble d’études de cas nationaux. Elles montrent que la distorsion de l’histoire ne se limite pas à quelques figures isolées ou à des discours marginaux : elle est profondément liée à des projets politiques. Que ce soit en Europe de l’Est, en France, au Proche-Orient ou en Afrique, on retrouve presque partout les mêmes mécanismes : minimiser les responsabilités locales, glorifier des récits nationaux ou instrumentaliser la mémoire à des fins idéologiques. Cette mémoire est particulièrement sensible dans des pays ou des régions où les populations ont été la cible des violences de la guerre, des occupants, mais également parfois complices des déportations et extermination des Juifs.
L’Europe de l’Est : entre victimisation et occultation des responsabilités
La Pologne, occupée par l’Allemagne nazie dès 1939, mais également lieu de nombreux massacres et d’une majorité des camps d’extermination et de concentration, incarne cette tension entre recherche historique et mémoire nationale. Piotr Forecki évoque dans son article la réécriture de l’histoire du pogrom de Jedwabne de 1941, qui cristallise ces tensions. En effet, le discours public dominant en Pologne préfère commémorer les Justes polonais et nier toute responsabilité des autorités ou complicité de la population quant aux persécutions des Juifs. Cette tendance semble particulièrement portée par le parti politique PiS (Droit et Justice), dont le projet (ultra-)nationaliste n’admet pas un récit national entaché d’une collaboration avec l’Allemagne nazie, ni d’un passé violemment antisémite. Des outils juridiques sont déployés afin de punir des discours, qui attribueraient « publiquement et à tort au peuple polonais ou à l’État polonais la responsabilité des crimes nazis commis par le Troisième Reich » (p. 103). Bien que les recherches permettent d’établir une responsabilité plus largement partagée, ces conclusions sont refusées par une partie importante de l’élite conservatrice polonaise, dont certains historiens, membres du clergé ou de la classe politique.
Jan Tomasz Gross, Les Voisins. 10 juillet 1941, un massacre de Juifs en Pologne, Paris, Fayard, 2002.
En Bulgarie, étudiée par Nadège Raguru, s’observe un mécanisme similaire. La mémoire nationale y insiste sur le « sauvetage » des Juifs. L’autrice évoque la commémoration en 2023 des 80 ans de la « non-déportation » des Juifs en 1943, comme l’exemple de la politique mémorielle bulgare. Celle-ci masque une autre réalité : la déportation de 11 343 Juifs depuis les territoires yougoslaves et grecs, orchestrée par l’État bulgare. Ce pan de l’histoire est largement occulté, et l’inversion des rôles est parfois totale : le roi Boris III, pourtant acteur de ces déportations, est présenté comme un sauveur. Nadège Raguru met en lumière la porosité croissante entre savoir historique, contre-savoir idéologique et propagande politique. L’histoire devient alors un instrument de légitimation des régimes ultranationalistes, au prix d’une falsification radicale. Phénomène contre lequel il est compliqué de s’imposer, car la littérature sur le cas bulgare reste peu abondante sur le sujet et les recherches effectuées sont contestées par ces mêmes mouvements ultranationalistes.
Georgy Kasianov, lui, relève une concurrence à l’œuvre, en Ukraine, entre la mémoire de la Shoah et celle de l’Holodomor, la famine des années 1930. Si le récit national se structure autour de cette tragédie, considérée comme fondamentale dans l’identité ukrainienne, la Shoah occupe une place marginale, perçue comme une mémoire « autre », non nationale. Georgy Kasianov souligne que cette concurrence mémorielle s’ancre dans l’établissement d’une « mémoire ethnocentrée », centrée sur la souffrance du peuple ukrainien. La Shoah, au contraire de l’Holodomor, concerne des victimes juives et tziganes et n’entre dès lors que très peu dans ce « récit mémoriel nationaliste » – porté par les autorités comme par des organisations politiques. Cette marginalisation est accentuée par l’hommage rendu, tant par des autorités que par des organisations politiques, à des mouvements nationalistes ayant collaboré avec l’Allemagne nazie, tels que l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA), ou encore la division SS Galicie. Ces groupes sont aujourd’hui commémorés comme des résistants à l’oppression soviétique, leur collaboration avec les nazis et leurs crimes contre les Juifs étant largement passés sous silence. Ici encore, la distorsion n’est pas un simple oubli, mais un choix politique visant à renforcer une identité nationale unifiée et un « récit mémoriel nationaliste » – et ce encore plus depuis le début de l’agression russe de l’Ukraine en 2022.
La France et l’Alsace : réhabilitations et proto-négationnisme
Dès les procès de 1945, la défense des anciens dirigeants de Vichy, Philippe Pétain et Pierre Laval, invoque différentes théories pour justifier la complicité du régime de Vichy dans les politiques antisémites et la déportation de 76 000 Juifs, pour mieux réhabiliter ce régime. L’une était la théorie de « l’épée et du bouclier », selon laquelle de Gaulle incarnait l’épée de la résistance tandis que Pétain aurait protégé les Français. L’autre était celle du « moindre mal » selon laquelle Vichy aurait protégé les Juifs français en acceptant d’en sacrifier une partie, à savoir les Juifs étrangers, par nécessité. Un ouvrage, suivi de plusieurs autres, consolide ces mythes : l’Histoire de Vichy de Robert Aron affirme l’axiome du bouclier et de l‘épée et amorce l’idée de Pétain comme sauveur des juifs.
Claude Gounelle, Le dossier Laval, Paris, Plon, 1969 ; François de Vivie, « Giraud, la relève, les juifs. Les terribles marchandages de Laval », Historia, hors-série 14, 1939-1944, la vie de la France et des Français, vol. II : Juillet 1940-novembre 1942, la survie. 1969 ; Jacques de Launay, La France de Pétain, Paris, Hachette, 1972.
Robert Aron, Histoire de Vichy (1940-1944), Paris, Fayard, 1954.
Laurent Joly montre comment ces arguments, bien qu’affaiblis par le « réveil de la mémoire juive » dans les années 1970-1980, continuent de circuler sous des formes atténuées : relativisation, comparaison avec d’autres pays, mise en avant des sauvetages prétendument orchestrés par Vichy. Ici, la distorsion s’exprime par une réinterprétation idéologique d’éléments pourtant établis. Si ces thèses ont été largement contestées par l’historiographie, elles connaissent encore aujourd’hui des réapparitions. L’extrême droite et certains polémistes, comme Éric Zemmour, la mobilisent pour défendre une vision édulcorée et positive de l’histoire nationale.
Le cas du camp de Natzweiler-Struthof illustre une autre forme de distorsion, à laquelle l’histoire particulière du camp participe. Situé en Alsace annexée par la France, il fut utilisé à la fois comme camp de concentration et lieu d’expérimentations médicales sur des détenus juifs par les nazis, puis, après 1944, comme camp d’internement pour les suspects de collaboration par les Forces françaises libres (FFL). C’est dès cette période que ceux que Romain Blandre appelle, ici, les « proto-négateurs » expriment leurs premiers doutes sur les crimes commis par les nazis. Une rhétorique bien connue des négationnistes se déploie : par un retournement de valeur, il s’agit de faire des Alliés les principaux criminels du Second conflit mondial et de minimiser le rôle de l’Allemagne nazie. Les indépendantistes alsaciens s’y joignent : ils peuvent discréditer la France, qu’ils qualifient d’« État colonisateur », tout en se rapprochant des courants germanophiles et néo-nazis allemands. Et dès la fin des années 1970, les « Loups Noirs d’Alsace », groupe indépendantiste, s’en prennent directement au camp, en mettant le feu au musée.
Ils sont ensuite rejoints par des négationnistes « classiques », comme Robert Faurisson qui, jusqu’à la fin de sa vie, s’acharne à démontrer que la chambre à gaz de Natzweiler-Struthof n’est qu’un canular.
Israël : l’instrumentalisation politique de la Shoah
Si la mémoire de la Shoah est instrumentalisée ou détournée là où elle s’est déroulée, elle l’est également ailleurs. C’est le cas en Israël. Denis Charbit analyse un discours de Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, qui affirma en 2015 que le grand mufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, avait soufflé à Hitler l’idée de la « Solution finale ». Si l’antisémitisme d’Amin al-Husseini est bien réel, lui imputer l’idée de l’extermination des Juifs est tout simplement faux.
Pourquoi donc lui faire endosser une telle responsabilité ? Denis Charbit, rappelant qu’on ne peut « considérer l’événement comme une ‘bavure’ rhétorique maladroite et insignifiante » (p. 133), l’explique ainsi : il s’agit pour Netanyahou de nier l’existence d’une question palestinienne et de délégitimer l’Autorité palestinienne, afin d’empêcher la reprise des négociations avec celle-ci. Pour ce faire, il tente de démontrer la continuité entre les leaders nationalistes palestiniens, Amin al-Husseini et Mahmoud Abbas, rappelant leurs rôles respectifs dans les émeutes des années 1920 et de « l’Intifada des couteaux » de 2015. Il insinue ainsi une comparaison entre régime nazi et autorités palestiniennes, qui partageraient le même agenda : la destruction des Juifs. Le Premier ministre ouvre ainsi une boite de Pandore aux effets opposés : soit une réhabilitation implicite de Husseini – omettant ainsi sa complicité dans le projet génocidaire – soit une instrumentalisation de l’histoire de la Shoah dans le but « d’altérer l’image des Palestiniens aujourd’hui » (p. 134).
Émeutes survenues en 1921 et 1929 en Palestine mandataire, au lendemain de la Première Guerre mondiale et de la déclaration Balfour, inquiétant la population arabe. Les morts et blessés se comptèrent par centaines côté juif, mais aussi côté arabe à la suite de représailles.
L’exemple montre combien la mémoire de la Shoah reste un outil politique. C’est peut-être également l’un des rares cas où l’antisémitisme n’est pas une motivation, dissimulée ou revendiquée, de distorsion de l’histoire de la Shoah.
Le Rwanda : un négationnisme encore actif
Deux contributions élargissent la réflexion au génocide des Tutsi au Rwanda en 1994. Un génocide longtemps mal reconnu, souvent réduit à « une énième catastrophe humanitaire africaine se déroulant sur un continent présenté comme archaïque et barbare » (p. 320), rappelle François Robinet. Ces euphémismes ont contribué à retarder la reconnaissance de sa spécificité. Aujourd’hui encore, un négationnisme actif subsiste, relayé par certains médias ou intellectuels. François Robinet insiste sur la nécessité d’historiciser le génocide des Tutsi, en rappelant son ancrage dans l’histoire coloniale et dans les discriminations anti-tutsi, pour sortir d’une vision caricaturale et condescendante de l’Afrique – vision qui participe à une diffusion à large échelle de la négation de ce génocide.
Sont cités, entre autres, les trois ouvrages de Claude Péan (Noires Fureurs, blanc menteurs, 2005 ; Le Monde selon K, 2009 ; Carnages, 2010), le documentaire Rwanda. The Untold Story (Jane Corbin, 2014) diffusé sur la BBC, l’ouvrage L’éloge du sang (Judi Rever, 2021), ou encore l’ouvrage paru dans la collection Que sais-je des PUF Le Génocide des Tutsis au Rwanda (Filip Reyntjens, 2017) – tous utilisés dans le but de « revisiter entièrement l’histoire rwandaise et l’histoire du génocide » (p. 335).
Une négation devenue elle aussi illégale en France en 2017, quand la loi Gayssot a été étendue aux génocides et crimes contre l’humanité reconnus par la communauté internationale, et non plus uniquement ceux commis durant le Second conflit mondial. C’est ce que rappelle Hélène Dumas dans une brève contribution qui permet de comprendre les dernières avancées dans le droit français quant à la négation de ce génocide. Cette évolution légale a permis de condamner en 2024 l’essayiste Charles Onana, négationniste prolixe du génocide des Tutsi.
Le Rwanda constitue donc un exemple de négationnisme qui ne se limite pas à des groupes marginaux, mais bénéficie encore d’une large diffusion dans certains médias ou sphères intellectuelles, notamment en France.
Le tournant numérique : nouvelles formes de diffusion
Le dernier grand axe de ce numéro concerne l’impact du numérique sur le négationnisme. Deux contributions mettent en évidence les mutations liées à Internet et aux réseaux sociaux. Elles convergent vers un même constat : Internet ne voit pas naître de nouvelles thèses, mais amplifie leur diffusion et les rend plus séduisantes, notamment pour les jeunes publics.
La culture politique américaine, marquée par la primauté du premier amendement, garantit une liberté d’expression quasi absolue. Cette protection juridique, associée à une tradition libertarienne, a permis à des discours extrémistes de prospérer plus librement que dans d’autres pays, rappelle Waitman Wade Beorn. Dans l’espace numérique, cela se traduit par une forte présence de contenus négationnistes, notamment au sein de mouvements suprémacistes blancs et de l’alt-right.
Les théories négationnistes circulant sur internet reprennent les mêmes arguments que l’Institute for Historical Review (IHR) Robert Faurisson ou David Irving. Mais le numérique en change l’échelle et la vitesse de circulation. Là où la diffusion sur papier restait limitée, les plateformes en ligne permettent de toucher des millions de personnes en quelques secondes. Waitman Wade Beorn insiste particulièrement sur l’effet des algorithmes : en suggérant des contenus similaires, ils créent des bulles de radicalisation où les thèses négationnistes se banalisent.
L’Institute for Historical Review est une organisation américaine dont le but est de propager des théories négationnistes. Fondée en 1978, elle accueille des membres du monde entier et publie journaux et ouvrages niant l’existence des chambres à gaz, entre autres.
David Irving est l’une des figures centrales du négationnisme, dans le monde anglo-saxon. Il a été rendu « célèbre » lors du procès qu’il avait intenté à Deborah Lipstadt, pour diffamation, qu’il finira par perdre.
Tout autre est le cas du négationnisme du génocide arménien en Turquie : c’est ici l’État qui est à l’origine de telles thèses. Bedross der Matossian met en évidence l’existence de sites web officiels de l’État turc reprenant les codes visuels et rhétoriques des plateformes de lutte contre la désinformation. Sous une apparence scientifique et pédagogique, ils diffusent en réalité des thèses négationnistes, niant la responsabilité du gouvernement ottoman dans le génocide des Arméniens entre 1915 et 1916.
Ce procédé illustre une nouvelle forme de distorsion : non plus seulement le pamphlet militant ou le forum marginal, mais des canaux institutionnels qui se donnent les habits de la recherche académique. Cette stratégie brouille les repères du public et rend d’autant plus difficile la distinction entre savoir et propagande.
Les limites d’une réflexion utile et substantielle
La richesse de ce numéro tient à la diversité des approches : réflexion conceptuelle, études de cas, analyse du numérique. Toutefois, plusieurs limites apparaissent, qui tiennent en partie à la nature même de l’objet.
Le point faible le plus saillant est la persistance d’une terminologie flottante. « Révisionnisme », « négationnisme », « distorsion » sont utilisés de manière parfois interchangeable, comme des synonymes, au risque de brouiller l’analyse. Or ces notions ne recouvrent pas les mêmes réalités. Qualifier thèses de Faurisson ou de Rassinier de « révisionnistes », terme dont le sens scientifique désigne la relecture critique des sources, entretient l’illusion d’une démarche académique. Le terme « négationnisme » permet de marquer la dimension idéologique et militante du déni, mais il reste trop restrictif face aux formes indirectes de manipulation. La notion de « distorsion », proposée par l’IHRA, semble mieux adaptée pour désigner la pluralité des stratégies : minimisation, instrumentalisation, banalisation, concurrence victimaire.
Cette confusion terminologique n’est pas qu’un débat de spécialistes : elle a des effets concrets. Elle influence la manière dont les États définissent le délit de négation, la façon dont les enseignants présentent le phénomène, et la perception qu’en a le grand public. À cet égard, si la revue ouvre une réflexion essentielle, elle ne parvient pas toujours à clarifier les distinctions.
Une autre limite concerne le choix des cas étudiés. Ce panorama est riche, mais laisse de côté des pays où la mémoire a suivi d’autres trajectoires, notamment les pays neutres lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces contextes auraient permis d’observer la façon dont un récit national peut se construire sans la contrainte d’une défaite ou d’une occupation, et de voir si des formes spécifiques de distorsion s’y développent. Le cas suisse semble particulièrement intéressant à observer, bien que peu étudié. En effet, l’un des premiers négationnistes (voire le premier), Gaston-Armand Amaudruz, était Suisse et a permis un large point d’ancrage dans le pays pour la diffusion de thèses négationnistes.
Il faut mentionner le numéro 204 de la Revue d’Histoire de la Shoah, dédié « Aux Neutres d’Europe face au génocide (1941-1945) », 2015, et celui dédié à la Suisse en particulier : « La Suisse face au génocide. Nouvelles recherches et perspectives », n° 210, 2019.
Sarah Osman, « Si on nie cela, autant nier les pyramides et Napoléon » Histoire du négationnisme en Suisse, mémoire de recherche à l’Université de Genève, 2024.
Damir Skenderovic, The Radical Right in Switzerland. Continuity and change, New-York / Oxford, Berghahn Books, 2009.
Enfin, une place plus centrale aurait pu être accordée à la question du numérique. Le basculement médiatique est en effet l’un des grands tournants des vingt dernières années. La diffusion virale de contenus négationnistes et leur adaptation aux codes de la culture en ligne constituent aujourd’hui le principal défi. Le numéro ouvre la piste, mais laisse le lecteur sur sa faim.
Conclusion
Le 221e numéro de la Revue d’Histoire de la Shoah propose un ensemble d’analyses précieuses sur la distorsion et le négationnisme. Par ses études terminologiques, il rappelle combien les mots façonnent notre compréhension du phénomène. Par ses études de cas, il montre que les réécritures du passé ne sont pas des vestiges marginaux, mais des instruments politiques pleinement intégrés aux débats contemporains, qu’il s’agisse de glorifier des récits nationaux, de délégitimer des adversaires ou de minimiser des responsabilités. Enfin, par ses analyses du numérique, il met en lumière l’ampleur des défis posés par les nouveaux modes de communication.
Au-delà de ces apports, le numéro souligne aussi les difficultés persistantes de la recherche : comment nommer avec précision des phénomènes mouvants ? Clarifier les termes mobilisés est aujourd’hui indispensable, tant pour la recherche que pour l’action politique et éducative.
En définitive, ce numéro enrichit une historiographie déjà dense, mais rappelle que la bataille contre le négationnisme et la distorsion ne se gagne pas seulement par les faits : elle se joue aussi dans le choix des mots, dans la vigilance face aux réécritures et dans la capacité à transmettre une mémoire critique aux générations futures.
Pour citer cet article
Sarah Osman, « ‘Distorsions de la Shoah et nouveaux négationnismes’, un numéro de la Revue d’Histoire de la Shoah », Revue Alarmer, mis en ligne le 10 décembre 2025, https://revue.alarmer.org/distorsions-de-la-shoah-et-nouveaux-negationnismes-un-numero-de-la-revue-dhistoire-de-la-shoah/