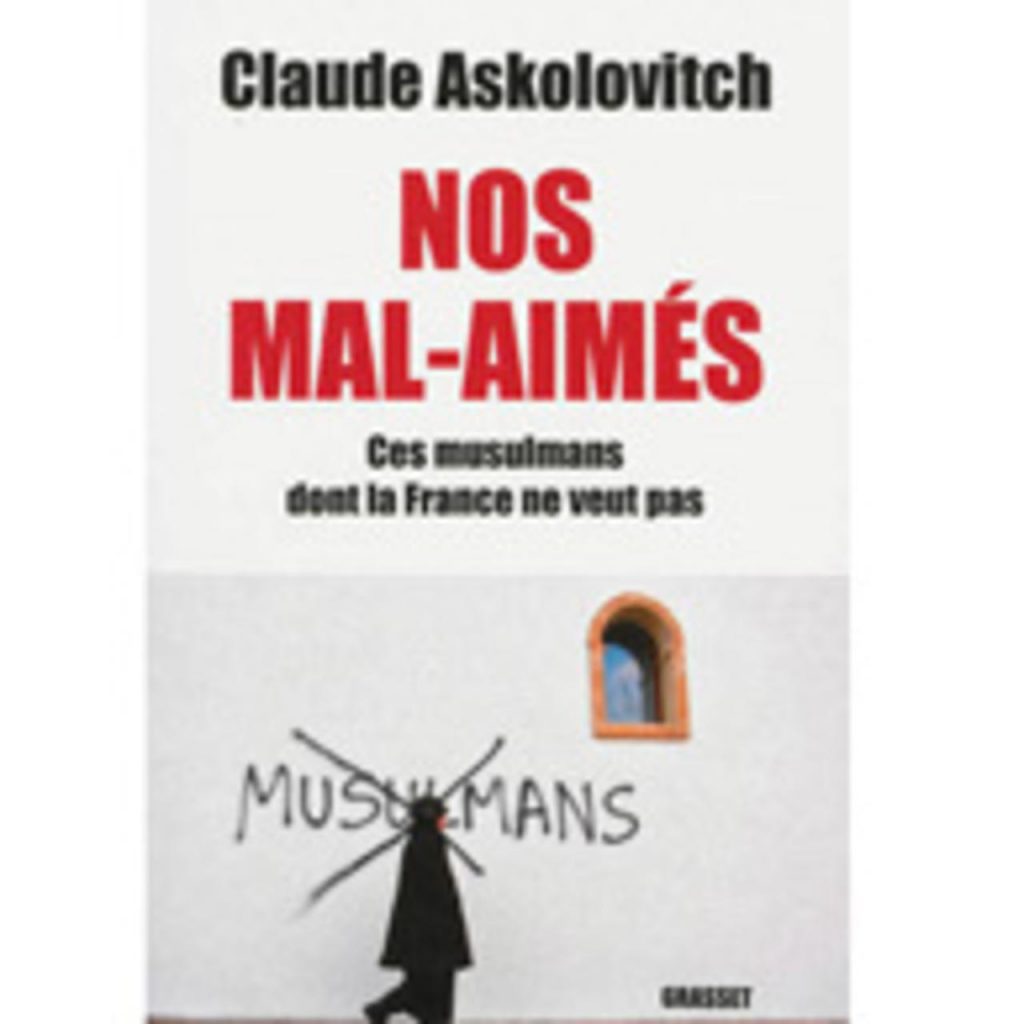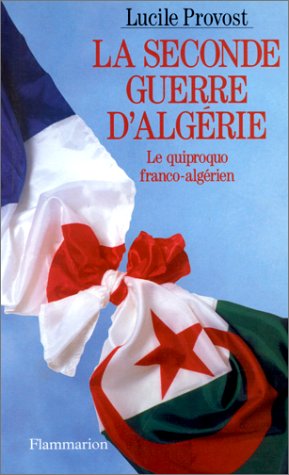De l’hérésie à l’orthodoxie
Cet article est tiré d’une communication présentée lors du colloque Sociétés sécularisées au défi des fondamentalismes religieux, MMSH, Aix-en-Provence, juin 2018.
Entre 2003 et 2017, on dénombre 17 livres publiés en France et dont le titre ou le sous-titre comportent le terme « islamophobie ». Ces publications sont le fait d’universitaires, de journalistes ou de militants qui ont, chacun à leur manière, contribué à assurer une nouvelle visibilité à un mot tombé dans l’oubli pendant plusieurs décennies, voire à le légitimer dans l’espace public. Le succès de cette diffusion, qui n’est pas sans ambigüité, relève d’ailleurs du « malentendu opératoire ».
Jean-François Bayart (dir.), La réinvention du capitalisme, Paris, Karthala, 1994, p. 200.
En effet, la popularité de son emploi doit beaucoup au flou persistant autour de sa définition (s’agit-il de la peur de l’islam ou du rejet des musulmans ?), à la restructuration du champ de l’antiracisme (qui serait clivé entre un antiracisme « moral » et un antiracisme « politique » plus enclin à employer ce terme), ainsi qu’aux polémiques récurrentes dans le champ intellectuel sur l’islam en France (avec des controverses qui opposeraient schématiquement les « intégristes républicains » aux « islamo-gauchistes »).
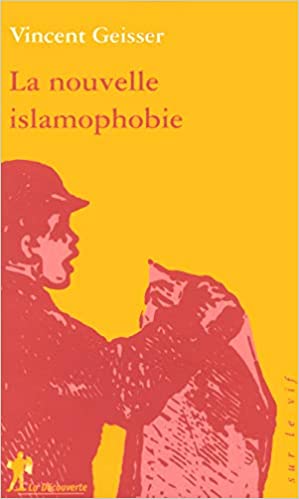
Couverture du livre de Vincent Geisser paru en 2003. 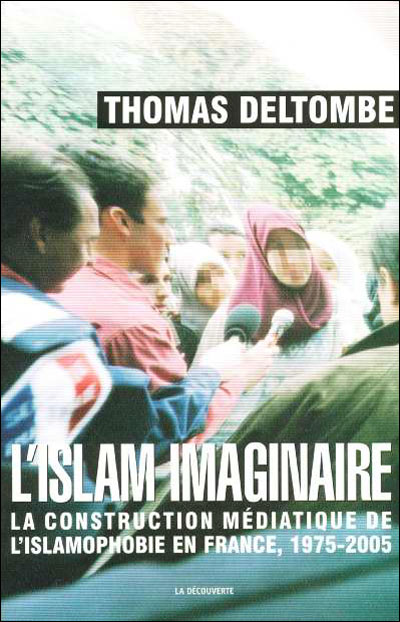
Couverture du livre de Thomas Deltombe paru en 2005.
Les 17 livres évoqués plus haut n’ont eu ni la même importance ni la même réception dans le champ intellectuel. En effet, le premier, publié par le sociologue Vincent Geisser en 2003, marque une rupture importante qu’il n’avait pas anticipée comme il le confiera dans un entretien accordé à la journaliste Nadia Henni-Moulaï – autrice d’un livre préfacé par Marwan Muhammad, porte-parole puis directeur exécutif du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), dans lequel elle définit l’islamophobie comme étant « la peur ou les préjugés vis-à-vis de la religion musulmane » –, pour le site Melting Book le 21 septembre 2017 :
Vincent Geisser, La nouvelle islamophobie, Paris, La Découverte, 2003.
Nadia Henni-Moulaï, Petit précis de l’islamophobie ordinaire, Paris, Les points sur les i, 2012, p. 11.
Avec du recul, je ne regrette pas la publication de cet ouvrage même si j’ai conscience des limites, des imperfections et des différentes formes d’instrumentalisation dont il a fait l’objet. Pour le dire franchement, j’ai été très rapidement débordé par le débat public et par les effets de diffusion du terme « islamophobie ». Il est vrai que de nombreux intellectuels, associations, mouvements et collectifs se sont emparés de ce terme pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c’est la prise de conscience publique des mutations sociales et idéologiques affectant les phénomènes racistes ; le pire, ce sont les récupérations communautaires, et parfois mercantiles de l’islamophobie, à des fins de promotion sociale et personnelle. Il est clair que la lutte contre l’islamophobie est devenue une sorte de « niche communautaire » très lucrative qui permet à certains leaders d’opinion d’exister sur la scène publique.
https://www.meltingbook.com/lutte-contre-lislamophobie-entre-altruisme-desinteresse-ambition-personnelle/
Le propos montre bien l’évolution, durant ces dernières années, des débats relatifs au concept d’islamophobie. Celle-ci est cependant inséparable de la notabilisation de certains militants qui ont porté la cause de l’islamophobie – c’est-à-dire pour la légitimation de ce néologisme dans les champs intellectuel, médiatique, politique, etc. –, à l’instar de Marwan Muhammad, auteur d’un essai publié en 2017 dans lequel il définit ce phénomène comme « l’ensemble des actes de discrimination ou de violence contre des institutions ou des individus, en raison de leur appartenance, réelle ou supposée, à l’islam ». Toutefois, il paraît difficilement acceptable de regretter les « récupérations communautaires » d’un terme qui participe pleinement d’une dynamique essentiellement communautaire, à l’instar du développement du marché halal.
Cette contribution a pour ambition de restituer les ressorts du succès apparent de cette « cause » en prenant au sérieux les publications dédiées à cet objet, à commencer par les livres, en revenant sur l’évolution du rapport de forces en faveur de ses promoteurs, en interrogeant la matrice algérienne des débats français et en prêtant attention aux institutions internationales engagées dans cette entreprise de légitimation.
Marwan Muhammad, Nous (aussi) sommes la Nation. Pourquoi il faut lutter contre l’islamophobie, Paris, La Découverte, 2017, p. 64.
Florence Bergeaud-Blackler, Le marché halal ou l’invention de la tradition, Paris, Le Seuil, 2017.
L’évolution du rapport de forces
Un livre, publié en 2013 à La Découverte – comme ceux de Vincent Geisser et de Marwan Muhammad– par deux sociologues, a participé d’une certaine consécration intellectuelle de l’usage du terme islamophobie. Celle-ci s’explique par le tournant éditorial de la rentrée 2013 marqué notamment par la sortie du livre de l’historien Kamel Meziti mais surtout par celui du journaliste Claude Askolovitch. A tel point qu’Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, dont l’ouvrage a été très bien reçu par la presse, parlent même, dans la réédition de leur ouvrage en 2016, de « transformation de l’idéologie dominante ». En effet, selon les deux universitaires :
Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman », Paris, La Découverte, 2013.
Kamel Meziti, Dictionnaire de l’islamophobie, Montrouge, Bayard, 2013.
Claude Askolovitch, Nos mal-aimés, ces musulmans dont la France ne veut pas, Paris, Grasset, 2013.
Le déni généralisé est remplacé par une reconnaissance limitée de l’islamophobie, à laquelle le livre contribue, dans la mesure où tout le travail scientifique mené depuis plusieurs années sur l’islamophobie participe à légitimation du concept et à rendre visible ce phénomène social.
Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman », Paris, La Découverte, 2016, p. 274.
Il est sans doute exagéré de parler de « transformation de l’idéologie dominante », surtout en s’appuyant sur le nombre d’articles de presse mentionnant le terme « islamophobie », même si l’on passe, selon les auteurs, d’une trentaine en 2002 à plus de 2900 en 2015 sans que l’on en sache davantage sur l’orientation de ces publications. En revanche, le champ médiatique, de plus en plus influencé par les réseaux sociaux, s’est montré plus perméable à ce néologisme porté, entre autres, par des militants très actifs sur Internet.
Mais la citation extraite de la postface des auteurs est intéressante dans la mesure où elle rappelle bien que le livre participe de la « reconnaissance » du concept d’islamophobie puisqu’un lien est établi entre le travail scientifique des sociologues et la visibilité du phénomène. C’est en cela qu’il faut saisir, à la suite de Pierre Bourdieu, le champ intellectuel comme un champ de luttes dans lequel des agents cherchent à imposer leur point de vue, c’est-à-dire « une opinion, un jugement sur le champ visant à transformer la vision du champ ».
Pierre Bourdieu, « Le fonctionnement du champ intellectuel », Regards sociologiques, n° 17/18, 1999, p. 9.
Ainsi, sur les 17 livres publiés entre 2003 et 2017, seuls 4 se montrent critiques ou réservés quant à l’usage du terme islamophobie. Le premier, publié en 2006, est le produit d’un dialogue entre le géopolitologue Pascal Boniface – au cœur d’une polémique depuis la parution de son essai critiquant l’Etat d’Israël – et la journaliste Elisabeth Schemla – qui avait publié un ouvrage avec une représentante du courant « éradicateur » durant la guerre civile algérienne. Bien qu’opposés sur divers sujets, ils se retrouvent tous les deux à présenter l’islamophobie comme « le néologisme de tous les dangers » :
Pascal Boniface et Elisabeth Schemla, Halte aux feux. Proche-Orient, antisémitisme, médias, islamophobie, communautarisme, banlieues…, Paris, Flammarion, 2006 ; Isabelle Kersimon et Jean-Christophe Moreau, Islamophobie, la contre-enquête, Paris, Plein Jour, 2014 ; Charb, Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes, Paris, Les Echappés, 2015 ; Pascal Bruckner, Un racisme imaginaire. Islamophobie et culpabilité, Paris, Bernard Grasset, 2017.
Pascal Boniface, Est-il permis de critiquer Israël, Paris, Robert Laffont, 2003.
Khalida Messaoudi, Une Algérienne debout. Entretiens avec Elisabeth Schemla, Paris, Flammarion, 1995.
Pascal Boniface
Le concept d’« islamophobie » s’est développé récemment, mais il occupe un espace conséquent dans le débat public. Il représente, à mon sens, le pendant de celui de « judéophobie », apparu en force en janvier 2002 avec la publication du livre de Pierre-André Taguieff, La Nouvelle Judéophobie, terme inventé pour établir un distinguo avec, si je puis dire, l’antisémitisme « traditionnel ». Le terme islamophobie a commencé à gagner un peu de terrain alors que le mot judéophobie s’imposait, lui, dans le langage médiatique, mais je le trouve forcément réducteur. Pire, je pense qu’il participe à la concurrence des victimes, même si je me méfie également de ceux qui la dénoncent. Nombre d’entre eux préfèreraient le monopole à la concurrence. En vérité, aucune des deux expressions ne me paraît très saine. Mais à en faire autant sur cette « nouvelle judéophobie », il n’était pas étonnant que l’on subisse, en match retour, l’apparition du terme islamophobie.
Elisabeth Schemla
Pascal Boniface et Elisabeth Schemla, Halte aux feux. Proche-Orient, antisémitisme, médias, islamophobie, communautarisme, banlieues…, Paris, Flammarion, 2006, p. 153-154.
Il est très intéressant de constater à quel moment ce néologisme émerge précisément. Il est réellement importé dans le débat intellectuel français juste après les attentats du 11 septembre 2001. Cela se passe en deux mois de temps, dans un cercle très prestigieux et très influent. Le Frère musulman Tariq Ramadan l’emploie dans une de ses tribunes que publie Le Monde, en septembre 2001 ; Alain Gresh, rédacteur en chef du Monde diplomatique le reprend dans ce journal et lui consacre, en novembre, une analyse ; enfin, Xavier Ternisien en fait la matière d’un de ses articles du Monde. Et c’est parti ! Or ces trois hommes, très liés idéologiquement, sous couvert de réfuter et de refuser les amalgames globalisants qui se font jour dans la foulée des attentats entre terrorisme et islam, violences contre les femmes et islam, ont surtout en commun d’œuvrer à présenter l’islamisme des Frères musulmans comme une pratique modérée de l’islam, comme l’avenir même de l’islam européen.
Cet échange montre qu’il était alors possible de discuter la pertinence et les origines de ce néologisme dans un contexte encore fortement marqué par les attentats islamistes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Si Elisabeth Schemla souligne les convergences entre un prédicateur et des journalistes – qui ont permis la diffusion de ce terme–, Pascal Boniface préfère rappeler qu’il s’agit aussi d’une réponse à la notion de judéophobie, tout en s’inquiétant d’une concurrence victimaire. Dans un essai personnel paru en 2015, Pascal Boniface n’emploiera plus le terme islamophobie de façon critique et s’appuiera sur le livre d’Abdellali Hajjat et de Marwan Mohammed paru entre-temps.
Cette évolution témoigne sans doute de l’évolution du rapport de forces dans le champ intellectuel, même si cette question invite les intervenants potentiels à la prudence de crainte d’être accusés d’islamophobie – entendue comme la stigmatisation des personnes supposées musulmanes. Pourtant, il serait erroné de penser que le terme fasse l’unanimité dans le champ scientifique – puisque les articles publiés dans les revues universitaires spécifiquement dédiés à cet objet sont plutôt rares –, en raison des problèmes soulevés par ce mot comme le rappelle le sociologue Gérard Mauger dans un article paru en 2016 dans la revue Savoir/Agir :
Pascal Boniface, Les pompiers pyromanes. Ces experts qui alimentent l’antisémitisme et l’islamophobie, Paris, Max Milo, 2015.
Ibid., p. 148.
La notion aujourd’hui banalisée d’« islamophobie » recouvre, en fait, un répertoire d’attitudes distinctes sinon opposées – du racisme au rationalisme – qu’elle subsume sous le stigmate d’un label « pathologisant » et qu’à ce titre mieux vaudrait sans doute s’en débarrasser.
Gérard Mauger, « Islamophobie (1). La rhétorique réactionnaire », Savoir/Agir, n° 36, 2016, p. 117.
Mais avant de nous débarrasser de ce néologisme comme l’y invite Gérard Mauger, il nous faut d’abord interroger la matrice algérienne des débats français sur l’islamophobie ou, plus largement, sur l’islam comme nous le propose par exemple l’écrivain et journaliste Marc Weitzmann dans son essai Un temps pour haïr .
Marc Weitzmann, Un temps pour haïr, Paris, Bernard Grasset, 2018.
Une matrice algérienne des débats français
Dans le premier ouvrage publié en France sur cette thématique, Vincent Geisser, qui avait travaillé sur les élites françaises d’origine maghrébine et la Tunisie contemporaine, formule l’hypothèse suivante :
L’islamophobie n’est pas simplement une transposition du racisme anti-arabe, anti-maghrébin et anti-jeunes de banlieues : elle est aussi une religiophobie. Certes, elle peut se combiner avec des formes de xénophobie plus traditionnelles, mais elle se déploie de manière autonome, ce qui explique que certains acteurs arabophiles soient aussi des « islamophobes » en puissance.
Vincent Geisser, La nouvelle islamophobie, Paris, La Découverte, 2003.
D’une part, la proposition du sociologue amalgame xénophobie – plus particulièrement le rejet des Arabes et des Maghrébins – et « religiophobie » pour expliquer le phénomène islamophobe. D’autre part, elle avance l’idée que l’on peut être tout à la fois « arabophile » et « islamophobe », de la même manière qu’il avancera l’existence d’une « islamophobie musulmane » sur laquelle on reviendra.
Le second ouvrage consacré à cette question est celui du journaliste Thomas Deltombe, paru à La Découverte en 2005, avec le soutien d’Alain Gresh et de l’éditeur François Gèze, et qui propose de distinguer deux types d’islamophobie, intégrant ainsi les critiques faites à ce terme :
En fonction des définitions possibles des mots utilisés, on doit bien distinguer deux positions : l’islamophobie de type raciste (« musulman » comme catégorie ethnique) ou « xénophobe » (l’islam comme élément « étranger ») et la critique légitime des dogmes religieux, quels qu’ils soient. (…) Mais cette distinction, nécessaire pour préserver la liberté d’expression, reste glissante. Car sous couvert de la liberté d’expression, de l’analyse critique des dogmes religieux, l’islamophobie sert souvent, de façon intentionnelle ou non, d’instrument à la « production d’un racisme respectable. »
Thomas Deltombe, L’Islam imaginaire. La construction médiatique de l’islamophobie en France, 1975-2005, Paris, La Découverte, 2005, p. 312.
Thomas Deltombe fait ici référence à une expression du sociologue et militant Saïd Bouamama qui a fait paraître en 2004 un essai sur la dernière « affaire du foulard islamique ». On doit cependant relever que, tout en rappelant la légitimité de la critique des dogmes religieux, Deltombe indique que la défense de la liberté d’expression demeure suspecte dans certains cas.
Les arguments défendus dans les deux livres font inévitablement écho au contexte postérieur au 11 septembre 2001 ainsi qu’aux vifs débats au sujet de la loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes religieux. En outre, ils partagent la même focalisation sur la question algérienne qui demeure une dimension insuffisamment explorée des débats français sur l’islam. Enfin, leur publication, en particulier l’écho important donné au premier livre, a sans doute contribué à l’entrée en 2005 du terme islamophobie dans Le Petit Robert, défini de la manière suivante :
Saïd Bouamama, L’Affaire du foulard islamique. La production d’un racisme respectable, Lille, éditions du Geai bleu, 2004.
Forme particulière de racisme dirigé contre l’islam et les musulmans, qui se manifeste en France par des actes de malveillance et une discrimination ethnique contre les immigrés maghrébins.
Le Petit Robert, 2005
Dans le premier chapitre de son livre consacré à l’islamophobie médiatique, Vincent Geisser prend position dans le conflit politico-médiatique qui, au cours de la guerre civile algérienne des années 1990, oppose le camp « réconciliateur » – favorable à une solution politique intégrant le Front islamique du salut – au camp « éradicateur » – soutenant l’interruption du processus électoral par l’armée en janvier 1992 :
Quant à l’hebdomadaire Marianne, son combat médiatique contre le « politiquement correct » se conjugue à une défense presque obsessionnelle des thèses éradicatrices prônées par certains milieux intellectuels algériens. Les enjeux de l’islam en France et dans le monde ne sont perçus qu’à travers le prisme du syndrome algérien, c’est-à-dire d’une lutte entre les « musulmans éclairés » et les « musulmans obscurantistes ». Chaque semaine, Jean-François Kahn, Martine Gozlan et Mohamed Sifaoui rejouent la guerre civile algérienne dans les colonnes de Marianne. Une telle mise en scène conduit l’hebdomadaire à assimiler abusivement les positions conservatrices de certaines associations musulmanes de France (UOIF, FNMF, etc.) aux tendances terroristes de certains groupuscules radicaux. Plus grave encore pour la déontologie journalistique, l’hebdomadaire « non conformiste » se fait souvent l’écho des thèses très officielles du régime des généraux d’Alger, accusant certains intellectuels occidentaux d’être les complices de l’islamisme mondial, entretenant ainsi le fantasme d’un lobby français à la solde des islamistes.
Vincent Geisser, La nouvelle islamophobie, Paris, La Découverte, 2003, p. 39.
Vincent Geisser reprend à son compte cette lecture manichéenne du conflit algérien dans le quatrième chapitre de son livre consacré aux « musulmans islamophobes » qui seraient surtout des personnalités d’origine algérienne ou supposées proches des autorités algériennes :
Depuis quelques années, on peut constater le développement croissant dans le champ éditorial français d’essais et d’ouvrages de vulgarisation sur l’islam et l’islamisme, écrits le plus souvent par des « intellectuels » algériens exilés dans l’Hexagone. Parmi les plus médiatiques, on peut citer l’écrivaine Latifa Ben Mansour, les journalistes Hassane Zerrouky et Mohamed Sifaoui. Liés souvent aux milieux de la gauche algérienne (parti de l’avant-garde socialiste, extrême gauche syndicale ou partisane) ou aux cercles du pouvoir d’Etat, ou aux deux à la fois, ils prétendent fonder la supériorité de leur expertise en matière d’islamisme sur leur propre expérience de « victimes du terrorisme », recourant ainsi aux registres de l’émotion, dans le style « l’Occident nous a laissé tomber dans nos malheurs pour préserver ses intérêts économiques et géopolitiques » . (…) « c’est une véritable idéologie de combat qui transparaît dans leurs propos : les essayistes algériens sont des « éradicateurs » qui s’assument sans complexe : en janvier 1992, ils avaient justifié l’arrêt brutal du processus électoral en Algérie au nom de la préservation de la « démocratie ». Aujourd’hui, ils s’attaquent systématiquement à tous ceux qui osent critiquer les très graves violations des droits de l’homme commises par l’armée algérienne pendant la guerre civile. La virulence de leurs discours rejoint parfois celle de leurs ennemis politiques, les islamistes radicaux ». (…) « leur prétendue rigueur dans le traitement des faits et des informations est souvent trahie par leur registre d’écriture qui se rapprocherait davantage de l’expertise policière et sécuritaire (DST, DGSE, etc.) que de l’analyse sociologique » (…) « Plus grave encore, ces auteurs ont en commun d’observer un silence complet sur la manipulation de la violence islamiste par les services secrets algériens, pourtant aujourd’hui largement documentée et établie, qu’il s’agisse de massacres commis par des GIA contrôlés par la Sécurité militaire ou des attentats de 1995 en France.
Vincent Geisser, La nouvelle islamophobie, Paris, La Découverte, 2003, p. 106-109.
Ce développement, qui participe d’un affrontement caricatural et tend à disqualifier le camp opposé, est révélateur de la violence des controverses parfois oubliées au sujet de la guerre civile algérienne et qui ont profondément et durablement clivé le champ intellectuel français. En reprenant l’argumentaire de son éditeur François Gèze, très engagé dans le soutien au camp « réconciliateur », Thomas Deltombe revient dans un chapitre de son livre sur l’importation en France de la « seconde guerre d’Algérie » – employant ainsi une formule employée dans les milieux intellectuels dans cette conjoncture – ainsi que sur l’ombre des services secrets algériens :
Lucile Provost, La deuxième guerre d’Algérie. Le quiproquo franco-algérien, Paris, Flammarion, 1996 ; Djallal Malti, La nouvelle guerre d’Algérie. Dix clés pour comprendre, Paris, La Découverte, 1999.
Comment se fait-il que les islamistes s’investissent d’abord prioritairement dans les Hauts-de-Seine, département d’un ex (et futur) ministre qui prendra immédiatement fait et cause pour les généraux « éradicateurs » d’Alger après leur putsch de janvier 1992 ? Pourquoi essaiment-ils ensuite de préférence dans des villes de gauche, et en particulier chez les ennemis politiques de Charles Pasqua ? Pour tenter de répondre à ces questions, on ne peut éviter d’évoquer à l’époque les liens étroits noués de longue date entre les réseaux de l’ombre de Charles Pasqua – de même que la DST française – et les services secrets algériens, comme l’ont notamment relaté en détail Lounis Aggoun et Jean-Baptiste Rivoire dans leur livre Françalgérie.
S’il est extrêmement difficile d’avoir des certitudes en la matière, tant le vrai et le faux sont mêlés, l’hypothèse d’une instrumentalisation, en sous-main, de certains groupes islamistes semble en effet fort probable. Qu’il y ait eu en France au début des années 1990, au moment où le FIS s’affirmait en Algérie, une réelle poussée du militantisme islamique dans les quartiers populaires ne fait aucun doute. Mais un faisceau convergent d’indices indique également que certains éléments de cette mouvance ont très probablement été « canalisés » – en d’autres termes, manipulés à leur insu – pour impliquer la Fraternité algérienne en France (FAF), ou en tout cas pour convaincre l’opinion française, à travers les médias, de la gravité d’une prétendue « exportation » des troubles algériens dans l’Hexagone et de la nécessité d’abandonner tout « angélisme ».
Thomas Deltombe, L’Islam imaginaire. La construction médiatique de l’islamophobie en France, 1975-2005, Paris, La Découverte, 2005, p. 200.
Cependant, chez le journaliste, la lecture du conflit algérien – et de ses ramifications françaises – à la faveur des thèses des « réconciliateurs » ne passe pas seulement par la stigmatisation des représentants du camp « éradicateur » ; elle s’articule aussi à une minimisation des problèmes posés par l’islamisme ainsi qu’à une défense de personnages comme Tariq Ramadan décrit en termes fort positifs :
Apparu au milieu des années 1990 à la télévision – il fit notamment forte impression sur le plateau de « La Marche du siècle » du 12 octobre 1994 où il fut, déjà, accusé de « double langage » par Gilles Kepel – l’intellectuel suisse sera quelque temps interdit de séjour en France par le ministre de l’Intérieur Jean-Louis Debré en 1995, avant d’être reconnu comme interlocuteur valable par de nombreux médias. Son approche de l’islam, qui pose notamment la question des rapports entre les identités minoritaires et l’universalité, entre la tradition et la modernité, entre le national et la mondialisation, intéresse ceux qui veulent sincèrement réfléchir à la place de la religion musulmane dans l’Hexagone.
Thomas Deltombe, L’Islam imaginaire. La construction médiatique de l’islamophobie en France, 1975-2005, Paris, La Découverte, 2005, p. 330-331.
Si la question algérienne n’apparaitra plus aussi explicitement dans les autres livres consacrés spécifiquement à l’islamophobie, cela s’explique notamment par la baisse d’intensité de la guerre civile en Algérie, mais aussi par le fait que les controverses sur l’islam en France auront pour objets principaux des questions internes, soulevées par des personnalités le plus souvent nées en France.
Pour autant, la matrice algérienne des débats restera présente, non seulement en raison du passé colonial de la France, mais aussi en raison de l’importante communauté algérienne implantée dans ce pays, suscitant des passions ambivalentes. Ainsi, le clivage « éradicateurs »/réconciliateurs » semble se superposer au clivage « intégriste républicain »/« islamo-gauchiste » dans le champ intellectuel. Il n’en demeure pas moins que ses postures, au même titre que les tenants de l’orientalisme ou de « l’orientalisme à rebours » – pour reprendre l’expression du philosophe Sadik Jalal al-’Azm qui désignait ainsi la tendance à essentialiser positivement l’Orient – demeurent tout autant problématiques et empêchent de cerner les enjeux internationaux de la notion d’islamophobie qui dépassent, et de loin, les frontières de la France.
Les enjeux internationaux de l’islamophobie
Sadik Jalal al-‘Azm, « Orientalism and Orientalism in Reverse », Khamsin. Journal of Revolutionnary Socialists of the Middle East, 8, 1981, p. 5-26.
D’après l’historienne et sociologue Houda Asal, le terme islamophobie (islamophobia) fut diffusé pour la période contemporaine à partir de 1997 grâce au Runnymede Trust – un laboratoire d’idées multiculturaliste basé à Londres – et aux travaux du chercheur Tariq Modood. Cependant, dès 1994, et dans un contexte marqué par les tensions engendrées par « l’affaire Salman Rushdie », le Runnymede Trust avait recommandé, à travers un rapport consacré à l’antisémitisme, d’étudier en urgence l’islamophobie en établissant un parallèle entre les deux phénomènes. Cela se concrétisa donc trois ans plus tard avec une commission présidée par l’universitaire Gordon Conway qui précisait que le mot n’avait pas été inventé par son organisation mais emprunté à la communauté musulmane. L’écho donné à ce rapport et à l’action de ce groupe permirent le financement par le Royaume-Uni d’écoles musulmanes à partir de 1997 – sous le mandat de Tony Blair – tandis que se mettait en place le Muslim Council of Britain, instance représentative musulmane conseillée par Tariq Modood comme indiqué sur son site personnel.
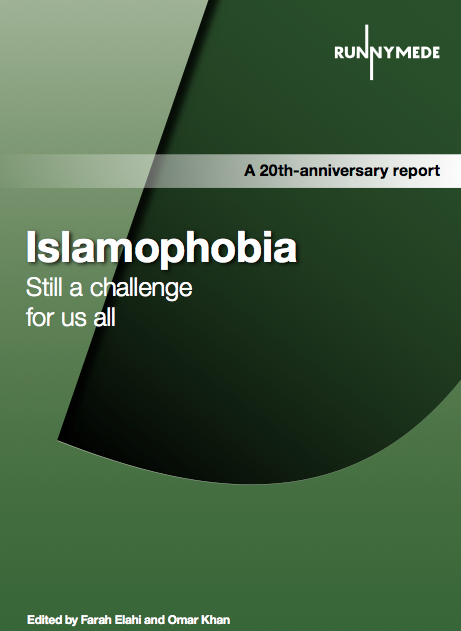
Houda Asal, « Islamophobie : la fabrique d’un nouveau concept. Etat des lieux de la recherche », Sociologie, 2014, n°1, vol. 5, p. 15.
Runnymede Commission on Antisemitism, A Very Light Sleeper. The Persistence and Dangers of Antisemitism, London, The Runnymede Trust, 1994, p. 55.
Runnymede Trust Commission on British Muslims and Islamophobia, Islamophobia: A Challenge for Us All, London, The Runnymede Trust, 1997, p. iii.
www.tariqmodood.com.
C’est donc bien cette redécouverte du terme islamophobie au début des années 1990 qui va permettre sa diffusion progressive en France, grâce à la publication de textes consacrés à cette notion, mais aussi avec la création d’associations engagées dans cette cause – comme le CCIF en 2003, la Coordination contre le racisme et l’islamophobie (CRI) en 2008, l’Observatoire de l’islamophobie du Conseil français du culte musulman en 2011 – ainsi que par sa légitimation par des acteurs centraux dans les champs intellectuel ou politique. Le 20 septembre 2003, le MRAP présidé par Mouloud Aounit organise un colloque à l’Assemblée nationale intitulé « Du racisme à l’islamophobie ». Le 17 octobre de la même année, dans un discours à la Mosquée de Paris, Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, « s’inquiète […] d’une certaine islamophobie qui se développe incidemment dans notre pays ». Dix ans plus tard, le 20 avril 2013, se tient à Sciences Po un colloque intitulé « L’islamophobie en question », tandis que le 23 juin de la même année, Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, déclare : « Personne ne doit douter de la détermination du gouvernement à combattre l’islamophobie à tout moment, et en tout lieu ». Nous n’oublions pas non plus le livre du journaliste Edwy Plenel, Pour les musulmans, paru en 2014 à La Découverte.
Mais cette dynamique nationale en faveur de la reconnaissance du concept d’islamophobie ne saurait être découplée de l’action déployée sur le plan international, notamment par l’Organisation de la conférence islamique (OCI), créée en 1969, basée à Jeddah en Arabie Saoudite et qui regroupe une cinquantaine d’Etats pour, parmi d’autres buts, « protéger et défendre la véritable image de l’Islam, lutter contre la diffamation de l’Islam et encourager le dialogue entre les civilisations et les religions » . L’islamophobie est devenue une préoccupation majeure pour l’OCI qui préconisait de créer un observatoire lors de la troisième session extraordinaire de la conférence islamique au sommet, en décembre 2005
« Histoire », <oic-oci.org>.
Au cours de leurs discussions sur le phénomène alarmant de l’islamophobie – qu’ils assimilent à une forme de racisme et de discrimination – les penseurs ont constaté avec beaucoup de préoccupation que ce phénomène hostile aux musulmans gagnait du terrain. C’est pour cela qu’ils ont fait de la nécessité de le combattre et de l’éradiquer une façon de contribuer significativement au renforcement de la compréhension entre les différentes cultures. A ce propos, les penseurs ont préconisé de suivre l’évolution de ce phénomène au niveau mondial, d’en faire un rapport annuel et d’organiser un congrès mondial pour susciter un niveau de conscience élevé afin d’inverser la tendance. Ils ont en outre invité les pays occidentaux à légiférer contre l’Islamophobie et à recourir à l’enseignement et aux médias pour le combattre. Tout en se félicitant de l’idée émise par le Secrétariat général de créer un « Observatoire de l’OCI » pour suivre l’évolution de l’Islamophobie, ils ont invité au renforcement de la coordination entre les institutions de l’OCI et les groupes de la société civile en Occident pour contrer le phénomène.
« Rapport du secrétaire général. Une nouvelle vision dans le monde musulman : la solidarité dans l’action. A la 3ème session extraordinaire de la conférence islamique au sommet, Makkah Al Moukaramah, 7-8 décembre 2005 », <oic-oci.org>.
L’année 2005 fut marquée par la publication de caricatures du prophète de l’islam dessinées par Kurt Westergaardet dont la tête fut depuis mise à prix par des islamistes qui organisèrent des manifestations violentes. Ce contexte tendu, analysé par l’anthropologue Jeanne Favret-Saada, transparaissait dans le premier rapport, présenté en 2008, et qui mentionna, parmi les « véritables causes » de l’islamophobie selon l’OCI :
Caroline Fourest, « Qui est Kurt Westergaard, le dessinateur danois ayant représenté Mahomet avec une bombe dans son turban ? », <prochoix.org>, 1er mai 2006 ; Olivier Truc, « En 2005, l’affaire des caricatures de Mahomet au Danemark et la solidarité de Charlie Hebdo », Le Monde, 7 janvier 2015.
Jeanne Favret-Saada, Comment produire une crise mondiale avec douze petits dessins, Paris, Fayard, 2015.
Abus et usage à mauvais escient de la liberté d’expression de la part des médias et de certains groupes d’intérêt. L’intangibilité de la liberté d’expression a été violée pour blesser et insulter les Musulmans par des propos provocateurs et diffamatoires, des publications de même ordre contre les symboles sacrés des Musulmans et des caricatures visant à dénigrer le Prophète Mohamed (PSL). Ces actes sont le fait d’individus, de groupes et d’organisations ayant des intérêts bien compris dans le seul but d’inciter à la violence et à l’intolérance interreligieuse.
« Rapport du secrétaire général. Une nouvelle vision dans le monde musulman : la solidarité dans l’action. A la 3ème session extraordinaire de la conférence islamique au sommet, Makkah Al Moukaramah, 7-8 décembre 2005 », <oic-oci.org>.
On saisit bien tout le potentiel liberticide d’une telle approche puisque figurait ensuite, parmi ces causes, l’« absence de mécanisme juridique pour empêcher la diffusion de documents et déclarations provocateurs incitant à l’intolérance religieuse et interculturelle, et absence d’instrument international juridiquement contraignant pour lutter contre l’avilissement des religions. »
On mesure donc combien la notion d’islamophobie, loin de se limiter aux discriminations ou violences contre les musulmans présumés, engloberait pour l’OCI les œuvres jugées « blessantes » et viserait à empêcher, sur le plan juridique, la critique de la religion musulmane. D’ailleurs, le rapport détaillait plusieurs « mesures attendues du monde occidental » appelé, à court terme, à « éviter toute déclaration, expression ou publication provocatrice et incendiaire contre les symboles sacrés de l’Islam » ou encore à « s’assurer que les programmes d’enseignement véhiculent le message et l’enseignement authentique de l’Islam ». Sur le long terme, le rapport préconisait de « veiller à ne pas ancrer dans l’opinion occidentale cette dualité consistant à croire qu’il est inadmissible de s’attaquer à la diversité raciale mais qu’il est de bonne guerre de dénoncer des religions » ou encore d’« amener les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires contre la publication de faits à caractère incendiaire, insultant et provocateur dans les médias ou sites Internet. » Pour l’OCI, les sociétés et gouvernements occidentaux devraient donc promouvoir le culte musulman, pénaliser les discours racistes au même titre que la propagande athée et modifier leur législation pour instaurer le délit de blasphème.
Le 13 septembre 2017, la rencontre « Islamophobie : vieux terme, nouvelle discrimination ? » a été organisée à l’Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient de Paris en partenariat avec l’OCI, avec le diplomate Louis Blin (ancien représentant spécial de la France auprès de l’OCI), Salima Dalibey (chargée de liaison de l’OCI auprès de l’Unesco), Alain Gresh, Marwan Muhammad (CCIF) et l’universitaire Gilbert Achcar (SOAS).
Un autre exemple montre l’intérêt réciproque entre l’OCI et des acteurs français en faveur de la reconnaissance du terme d’islamophobie. Ainsi, dans un entretien accordé à Slate, l’activiste lyonnais Abdelaziz Chaambi estimait que la Turquie faisait « du bon boulot » dans le cadre de l’OCI pour la lutte contre l’islamophobie. Après avoir fréquenté les partisans de l’islamiste turc Metin Kaplan dans les années 1980-1990, Abdelaziz Chaambi s’est rapproché du Conseil pour la justice, l’égalité et la paix fondé par d’anciens membres du mouvement Millî Görüş, fondé par le père de l’islamisme turc Necmettin Erbakan. En 2017, Abdelaziz Chaambi et sa CRI ont rejoint officiellement le Parti égalité et justice, fondé deux ans plus tôt, proche de l’AKP turc de Recep Tayyip Erdogan.
Ariane Bonzon, « Le ‘Parti turc’ aux législatives : ‘Oui, l’islamophobie est notre moteur commun’ », <slate.fr>, 9 juin 2017.
Le mélange des genres
Un ouvrage collectif publié en 2008 par l’Institut international de la pensée islamique (IIIT) France avec le soutien du département d’études ethniques de l’université de Berkeley, analyse l’islamophobie « comme facteur et vecteur de conflit néocolonial ». Dans sa contribution, Mohamed Mestiri, docteur en philosophie et directeur de l’IIIT France estime qu’
Mohamed Mestiri, Ramon Grosfoguel, El Yamine Soum (dir.), Islamophobie dans le monde moderne, Paris, IIIT France, 2008, p. 11.
un véritable combat d’idées est mené pour faire reconnaître l’existence et le délit de l’islamophobie. Mais au-delà du caractère militant du cadre auquel est soumis le problème de l’islamophobie, il est question de reconnaître des droits citoyens à des minorités musulmanes évoluant dans une culture démocratique et plurielle. (…) L’islamophobie ne serait pas simplement une folie xénophobe, inconsciente et incontrôlable, mais bel et bien l’expression d’une panne démocratique et pluraliste quant à la reconnaissance citoyenne des minorités musulmanes en Europe.
Mohamed Mestiri, Ramon Grosfoguel, El Yamine Soum (dir.), Islamophobie dans le monde moderne, Paris, IIIT France, 2008, p. 339.
Mohamed Mestiri affirme plus loin son scepticisme « quant à la prétention universelle » des valeurs culturelles européennes tout en cherchant à légitimer le prosélytisme « dans l’objectif de convaincre autrui de la véridicité de son mode religieux ». Pour lui, « l’islamophobie renvoie à la responsabilité du penseur du renouveau musulman pour construire un discours sur l’islam convainquant. »
Ibid., p. 349.
Cette affirmation tranche avec les réserves habituelles des promoteurs de l’usage du concept d’islamophobie dans le champ intellectuel français, mais elle a au moins le mérite d’attirer l’attention à la fois sur les connexions internationales d’acteurs engagés dans cette lutte symbolique mais aussi sur les enjeux proprement communautaires de la reconnaissance de ce terme.
Comme l’indiquent Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, l’université de Berkeley a contribué à « institutionnaliser les recherches scientifiques sur l’islamophobie par le lancement, en 2009, de l’Islamophobia Research and Documentation Project, hébergé par le Center for Race and Gender, et de la revue bisannuelle Islamophobia Studies Journal, crée en 2012, par le professeur de droit musulman Hatem Bazian, également cofondateur de la première université privée musulmane américaine, la Zaytuna College en 1996.
Dans un entretien accordé au journal électronique Saphir News, le 30 décembre 2013, Hatem Bazian, de passage à Paris, revenait sur le colloque international des 12 et 13 décembre consacré aux « enjeux et débats autour de la reconnaissance de l’islamophobie en Europe et aux Etats-Unis » qu’il co-organisait avec les sociologues Ramon Grosfoguel (Berkeley) et Alexandra Poli (EHESS) :
Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, op. cit., p. 279.
Le colloque a été organisé sur l’invitation de musulmans de France et je veux souligner ici le rôle particulier de Houria Bouteldja des Indigènes de la République (…) dans notre initiative. Elle a assisté à notre conférence (…) organisée l’an dernier (…) à Berkeley, qui a abouti à une résolution déclarant notre soutien et notre solidarité auprès des Français musulmans (…). Cette résolution a été unanimement approuvée par l’assemblée. Dès ce moment, nous avons décidé d’organiser des conférences en France traitant de l’islamophobie. Par notre venue ici, notre travail est de contribuer au débat sur l’islamophobie que nous observons, que ce soit sur le hijab (voile), la visibilité musulmane, la nourriture halal ou la charia… toutes ces questions qui problématisent la présence des musulmans dans les sociétés occidentales.
https://www.saphirnews.com/Hatem-Bazian-Les-musulmans-n-ont-pas-a-se-faire-beaux-pour-les-racistes_a18156.html
Cette réponse confirme ainsi ce qu’écrivaient Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed : « Les mobilisations contre l’islamophobie en France s’allient ainsi avec certains universitaires spécialisés sur cet objet, dont le travail scientifique s’articule avec leur engagement politique ». A tel point que certains intervenants de ce colloque universitaire (Ramon Grosfoguel, Abdellali Hajjat, Marwan Mohammed, Mayanthi Fernando et la sociologue Nacira Guénif-Souilamas) se retrouvaient le 14 décembre 2013 à la Bourse du travail de Paris pour un Forum international contre l’islamophobie.
A cette initiative, qui n’affichait pas de prétention universitaire mais assumait plus clairement son engagement militant, participait également Houria Bouteldja (PIR), Ismahane Chouder (Participation et spiritualité musulmanes, lié au mouvement islamiste marocain al Adl wal Ihsane fondé par Abdessalam Yassine), Samy Debah (CCIF), Mahmoud Bourassi (Collectif des musulmans de France), Tariq Ramadan, des représentants de l’ONG AFD International, des intellectuels engagés de longue date dans la reconnaissance de l’islamophobie (Thomas Deltombe, Alain Gresh, etc.), ainsi que des représentants d’organisations comme la LDH, le MRAP, Attac ou l’Union juive française pour la paix.
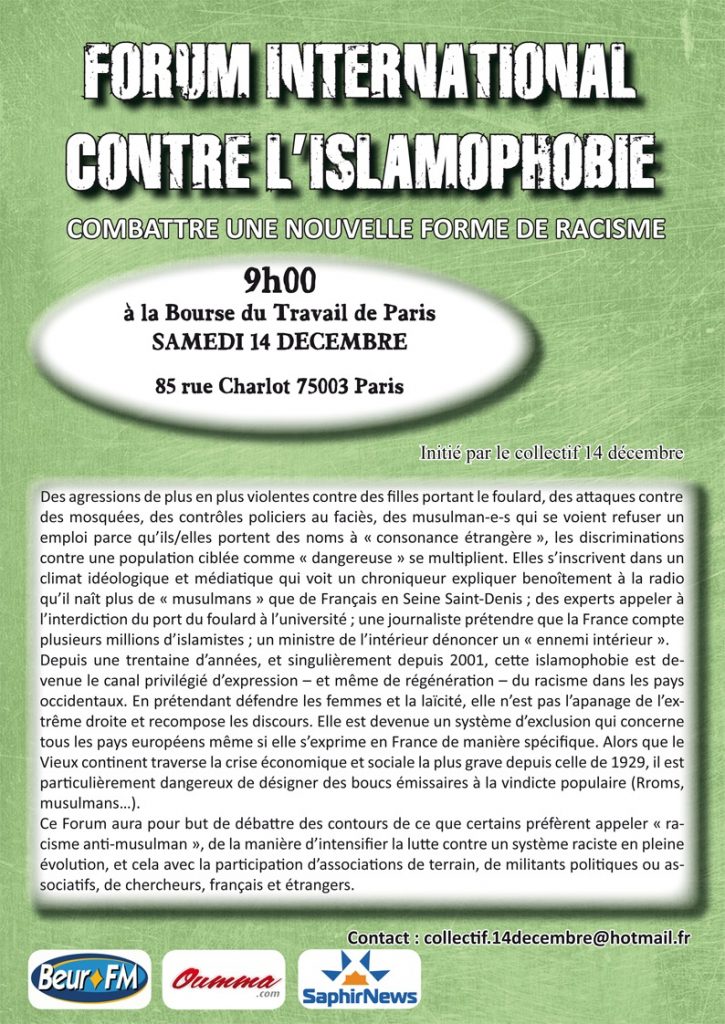
Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, op. cit., p. 279.
Ibid., p. 279.
La question de la reconnaissance du concept d’islamophobie pose non seulement la question de la pertinence de ce néologisme dans le cadre de la lutte contre le racisme, mais aussi celle des alliances entre des mouvements d’inspiration progressiste et des groupes obscurantistes qui se font les relais de partis islamistes. Elle renvoie, plus largement, à des débats cruciaux opposant des modèles de société contradictoires, notamment au sujet de la reconnaissance de communautés ou des religions dans l’espace public. Si le rapport de forces a clairement évolué, en particulier dans le champ médiatique, en faveur des promoteurs du terme islamophobie, cette légitimation conflictuelle s’est en partie fondue dans la matrice algérienne des débats français et s’est appuyée sur des réseaux internationaux pour y chercher soutiens et ressources. Par conséquent, il ne faudrait pas réduire le succès de cette entreprise à l’imposition unilatérale d’une grille de lecture anglo-saxonne d’autant que, dans son dernier rapport consacré à l’islamophobie, le Runnymede Trust a publié en 2017 une contribution de l’intellectuel Kenan Malik dans laquelle ce dernier refuse d’employer le terme islamophobie qu’il juge très problématique, sans pour autant nier l’intolérance ou les préjugés à l’égard des musulmans (anti-Muslim bigotry), et tout en défendant la liberté d’expression. Cela prouve que des approches critiques existent tout de même Outre-Manche bien qu’aucun des livres de Kenan Malik, qui s’appuie sur une vision universaliste, laïque et prenant en considération l’importance des classes sociales, n’ait été pour l’heure traduit en français.
Kenan Malik, « Fear, indifference and engagement: Rethinking the challenge of anti-Muslim bigotry », in Farah Elahi and Omar Khan (eds.), Islamophobia: Still a challenge for us all, London, Runnymede, 2017, p. 73-75.
Pour citer cet article :
Nedjib Sidi Moussa, « Islamophobie : comment une notion équivoque s’est imposée dans le débat public en France », RevueAlarmer, mis en ligne le 16 novembre 2020, https://revue.alarmer.org/islamophobie-comment-une-notion-equivoque-sest-imposee-dans-le-debat-public-en-france/