Fallait-il rééditer le best-seller de Rebatet, Les Décombres, mais aussi publier Drieu la Rochelle en Bibliothèque de la Pléiade ? Ces auteurs collaborationnistes, souvent qualifiés de « maudits », auraient, selon leurs dires, été victimes d’un oubli consécutif à l’Épuration. Or, parler d’un éventuel retour suppose l’existence préalable d’un oubli « essentiel et constitutif », pour reprendre les termes de Michel Foucault (p. 12). Tel n’a pourtant pas été le cas. Leur absence des étals n’a été que temporaire. Nombre d’entre eux ont en effet continué à être publiés par des maisons prestigieuses. C’est là l’un des paradoxes explorés dans Les écrivains collaborateurs de Tristan Rouquet, docteur en science politique, un ouvrage stimulant à plus d’un titre, issu d’un travail de thèse soutenu en 2022.
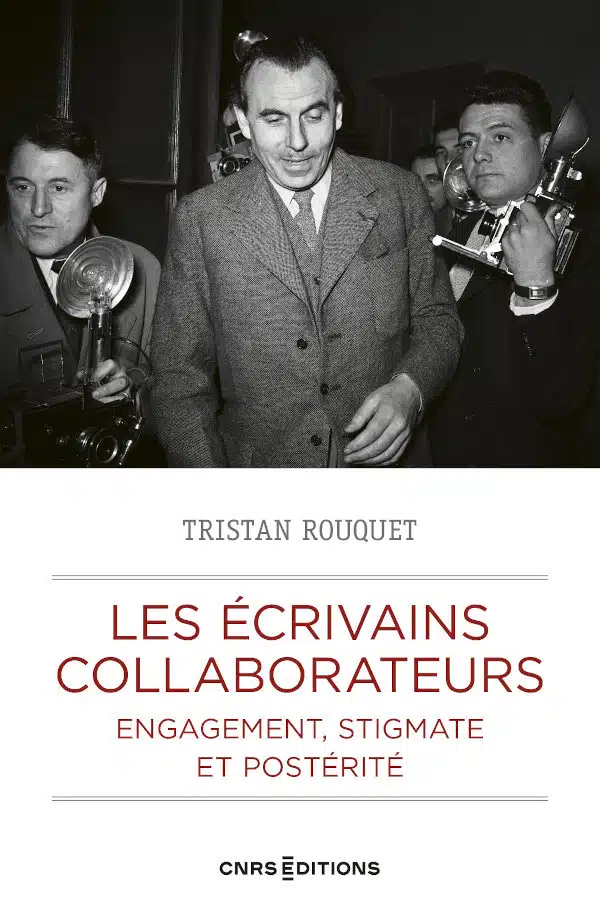
Entre histoire et sociologie politique
Déboulonner les mythes entourant la postérité parfois contrariée de ces intellectuels épurés suppose de se défaire d’une vision biaisée. Seuls quelques noms connus sont demeurés dans les mémoires et sont présents dans l’historiographie. Afin de pallier ces oublis historiographiques, l’auteur prend en compte aussi bien des figures consacrées, comme Céline, que des auteurs aujourd’hui obscurs, tel Michel Alerme. La délimitation de ce groupe repose sur deux ensembles de sources. Elle mobilise, d’une part, les listes établies par le Comité national des écrivains (CNE), publiées à l’automne 1944 dans Les Lettres françaises, et, d’autre part, l’ensemble des personnes visées par le Comité national d’épuration des gens de lettres, auteurs et compositeurs. Cela aboutit ainsi à un total de 227 individus, incluant des avocats ou encore des scientifiques comme Alexis Carrel.
Ce choix est particulièrement judicieux, permettant à la fois de mesurer de manière chiffrée l’effet différencié de l’Épuration sur l’ensemble de cette cohorte, mais aussi de les appréhender sous l’angle du stigmate, un concept hérité des travaux du sociologue Erving Goffman.
De fait, en plus de mobiliser la riche historiographie sur la droite littéraire ainsi que les biographies consacrées à certains de ces intellectuels collaborateurs, l’auteur mobilise des références lui permettant d’adopter une « perspective sociologique » (p. 25). La question centrale des « conditions sociales de la postérité matérielle et symbolique de ces individus » (p. 27) dépasse une approche strictement littéraire ou commerciale. Elle les replace au sein des « champs de production culturelle » (p. 25), dans une perspective d’inspiration bourdieusienne. Appréhendés comme des lieux d’affrontement entre pairs et concurrents, ils permettent de mettre en exergue le rôle trop souvent minimisé des intermédiaires culturels tels que les éditeurs, les critiques littéraires ou encore les libraires.
Armé de ce solide cadre théorique, l’auteur met en œuvre une démarche prosopographique qui s’appuie sur des sources particulièrement abondantes et variées. Aux états-civils consultés dans de nombreux centres d’archives départementales et municipales s’ajoutent des archives privées, policières et judiciaires. Celles-ci proviennent notamment des Archives nationales et de la Préfecture de police de Paris.
Une diversité de parcours, de leurs avant-guerres à l’Épuration
La première partie aborde ces écrivains depuis leur avant-guerre jusqu’à la période de l’Épuration. Elle s’ouvre sur un portrait collectif et sociologique de ce corpus pendant « Leur avant-guerre » (chapitre 1). Il s’agit d’un groupe essentiellement masculin, plutôt âgé (49 ans en 1940 en moyenne). Contrairement aux écrivains résistants majoritairement issus de la bourgeoisie moyenne et des fractions intellectuelles, un certain nombre de ceux qui ont collaboré sont d’extraction noble, illustrant une certaine défiance face à la IIIe République, mais aussi de la petite bourgeoisie et des classes populaires, ce qui peut expliquer un certain anti-intellectualisme.
La force de ce chapitre, et du livre de manière générale, est de rendre compte des lignes de fracture qui parcourent ce groupe de manière chiffrée. À travers les catégorisations proposées se dévoilent des trajectoires d’une grande diversité. Certains collaborateurs se caractérisent par une très forte intégration dans le champ littéraire, avec une moyenne d’âge élevée et une origine sociale aisée. À l’inverse, d’autres ont un faible voire un très faible indice d’intégration, sont plus provinciaux et publiés dans de petites maisons d’édition. Ce sont les « nouveaux entrants » sous l’Occupation qui bénéficient de l’exclusion de certains auteurs. Ils acceptent alors de se plier aux exigences des censures vichyssoise et allemande, notamment dans des publications militantes. Ils se retrouvent, de fait, dépendants de leur positionnement politique, avec une légitimité limitée à ce champ politique radical.
Cette approche empruntant à la sociologie politique se poursuit dans l’analyse de « la collaboration intellectuelle en pratique » (chapitre 2). Comme l’affirme l’auteur, « À rebours des considérations idéelles souvent associées à ce choix, prendre le parti de l’occupant et de Vichy relève en réalité de pratiques bien concrètes » (p. 88). Sous l’Occupation s’actualisent ainsi des « savoir-faire acquis précédemment » (p. 82), valorisés par le contexte. Les rétributions matérielles jouent un rôle non négligeable, la plupart d’entre eux vivant de la collaboration. Si « certains enquêtés vivent pour la collaboration, l’immense majorité d’entre eux vivent de la collaboration » (p. 93). À cela s’ajoute un entre-soi de sociabilité tissée avant-guerre ou lors de l’Occupation, offrant « un réseau et des rétributions symboliques » (p. 102). À mesure que le contexte leur devient de plus en plus défavorable, les liens d’interdépendance les unissant se resserrent, le groupe permettant de se persuader du bien-fondé de la cause. Le cas le plus caractéristique est certainement le journal collaborationniste Je suis partout qui, le 15 janvier 1944, organise un meeting salle Wagram à Paris appelé « Nous ne sommes pas des dégonflés », affirmant ainsi leur détermination à poursuivre dans la voie la plus pro-nazie. Le dernier article de Lucien Rebatet, daté du 28 juillet 1944, s’intitule d’ailleurs « Fidélité au National-Socialisme ».
Tous ces écrivains collaborateurs subissent l’Épuration, « moment de structuration du stigmate » (chapitre 3), stigmate dont la complexité est examinée par Tristan Rouquet. Il prend la forme d’une condamnation avant tout symbolique, lorsque ces auteurs sont inscrits sur les listes du CNE. Cet ostracisme ne heurte toutefois dès 1947 à un contexte changeant. Avec la fin du tripartisme, l’entrée dans la Guerre froide et surtout les rivalités entre résistants, le magistère symbolique du CNE s’effrite, rompant les chaînes d’interdépendance permettant cette mise à l’écart des épurés.
L’épuration passe également par des décisions d’ordre professionnel, prises par le Comité national d’épuration des gens de lettres. Les interdictions de publication ont été globalement bien suivies, grâce à un réseau en mesure de faire respecter ces décisions. C’est d’ailleurs le grand intérêt de ce chapitre. Au-delà des décisions prises, l’enjeu est d’analyser leur mise en œuvre effective. Cela implique de prendre en compte les différents acteurs et leurs réseaux, tant du côté des épurateurs que des épurés.
Finalement, le troisième versant de l’Épuration, l’épuration judiciaire, constitue « le plus sérieux empêchement matériel et symbolique à l’après-guerre de ces intellectuels » (p. 159). Elle s’exerce à travers la Haute Cour, chargée de juger les membres du gouvernement de l’État français, ainsi que par les cours de justice statuant au nom des articles 75 à 86 du Code pénal. Enfin, les chambres civiques sanctionnent les actes qui relèvent de l’indignité nationale par le biais de la dégradation nationale. Ce « blâme infamant » (p. 141) entraîne une série de privations de droits civiques, politiques et publics, telles que le droit de vote, ou des déchéances professionnelles.
Face à cette justice, les épurés n’ont eu de cesse de se présenter comme des victimes, et ce n’est pas le moindre des mérites du livre que de déboulonner certains mythes nés à cette époque ayant la vie dure. La figure du « lampiste », modeste bouc émissaire injustement sanctionné à la place des autres et symbole d’un supposé manque de discernement de l’épuration, « ne résiste pas à l’analyse statistique » (p. 144). De plus, si l’idée reçue d’une plus grande sévérité à l’encontre des gens de lettres est confirmée, notamment au regard du nombre de condamnations à la peine de mort, cela doit être nuancé. Nombre d’entre eux ont été jugés par contumace, ayant plus souvent que d’autres l’opportunité de fuir du fait d’un réseau de solidarité plus étoffé.
Vies et morts symboliques des intellectuels collaborateurs
La seconde partie est consacrée aux devenirs très divers de ces épurés, permettant une fois encore, de battre en brèche une idée reçue d’intellectuels collaborateurs « morts symboliquement » (p. 163, chapitre 4). En effet, malgré les condamnations, l’Épuration a davantage été une « entrave qu’un réel empêchement dans la trajectoire de ces auteurs » (p. 160). Ainsi, 73 % des cas étudiés se maintiennent dans le même secteur d’activité, principalement pour les écrivains et journalistes, pour lesquels les sanctions ont été le plus souvent temporaires. Toutefois, cela implique souvent, mais pas nécessairement, un déclassement.
La grande force de cette partie est de restituer finement les trajectoires en prenant en compte les paramètres vus en première partie qu’ils soient sociologiques ou concernant le type et la durée de la condamnation. Quatre « classes de trajectoires bibliographiques » (p. 196) ont été distinguées. Le nombre de publications avant, pendant et après l’Occupation, mais aussi le type de maison d’édition, les « grandes maisons », « petites maisons » et d’« extrêmes droites » ont été retenus comme variables.
Les autres chapitres constituant cette seconde partie analysent successivement les caractéristiques de chacun de ces groupes. Le chapitre 5 débute par l’étude du plus fourni d’entre eux, celui des « exclus » (96 personnes) comme Philippe de Zara, qui ne publient presque plus après la Libération. Vient ensuite celle des « déclassés » (54 personnes) du marché éditorial, à l’instar de Félicien Challaye, dont l’activité décroît fortement. Comme toujours, les explications sont multifactorielles et sociologiques. Si l’exclusion des premiers s’explique en partie par un taux de condamnation légèrement supérieur à la moyenne, il faut aussi et surtout y ajouter un « désajustement structurel au monde des lettres » caractérisant les exclus (p. 205). Nombre d’entre eux ont bénéficié des opportunités éditoriales offertes par l’Occupation, mais sans reconnaissance de leurs pairs. Ils sont finalement moins exclus que victimes d’un effondrement d’une conjoncture dont ils étaient trop dépendants. « Au fond, les portes de l’édition se sont-elles jamais ouvertes pour ces personnes ? » (p. 205). À l’inverse, les « déclassés » avaient, eux, davantage de renommée et disposaient d’un capital symbolique institutionnel marqué, par exemple l’Académie française avec Henri Massis, ou des publications dans de grandes maisons d’édition avant l’Occupation. « En ce sens, plus significative est leur chute après-guerre » (p. 210). L’explication principale tient à une moyenne d’âge plus élevée que les autres groupes (61 ans en moyenne en 1940), un « vieillissement biologique et social » (p. 214). Ils se trouvent en difficulté pour relancer leur carrière, notamment en raison de la « déliquescence de leurs réseaux » (p. 215). Ils doivent également faire face à la « relève de nouveaux entrants, en particulier “existentialistes”, ainsi qu’à l’évolution des goûts du public » (p. 215).
La « survie symbolique passe par une perpétuelle actualisation éditoriale » (p. 219), comme ont su le faire « survivants » et « maintenus » du marché éditorial, auxquels est consacré le chapitre 6. Les premiers ont ainsi réussi à se maintenir dans le champ éditorial, bénéficiant à la fois de leur jeunesse, 40 ans moyenne en 1940, ainsi que de premières publications précoces, souvent dans de grandes maisons d’édition. Toutefois, ils n’atteignent pas une « reconnaissance élargie et durable » (p. 223), notamment du fait de leur engagement à l’extrême droite. Le cas le plus significatif est celui d’Alfred Fabre-Luce, auteur d’un grand nombre d’essais, mais aussi rédacteur en chef du journal d’extrême droite Rivarol. « L’assurance d’une survie éditoriale se fait ici aux dépens de la postérité » (p. 227), ce qui explique la baisse significative de leur présence dès les années 1970. Toute autre est, en revanche, la trajectoire des « maintenus », comme Georges Simenon ou encore Jean Cocteau, passés à la postérité. Au-delà du talent et de la volonté de ces auteurs, « difficilement objectivables » (p. 229), leur bonne fortune provient non seulement d’un taux de condamnation assez faible, mais aussi d’un âge moyen assez jeune, leur permettant de produire de nouveaux textes et ainsi diluer le stigmate de la collaboration et échapper à la relégation. Leur bonne intégration au marché des biens symboliques joue aussi, tout comme leur production dans leur champ de la « littérature “pure” » (p. 236), par exemple le travail sur la langue d’un Céline.
Le stigmate : subi, endossé ou renversé
Les conséquences de l’Épuration ne sont pas univoques, tout comme son corollaire, le stigmate, « processus de labellisation dépréciatif » (p. 253), qu’une troisième et dernière partie envisage sous le prisme à la fois de la ressource et de la contrainte. Plus qu’une labellisation figée, l’auteur cherche à étudier un « processus de stigmatisation » (p. 254), à travers les incidences qu’il a sur les trajectoires biographiques des intellectuels collaborateurs.
Pour tous, le stigmate est avant tout subi (chapitre 7). Si les procès ont pu être utilisés comme tribunes par certains, l’Épuration a surtout fait d’eux « avant tout un groupe qui est parlé » (p. 259). L’expérience carcérale, qui touche près de la moitié d’entre eux, a incontestablement renforcé ce stigmate.
En plus des formes institutionnalisées telles que les condamnations, cette « assignation identitaire » (p. 289) a pris deux formes, dévoilant son caractère avant tout symbolique. Il y a d’une part la réactualisation de la labellisation infamante au travers d’articles ou encore d’actions symboliques, et d’autre part le silence et la proscription de ces auteurs, prolongeant de ce fait la stratégie adoptée par le CNE à la Libération. Mais leurs conséquences diffèrent en fonction de « la nature et [du] volume des différents capitaux dont disposent ces auteurs » (p. 296). Ce stigmate peut ainsi « empêcher un repositionnement dans les champs littéraire et intellectuel » (p. 296) pour ceux qui n’en disposent pas suffisamment.
L’une des alternatives, pour eux, est alors d’« endosser le stigmate » (chapitre 8), au sens d’une « substitution d’une stigmatisation assumée à une stigmatisation subie » (p. 299). Infamant dans nombre d’espaces sociaux, cet étiquetage est valorisé au sein d’une sociabilité née de l’Épuration. « Ainsi, entre les murs comme en dehors s’établit une communion dans le stigmate de la collaboration » (pp. 267-268). Mais, « Loin d’être une évidence, l’endossement du stigmate se fait souvent faute de mieux » (p. 299). Pressenti pour être le lauréat du prix Goncourt en 1953 avec La nuit commence au Cap Horn écrit sous le pseudonyme de Saint-Loup, le dévoilement de l’identité de Marc Augier, ancien militant collaborationniste engagé sur le Front de l’Est, lui fait rater le prix et l’amène à investir « totalement les espaces disponibles à l’extrême droite, qu’ils soient littéraire, journalistique ou politique » (p. 309). De fait, nombre de ces intellectuels utilisent l’entre-soi créé avant la Libération ou noué au moment de l’Épuration, pour trouver des ressources pour « (se) vivre à nouveau en tant qu’auteurs » (p. 311), notamment dans la presse d’extrême droite qui renaît immédiatement après la Libération. Mais, si « capitaliser sur ce label infamant » (p. 322) permet des « débouchés matériels et symboliques auxquels ils ne pourraient pas prétendre ailleurs » (p. 322), il agit néanmoins comme un « effet cliquet rendant socialement improbable toute réintégration à des groupes extérieurs » (p. 322).
Endosser le stigmate ne signifie pas « renverser le stigmate » (chapitre 9). Loin de cantonner dans des marges sociales et littéraires, il peut devenir une « ressource symbolique subversive » (p. 325), une marque distinctive qui permet de « légitimement occuper […] une des rares places allouées aux “déviants intégrés” ». Dans ce « panthéon de la littérature “coupable” » (p. 326), ils sont associés à des figures telles que Sade ou encore Baudelaire, ce qui contribue à « diluer leur responsabilité politique ».
Le cas de Céline est à cet égard un cas archétypal, occupant d’ailleurs une grande partie du chapitre. Le renversement du stigmate s’est opéré grâce à de nombreux intermédiaires, comme Marcel Aymé ou encore le groupe des Hussards, dont le dévouement et le réseau vont permettre la réactualisation de l’auteur collaborationniste après-guerre. L’« identité stratégique » (p. 341) élaborée vise d’une part à « résorber son antisémitisme et ses prises de position durant l’Occupation en les camouflant sous d’autres pans de son être social », notamment en conférant une portée pacifiste à ses pamphlets d’avant-guerre et en mettant en avant la figure de l’écrivain tout entier tourné vers la littérature. D’autre part, il entretient son label infamant, en « manipulant son image de traître », tout en le niant (p. 341). Céline joue donc de l’attraction-répulsion, revendiquant une marque infamante « désormais taillée sur mesure » (p. 350), bénéficiant d’une aura subversive mais délestée du crime d’intelligence avec l’ennemi. Ce stigmate, devenu ressource subversive, trouve un terrain particulièrement favorable dans la France des années 1970, alors que se développe une fascination coupable pour ce passé et une relativisation de la collaboration.
Conclusion
Au terme de cette lecture, plusieurs conclusions s’imposent. La sociologie a beaucoup à apporter à l’histoire. Les analyses chiffrées permettent de faire pièce à l’image répandue d’une mise au ban éditorial généralisé et définitif (p. 370). Au contraire, l’Épuration a eu des effets différenciés, nuancés par des facteurs sociaux tels que l’âge, le réseau ou encore le degré de reconnaissance. La place des intermédiaires est fondamentale pour comprendre ces fortunes différentes, éditeurs, mécènes ou encore libraires, mais aussi ces « entrepreneurs de morale » qui se chargent de réactualiser le stigmate. Puisse cette étude aider journalistes, décideurs, et plus généralement nos contemporains à penser et affronter les inévitables polémiques sur les commémorations passées, présentes et à venir, sur ces auteurs autoproclamés « maudits », qui, pour certains, n’ont jamais vraiment déserté les rayons des librairies.