Avec Race et histoire dans les sociétés occidentales, Silvia Sebastiani et Jean-Frédéric Schaub livrent le fruit d’un long travail collectif de recherche, entamé en 2008 à l’EHESS.
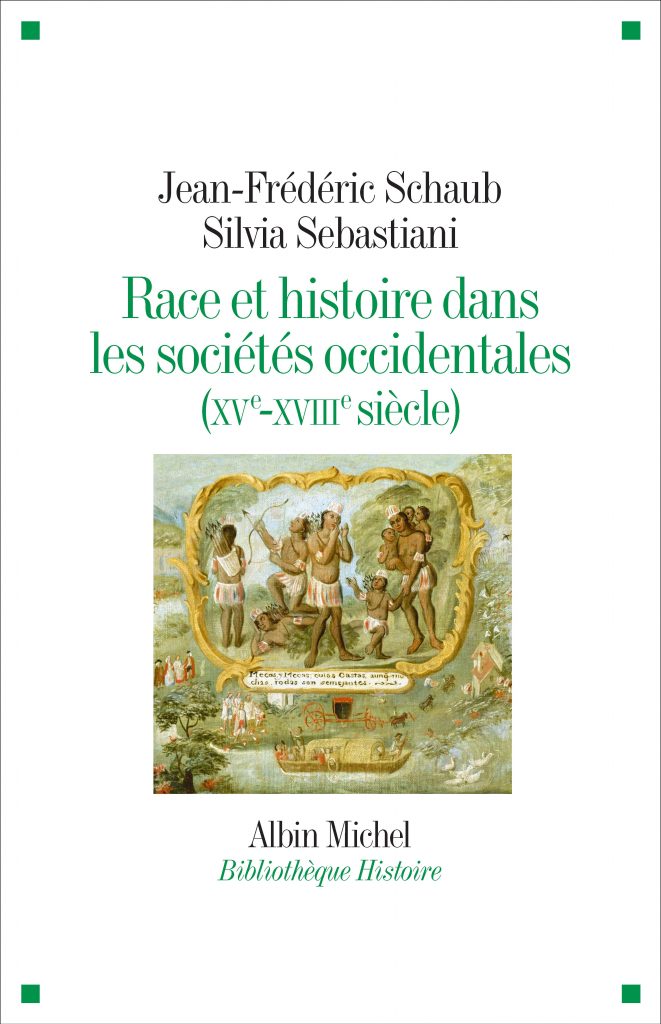
Pourquoi cet emprunt au titre du célèbre rapport rendu par Claude Lévi-Strauss à l’UNESCO, qui marque en 1951 le début de l’historiographie française sur la race ? C’est que loin d’adopter une vision fixiste du concept de race, les deux historiens réaffirment la nécessité d’historiciser la question de la race en se posant la question de sa genèse en Occident à partir de la fin du Moyen Âge. Enquête au long cours, cet ouvrage à quatre mains s’impose d’emblée comme une pièce maîtresse des débats qui se jouent, d’une part, au sein des historiens modernistes sur le bien-fondé du concept de race pour décrire les sociétés modernes, d’autre part, au sein des sciences sociales et dans le débat public à propos de la pertinence de la mobilisation du concept de race. À eux deux, Jean-Frédéric Schaub, spécialiste de l’histoire politique des monarchies ibériques sous l’Ancien Régime, et Silvia Sebastiani, dont les travaux antérieurs portent sur la question de la race et du genre au siècle des Lumières, apportent une vision complémentaire à cette interrogation historique cruciale à un moment où de nombreuses parutions témoignent du regain d’intérêt porté à ces problématiques dans le champ académique et médiatique français.
Voir en particulier Silvia Sebastiani, The Scottish Enlightenment: Race, Gender and the Limits of Progress, Palgrave Macmillan US, 2008.
Nous n’en citerons que quelques-unes parues depuis 2020 : Aurélia Michel, Un monde en nègre et blanc. Enquête historique sur l’ordre racial, Paris, Seuil, 2020. Sarah Mazouz, Race, Paris, Anamosa, 2020. Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, Race et sciences sociales. Essai sur les usages publics d’une catégorie, Marseille, Agone, 2021. Les deux numéros de la RHMC « Race, sang et couleur à l’époque moderne : histoires plurielles », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2021-2 et 2021-3, n°68-2 et n°68-3.
Entendue comme une pratique ou une idéologie, la pensée raciale est définie par J-F. Schaub et S. Sebastiani comme « la conviction que les caractères des personnes et des groupes se transmettent de génération en génération à travers des processus où interviennent, entre autres, le corps, ses organes, ses fluides » (p. 1). Cette conception accorde – nous y reviendrons – une place centrale aux notions de généalogie, de lignage et de sang et identifie le processus de racialisation à une naturalisation des rapports sociaux. Disons-le d’emblée, cette définition est loin d’être l’unique façon d’appréhender la race chez les historiens modernistes. On peut citer à titre d’exemple les directeurs du récent numéro « Race et histoire à l’époque moderne » paru dans la Revue d’histoire moderne et contemporaine, qui sans nier les apports de cette définition pointent du doigt une posture rétrospective qui affaiblirait selon eux « la complexité du contexte social, politique et épistémologique ».
Claude-Olivier Doron et Élie Haddad, « Race et histoire à l’époque moderne », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 68‑2, 2021, p. 7‑34.
Six chapitres, qui sont autant de grandes étapes de la construction de la race à l’âge moderne en Europe et dans ses colonies américaines, ponctuent l’enquête des auteurs. Les quatre premiers, écrits par Jean-Frédéric Schaub, s’intéressent à la distinction entre noblesse et roture au sein des sociétés européennes, à la relégation des conversos (Juifs convertis) dans la péninsule ibérique, à la place des métis dans les sociétés coloniales et enfin à l’esclavage des Africains. Dans les deux derniers, Silvia Sebastiani propose une analyse des Lumières et de ses contradictions sous l’angle de la race. L’ouvrage propose ce faisant une histoire totale, c’est-à-dire à la fois intellectuelle, politique, culturelle et sociale, en renvoyant à des sources variées qui empruntent au domaine de la médecine, du droit, de la littérature, de la théologie ou encore de la philosophie. Il convient par ailleurs de saluer l’entreprise historiographique considérable qui a été menée, puisque le livre met en perspective des travaux écrits en langue française et anglaise, mais aussi italienne, espagnole et portugaise.
Comme le soulignent les auteurs au début du chapitre 4 « Esclavage, couleur et race », toute étude sérieuse sur la traite et l’esclavage doit prendre en compte les travaux issus des universités latino-américaines étant donné que l’écrasante majorité des Africains déportés aux Amériques l’ont été dans les colonies ibériques (p. 229).
Dès lors, sans prétendre épuiser l’indéniable richesse de ce dense ouvrage, nous en exposerons ici quelques traits permettant une meilleure compréhension des enjeux qui divisent les sciences sociales en général et les historiens en particulier face au concept de race. Plusieurs éléments peuvent être retenus : la question de la chronologie et de l’espace à prendre en compte par les historiens qui s’intéressent à la question raciale, celle de l’usage – anachronique ou non – du concept de race pour l’époque moderne, l’épineux problème de la définition de la race , et enfin les multiples effets politiques et sociaux de la race entre le XVe et le XVIIIe siècle.
En finir avec la rupture de 1492
La chronologie des processus de racialisation est sans doute le point qui fait le plus dissensus parmi les spécialistes. Le choix fait par les auteurs d’en finir avec la rupture de 1492 constitue l’une des contributions essentielles de l’ouvrage.
Pour dater l’émergence des catégories raciales, les historiens ont jusqu’ici proposé différentes périodes : un courant, porté en particulier par l’historien de l’Antiquité Benjamin Isaac, établit que se manifestaient dès l’Antiquité un « proto-racisme » sous la forme de préjugés et de stéréotypes visant les « barbares » – une posture que Jean-Frédéric Schaub s’est déjà employé à réfuter dans son essai Pour une histoire politique de la race paru en 2015. Des historiens proposent quant à eux comme moment fondateur l’affrontement civilisationnel que sont les croisades à partir du XIIe siècle, d’autres l’expansion européenne outre-mer à partir de 1492, d’autres encore la consolidation de la traite transatlantique des esclaves africains dans la seconde moitié du XVIIIe siècle qui coïncide avec l’apparition du courant abolitionniste et des classifications raciales de l’histoire naturelle.
S’appuyant sur une chronologie renouvelée J.-F. Schaub et S. Sebastiani font commencer leur étude avant la fameuse rupture de 1492 – qui voit à la fois le premier voyage de Christophe Colomb aux Amériques et l’expulsion des juifs du royaume de Grenade. Ils choisissent de remonter au XIVe siècle, au sein des royaumes européens du Moyen Âge, pour comprendre comment les persécutions et les expulsions visant les sociétés juives, qui mèneront aux statuts de pureté de sang, ont façonné la pensée raciale en Occident. Sans cette analyse préliminaire, on ne saurait selon eux saisir les processus par lesquels les conquérants espagnols écartent les métis de la vie politique ou religieuse dans les colonies américaines.
Voir notamment Benjamin Isaac, The Invention of Racism in Classical Antiquity, Princeton and Oxford, 2004.
Il critique avant tout le préfixe « proto » pour sa dimension téléologique qui laisserait penser que le racisme était présent en puissance dans les sociétés antiques, cf. Jean-Frédéric Schaub, Pour une histoire politique de la race, Paris, Seuil, 2015, p. 128‑130.
Ces statuts, dont le premier est édicté à Tolède en 1449, touchent les descendants de juifs convertis en leur interdisant d’occuper certaines charges publiques.
Enfin, en choisissant de terminer et non de commencer leur ouvrage au siècle des Lumières, les auteurs tournent le dos à l’idée d’un racisme dit scientifique qui n’aurait émergé qu’avec l’histoire naturelle et l’anthropologie des Lumières, et selon laquelle les théories raciales précèdent les pratiques de domination raciales. Comme l’écrivent J.-F. Schaub et S. Sebastiani, « le régime politique racial n’est pas affaire d’idéologie mais de modalité de domination » (p. 228). Ce renouvellement chronologique ne les empêche pas cependant de réaffirmer dans les deux derniers chapitres la rupture que constitue bel et bien le siècle des Lumières dans l’histoire du concept de race. L’émergence d’une pensée universaliste est contemporaine en effet de l’insertion de l’homme dans le règne animal, au sein de la classe des mammifères, troublant ainsi les frontières entre l’homme et l’animal. S. Sebastiani explique cette évolution par la découverte dès le XVIIe siècle de « l’orang-outan », terme générique utilisé alors pour désigner tous les grands singes, et dont les dissections révèlent les ressemblances anatomiques avec le cops humain. Elle souligne ainsi que l’association faite par les savants de l’époque entre les Africains et les singes contribue à l’animalisation des Africains et fournit de ce fait une justification aux défenseurs de l’esclavage. Elle montre d’autre part que l’histoire de l’humanité est analysée, en particulier au sein des Lumières écossaises, à l’aune de la notion de progrès. Voltaire, David Hume, Adam Smith et d’autres décrivent ainsi comme inégale la progression des peuples dans le temps, de l’état sauvage vers le stade de la civilisation. Cette théorisation conduit à hiérarchiser ces mêmes peuples sur des critères physiques et intellectuels.
Penser l’Europe avec ses colonies
Innovant par son approche chronologique, l’ouvrage l’est également dans sa manière de considérer conjointement des espaces souvent traités séparément par les historiens modernistes qui s’intéressent à la construction de la race. De l’étude de la noblesse ou des juifs convertis au sein des monarchies européennes à celle de l’expansion européenne outre-mer, en Irlande ou aux Amériques, les différents chapitres invitent à toujours comprendre ensemble l’Europe et ses colonies, mais aussi à ne pas se focaliser uniquement sur le seul espace atlantique. Les pages 157 à 168 offrent ainsi un appréciable détour par la colonisation dans l’Europe de l’Irlande sous le joug de la noblesse anglo-normande à partir du XIIe siècle. Les auteurs y montrent comment le processus de conquête conduit à une racialisation des vaincus : celle-ci s’exprime en particulier dans les Statuts de Kilkenny en 1366 qui interdisent les mariages mixtes et toute relation sexuelle entre Anglo-Irlandais et Irlandais. Ce processus de racialisation trouve son aboutissement en 1850 sous la plume du professeur anglais Charles Kingsley, qui compare les Irlandais à des « chimpanzés blancs » (p. 168). Les chapitres 2 et 4 mettent enfin au cœur de cette histoire la péninsule ibérique, celle-ci se trouvant « aux avant-postes de l’expérience européenne » de la racialisation (p. 243). Les auteurs le rappellent par leur analyse des statuts de pureté de sang qui y touchent les conversos à partir du XVe siècle, mais aussi par le nombre important à la même époque de Noirs, esclaves et parfois libres, qui vivent dans les grandes villes de Lisbonne, Barcelone, Séville ou Malaga.
Sang et couleur
Si les auteurs ont donné à leur ouvrage une telle épaisseur temporelle, c’est pour défendre avec vigueur une idée loin d’être consensuelle : la pertinence du concept de race (sans guillemets) en premier lieu comme un outil des sciences humaines et sociales, et en second lieu comme une notion apte à décrire les sociétés occidentales européennes et coloniales de l’époque moderne. Ces deux questions qui n’en font qu’une constituent le point d’achoppement de bien des discussions tant dans le domaine politique qu’universitaire. Doit-on bannir le terme de race dans les sciences sociales en raison de la charge idéologique qu’il véhicule ? La notion est-elle anachronique pour l’époque moderne ? Les deux historiens évacuent ces questionnements dès l’introduction de l’ouvrage. Car, comme ils le rappellent, les historiens doivent composer avec le langage des acteurs des sociétés étudiées, dont le mot « race » fait largement partie, comme l’attestent les différents chapitres de Race et histoire. Si le terme de « racisme » n’apparaît qu’au début du XXe siècle, celui de « race » se trouve bel et bien dans des sources nombreuses et variées depuis la fin du Moyen Âge. Comme l’expliquent les auteurs, « race » semble être alors utilisé de manière interchangeable avec « sang » ou encore « lignage ». Les historiens le retrouvent ainsi dans le domaine de l’élevage des animaux de chasse ou de combat, pour désigner les lignées d’animaux pur-sang, exemptes de tout mélange entre races animales. Dans la lignée des travaux de l’historien David Nirenberg, le deuxième chapitre démontre notamment comment, dans le vocabulaire espagnol, le terme « raza » qui renvoyait aux croisements animaliers s’applique à partir du XVe siècle aux conversos, pour désigner ceux que l’on commence à considérer comme appartenant à une race impure en raison de leur lignage.
Le terme de « race » est aussi employé dans les multiples traités consacrés dès le XVIe siècle à la noblesse française, anglaise, espagnole ou portugaise, justifiant que la question nobiliaire soit le point de départ de l’ouvrage. Le lien fait ici entre discours nobiliaire et racial par le prisme du sang n’est, à cet égard, pas neuf dans l’historiographie, comme en témoignent les travaux pionniers d’Arlette Jouanna et Alain Devyver dans les années 1970.
Voir par exemple la tribune de Jean-Frédéric Schaub à ce sujet, « Note sur l’histoire de l’usage du terme race. Le point de vue d’un historien », RevueAlarmer, 2020, https://revue.alarmer.org/note-sur-lhistoire-de-lusage-du-terme-race-le-point-de-vue-dun-historien/
David Nirenberg, « Was There Race Before Modernity ? The Example of “Jewish” Blood in Late Medieval Spain », in Miriam Eliav-Feldon, Benjamin Isaac et Joseph Ziegler (dir.), The Origins of Racism in the West, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p.232-264.
Arlette Jouanna, L’Idée de race en France au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, Paris, Honoré Champion, 1976. Alain Devyver, Le Sang épuré. Les préjugés de race chez les gentilshommes français de l’Ancien Régime (1560-1720), Bruxelles, Université de Bruxelles.
Les liens entre race et noblesse pour le cas français ont également été analysés par Élie Haddad dans le numéro récent de la RHMC sur « la race à l’âge moderne » évoqué plus haut, quoique dans une perspective opposée à celle de J.-F. Schaub et S. Sebastiani. Élie Haddad considère en effet que la naturalisation de la supériorité nobiliaire ne peut se comprendre en termes biologiques avant le XVIIIe siècle. La semence transmise par le sang noble donnerait alors des dispositions à la vertu, mais celle-ci ne s’actualiserait que via l’éducation. Mais le premier chapitre de Race et histoire réalise la synthèse de ces travaux sur la noblesse à l’échelle européenne et expose l’importance du sang dans la construction de la supériorité nobiliaire, que traduisent des expressions telles que « bon sang ne saurait mentir ». Le sang est en effet pensé par les acteurs de l’époque comme le véhicule de qualités et tares physiques mais aussi morales et culturelles, le « chariot, qui porte, et soustient celle substance qui decoule des peres et ayeulx » comme l’exprime l’historien Pierre de Saint-Julien de Balleure (1519-1593) cité au chapitre 1. De là découle une obsession pour la généalogie des individus, que les auteurs réinscrivent au cœur de la pensée biblique, dans laquelle le péché comme l’élection divine marquent les individus de génération en génération. La littérature est aussi identifiée comme un témoin de cette centralité du sang, comme le prouvent de multiples analyses des pièces de Shakespeare ou Molière. Ces études approfondies de la distinction nobiliaire ou de la stigmatisation des conversos invitent dès lors à ne pas réduire la question de la race à celle de la couleur de peau, puisqu’on le voit, la pensée raciale prend source dans la question du sang – et les autres fluides qui en découlent – et du lignage.
Élie Haddad, « Le terme de race en contexte nobiliaire : une histoire sociale (France, XVIe siècle) », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 68‑2, p. 131‑158.
Toutefois le sens donné au mot évolue entre le XVe et le XVIIIe siècle. À la focale sur le sang succède peu à peu une préoccupation pour la couleur de peau, un processus dans lequel l’esclavage joue un rôle majeur décrit au chapitre 3. Au XVIIIe siècle, le terme de race est de plus en plus mobilisé par les voyageurs, anatomistes, savants et philosophes dans les débats à propos de l’origine des groupes humains, de la couleur de peau noire ou de l’unité de l’espèce humaine. Avec sa classification élaborée en 1735 dans son Systema Naturæ, le naturaliste suédois Carl von Linné illustre mieux que quiconque cette centralité de la couleur de peau. Celui-ci propose en effet une division de l’homo sapiens en quatre couleurs : l’homme blanc européen, l’homme rouge américain, l’homme noir africain et l’homme jaune asiatique. Toutefois, comme le souligne S. Sebastiani dans les derniers chapitres consacrés à la pensée des Lumières, l’usage de la notion de race se répand au sein des réseaux savants dans la seconde moitié du XVIIIe siècle sans jamais acquérir une définition unique. Ces chapitres invitent à considérer les Lumières comme une scène de débats où s’affrontent de multiples visions contradictoires de la race. S. Sebastiani met ainsi en regard les thèses monogénistes – qui postulent l’unité de l’espèce humaine – défendues par exemple par Linné et Buffon, et les théories polygénistes soutenues en particulier par Voltaire et Hume qui affirment l’existence de plusieurs espèces humaines différentes par nature. L’autrice souligne que malgré leurs divergences, toutes deux participent à la généalogie de la race, mettant ainsi fin au débat qui a longtemps imputé au seul polygénisme la paternité du racisme.
Une idée récemment développée par Andrew S. Curran, The Anatomy of Blackness: Science and Slavery in an Age of Enlightenment, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2011. Ou encore Claude-Olivier Doron, L’homme altéré. Races et dégénérescence (XVIIe-XIXe siècles), Ceyzérieu, Champ Vallon, 2016. Tous deux cités par les auteurs.
Gouverner par la race
Si pour les deux auteurs la race ne doit pas s’envisager dès l’époque moderne comme le produit d’une idéologie qui daterait de l’époque des Lumières, c’est qu’il faut bien plutôt l’appréhender comme une modalité de domination aux effets politiques et sociaux bien concrets.
À l’époque moderne, celle-ci est mobilisée autant pour exclure que pour distinguer et privilégier. Au sein des sociétés d’Ancien Régime, la pensée raciale a pour effet d’élever les nobles, ceux dont le « sang bleu » a été désigné comme supérieur ; elle légitime la conservation de privilèges au sein de certains lignages, sert encore à contrôler l’accès des roturiers à l’anoblissement et le rythme de cet anoblissement. L’interprétation que font les auteurs de la dialectique entre noblesse d’épée et noblesse de robe comme un « système clos et pourtant partiellement ouvert » (p. 57) est sur ce point très éclairante. Si aucun historien ne nie que cette pensée nobiliaire du sang engendre les effets sociaux mentionnés plus haut, il persiste pourtant à ce propos un point de divergence fondamental. Pour certains, en effet, l’idée formulée par les acteurs de l’époque selon laquelle le sang véhicule des qualités morales doit se comprendre comme une métaphore, ce que réfute J.-F. Schaub. Ce pouvoir octroyé au sang est selon lui une croyance véritable partagée par les hommes et les femmes du passé, ce qu’il démontre en s’appuyant sur des sources médicales, via la théorie des humeurs, mais aussi littéraires ou théologiques – le sang étant en effet au cœur de la doctrine du christianisme.
La question du sang est encore centrale dans le traitement réservé aux juifs convertis de la péninsule ibérique à partir du XVe siècle. Pour ces derniers, c’est l’impureté présumée de leur sang qui légitime leur mise à l’écart via la doctrine de la limpieza de sangre (pureté de sang). Le baptême ne suffit plus dès lors à purifier un sang considéré comme souillé par une généalogie infamante. Cette exclusion des conversos s’accompagne parfois de mesures de ségrégation spatiale voire de massacres dont les victimes sont pourtant chrétiennes. Les auteurs comparent ainsi les procédures d’enquête qui visaient à établir la « pureté de sang » d’une famille à celles ayant pour but de prouver une origine noble. Dans les deux cas, la dimension raciale de ces dispositifs socio-politiques produit des effets bien réels. À rebours d’une lecture qui insiste sur le caractère perméable des statuts de pureté de sang, l’objet du chapitre 2 est donc de prouver la nature proprement raciale de ces mêmes statuts. La religion, qui hiérarchise les bons et les mauvais croyants, est par ailleurs identifiée comme l’un des vecteurs de la distinction raciale.
Ce sont les mêmes effets de mise à l’écart que les auteurs retrouvent en Amérique ibérique contre la première génération de métis, descendants le plus souvent illégitimes de pères européens et de mères amérindiennes. L’une des thèses fortes de l’ouvrage est d’ailleurs de montrer comment les premiers conquistadors appliquent aux Amériques la doctrine de la limpieza de sangre, puisqu’à l’instar des conversos, ces mestizos sont cantonnés à un statut d’infériorité juridique. Pour faire face à la « dégénérescence » des sociétés coloniales ibériques, que les colons imputent au mélange du sang des Européens à celui des Amérindiens ou des Africains, un ensemble de catégories raciales envahit le vocabulaire social comme celles de mulato, mestizo, pardo ou zambo, qui ancrent les individus dans une généalogie. Ces combinaisons sociales sont largement illustrées au XVIIIe siècle par le genre des pinturas de castas, peintures de castes. Alors que celles-ci ont souvent été utilisées par les historiens comme la preuve de sociétés exaltant le métissage et de la facilité pour un individu de passer d’une catégorie à une autre, J.-F. Schaub renverse là encore cette perspective pour insister sur la rigidité de ces règles de classification. Ainsi, si le jeune Juan Díaz, vivant en Nouvelle-Espagne, parvient à la fin du XVIIIe siècle à se faire enregistrer comme espagnol dans les registres paroissiaux malgré son origine métisse, il se voit refuser la main d’une jeune fille d’ascendance créole au nom de sa réputation de « pardo » : un exemple qui illustre la ressource que représentait l’imaginaire racial dans les pratiques de discrimination entre populations.
Le terme désignait dans l’empire espagnol les personnes d’ascendance mixte ou de « sang-mêlé » et parfois les personnes noires.
Enfin, la surexploitation des esclaves africains au sein des sociétés esclavagistes des empires coloniaux européens aux Amériques est également analysée dans l’ouvrage comme la manifestation de la race comme outil socio-politique. Avec l’esclavage massif des Africains, la race en vient à se confondre avec la couleur de peau, et le terme « nègre » devient synonyme d’esclave. L’expression, largement employée dans l’historiographie, d’« esclavage racial » rend compte de ce tournant. Celle-ci renvoie à une conception de l’esclavage dans laquelle les Africains auraient vocation à être esclaves en raison d’une prétendue infériorité naturelle qui se manifeste en particulier par certaines caractéristiques physiques, comme la couleur de peau noire, et qui justifie leur déshumanisation et leur exploitation. Les pages consacrées au Code noir de 1685 et ses effets rappellent ainsi le statut ambigu de l’esclave africain, considéré à la fois comme un bien meuble et un être humain, sans être un sujet de droit. La différenciation des traitements réservés aux serviteurs blancs engagés et aux esclaves noirs – que ce soit dans les colonies anglaises ou françaises – est encore la marque de la racialisation des Africains. Au-delà de la seule question de l’esclavage, les auteurs s’intéressent à l’émergence de la catégorie des libres de couleur dans toutes les sociétés esclavagistes des Amériques. Par l’étude des exclusions ou vexations imposées aux libres de couleur, comme à La Havane dès le XVI e siècle, en Virginie au XVIIe siècle, et dans la plupart des colonies américaines au XVIIIe siècle, ils démontrent que la « dimension raciale de l’africanité […] transcende la distinction entre statut libre et statut esclave » (p. 285). Ainsi, la sortie de l’esclavage ne permet pas d’échapper à la « noirceur ». Et pour les auteurs, les phénomènes de passing, comme celui de la vente de gracias al sacar (certificats de blancheur) par la monarchie espagnole à partir de 1796, soulignent l‘efficacité d’un régime bel et bien fondé sur la race, là où d’autres y voient le signe de relations sociales négociées et fluides.
Le passing désigne le fait pour un individu d’apparaître aux yeux d’autrui comme le membre d’un autre groupe social que celui dont il est originaire. En l’occurrence, le passing renvoie au fait pour une personne non blanche de revendiquer avec succès l’appartenance au groupe des Blancs.
Pour un aperçu de cette approche dans le cas de l’empire français, voir par exemple Baptiste Bonnefoy, « Les langages de l’appartenance. Miliciens de couleur et changements de souveraineté dans les îles du Vent (1763-1803) », L’Atelier du Centre de recherches historiques, 20. Ou Frédéric Régent, « Du préjugé de couleur au préjugé de race, le cas des Antilles françaises », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 68‑3, 2021, p. 64‑90.
En définitive, c’est une vision très aiguisée de la race que ce nouveau Race et histoire propose, où l’usage de la notion est toujours justifié et contextualisé au prisme de la situation historique étudiée. Trois sources de racialisation ont été identifiées pour l’époque moderne : la distinction sur des générations entre descendants de conquérants et de vaincus, la religion et ses hiérarchies et les relations au travail. Soucieux d’éviter tout raisonnement téléologique, les auteurs rappellent en conclusion que la progression chronologique qu’ils proposent ne s’apparente pas à une histoire linéaire de la race qui mènerait tout droit aux génocides du XXe siècle et au racisme d’État que sont l’apartheid et les lois Jim Crow. À la lecture de cet ouvrage, on comprend en réalité combien les catégories raciales sont à considérer comme des ressources politiques et les régimes raciaux comme des modalités de domination et on s’affranchit ainsi d’une lecture qui consisterait à envisager les processus de racialisation uniquement comme le fruit d’une idéologie préétablie.
Pour citer cet article
Domitille de Gavriloff, « Race et histoire dans les sociétés occidentales. (XVe-XVIIIe siècles). Un livre de Jean-Frédéric Schaub et Silvia Sebastiani », Revue Alarmer, mis en ligne le 21 janvier 2022.
https://revue.alarmer.org/race-et-histoire-dans-les-societes-occidentales-un-livre-de-jean-frederic-schaub-et-silvia-sebastiani/