Le 28 décembre 1956, Amédée Froger, 74 ans, monte dans sa voiture lorsqu’il est abattu de plusieurs balles de revolver devant chez lui, rue Michelet, dans un beau quartier d’Alger. Le meurtre de ce notable, maire de la localité de Boufarik, connu pour ses positions intransigeantes en faveur de l’Algérie française, suscite une grande émotion. Depuis plus de deux ans, des groupes algériens ont entamé une lutte armée, émaillée d’attentats, pour obtenir l’indépendance. Lors des obsèques de Froger, le lendemain de son assassinat, des Français d’Algérie se livrent à des violences particulièrement brutales à l’encontre de musulmans qui ont le malheur de croiser le cortège funèbre.
Dans son ouvrage, l’historienne Sylvie Thénault, directrice de recherche au CNRS, étudie les ressorts de ces ratonnades.
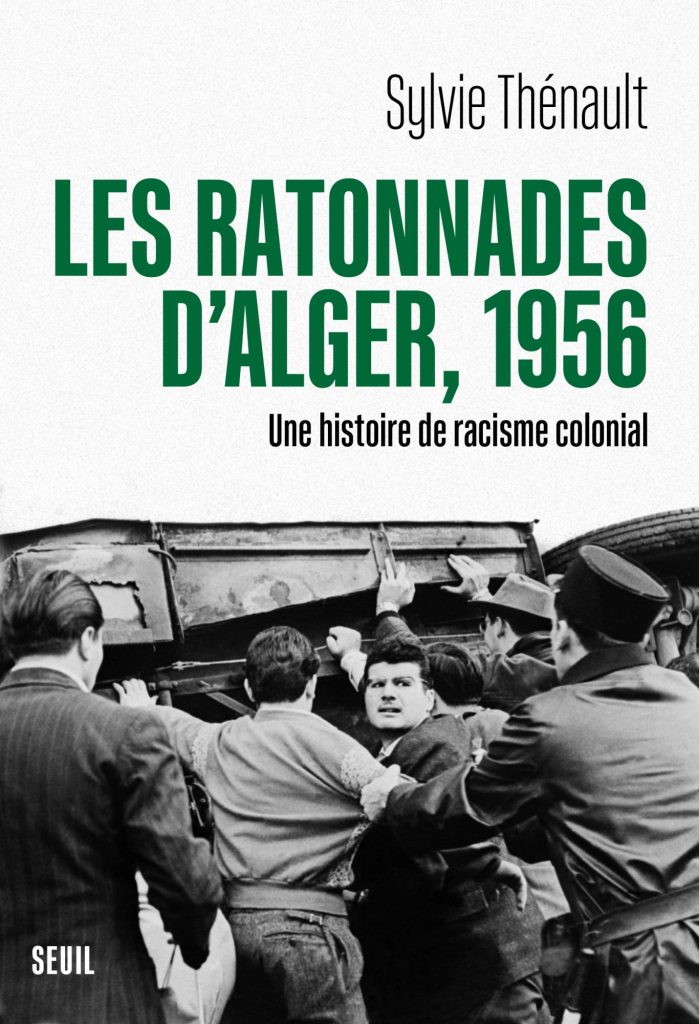
Comment en êtes-vous venue à écrire ce livre sur des ratonnades en Algérie coloniale ?
Mon intérêt pour cette histoire remonte à la fin des années 1980. Je le dois au mouvement antiraciste, dont la pédagogie puisait alors dans le passé, en particulier de la guerre d’Algérie, et montrait que le racisme pouvait conduire à des violences.
Quelques années plus tard, lorsque j’ai commencé mes recherches, mon sujet ne portait pas directement sur le racisme colonial, mais au cours de mes dépouillements en bibliothèque, je suis restée stupéfaite en découvrant un article du journal Le Monde daté du 1er janvier 1957 qui racontait en détails les ratonnades qui se sont déroulées lors des obsèques d’Amédée Froger. Je n’avais jamais entendu parler de ce type d’événement. L’article fournissait une illustration frappante de cette pédagogie qui m’avait conduite à m’intéresser à cette histoire.
Je ne pouvais rien en faire dans le cadre de ma thèse, qui concernait l’appareil judiciaire, mais cet épisode m’a tellement frappée, que je l’ai gardé dans un coin de ma tête pendant assez longtemps avant de savoir de quelle manière m’en saisir en tant qu’historienne.
Bien plus tard, je suis allée consulter les archives et là j’ai été très étonnée de constater qu’il s’agissait d’un événement bien documenté, qui s’est déroulé en plein jour, à des heures d’affluence, sur environ cinq kilomètres dans les rues d’Alger, donc potentiellement au vu et au su de tous. Et pourtant, c’est un événement qui a été oublié.
Cet oubli est-il à mettre en lien avec l’absence d’images iconiques de ces ratonnades de décembre 1956 ?
Les photos qui nous restent aujourd’hui sont celles qui ont été publiées dans la presse. Elles ne montrent pas les violences sur les personnes. Celle qui est en couverture de mon livre nous montre des dégâts matériels. Elle provient de l’AFP qui n’a pas conservé l’intégralité des clichés qui lui sont parvenus par sa filiale chargée des photographies à l’époque. Cette photo en couverture est à mon sens un choix par défaut, car j’aurais préféré montrer les violences sur les personnes. C’est important à mes yeux.
Vous palliez cette absence en décidant de décrire ces violences le plus précisément possible…
En effet, j’ai voulu raconter ces violences de manière à ce qu’on se rende compte de ce qu’elles furent réellement. Je pense que pour bien travailler sur ce type de violences, il faut les décrire, faire prendre conscience de ce qu’elles sont concrètement. Dire qu’une arcade sourcilière saigne ou que des dents tombent, pour moi, en tant qu’historienne, ça a du sens.
Comment ces violences sont-elles traitées dans les sources ?
On dispose de rapports de police, mais les agents qui observent ce qui se passe n’ont pas pour objectif de documenter les gestes de violence. Ils veulent mesurer la menace dans un contexte où les mobilisations pro-Algérie française s’accompagnent de multiples complots qui visent un renversement du pouvoir. Leurs rédacteurs utilisent des euphémismes en écrivant que des musulmans ont été « pris à parti » ou « molesté ». Heureusement, les journalistes sont là eux pour raconter.
Vous avez donc décidé de reprendre l’enquête.
J’ai commencé à dépouiller les comptes rendus parus dans la presse, les sources policières et les rapports des Renseignements généraux en m’interrogeant notamment sur l’identité des auteurs de ces violences. Je m’attendais à y trouver des informations concernant le rôle de groupuscules d’extrême droite, d’autant qu’ils sont alors particulièrement surveillés. Or, ce n’est pas du tout ce qui s’est passé.
D’après toutes les sources, les ratonnades n’ont pas été initiées par des meneurs connus des RG. Elles ont été commises par des gens ordinaires, peut-être, par ailleurs, bons pères de familles, étudiants ou anciens combattants décorés, bref par des « anonymes » qui, parmi les milliers de personnes qui suivent les obsèques d’Amédée Froger, se détachent subitement du cortège et s’en prennent à des Algériens le long du trajet. C’est ce qui m’a conduite vers l’idée qu’il fallait que je cherche ce qui faisait surgir ces violences dans le fonctionnement de la société coloniale.
Ces violences sont-elles spécifiques à la période de la guerre d’indépendance ou existaient-elles avant ?
Ce qui existe de façon absolument claire depuis la conquête, c’est le droit pour les colons (au sens des migrants venus d’Europe, de France ou d’autres pays) d’exercer une forme d’auto-défense. À plusieurs moments dans l’histoire de l’Algérie coloniale, des groupes armés ont été officiellement appelés à participer au maintien de l’ordre. Cependant, on n’avait pas de travaux sur ce que j’appelle des ratonnades, c’est-à-dire des violences qui ne résultent pas de formes organisées, comme avec des milices. Dès le début de la guerre, en novembre 1954, face aux attentats du FLN, certains Français d’Algérie revendiquent le recours à l’autodéfense. Il s’agit en fait d’une tradition de longue durée qui remonte à la période de la conquête. Elle légitime l’intervention de petits groupes de civils en armes dans le maintien de l’ordre, autrement dit le fait que l’on puisse se substituer aux autorités de l’État et faire violence soi-même.
À propos de la possession des armes à feu à la fin du 19e siècle, vous citez le juriste colonial Émile Larcher qui, dans un ouvrage publié en 1899, résume la situation en Algérie : « Seuls les citoyens français, comme autrefois les nobles, sont appelés à porter les armes »…
En effet, la suprématie des Français d’Algérie se signale par une série de signes de distinction et le port d’armes est non seulement une façon de se prémunir d’attaques, mais surtout un moyen de défendre un ordre, tout en assurant à ses détenteurs un prestige social et le maintien d’un statut privilégié.
Dans le premier chapitre, je raconte qu’à la suite de l’attentat contre Froger plusieurs hommes brandissent une arme et tirent dans les rues pour tenter d’abattre le meurtrier qui s’enfuit. Parmi eux, se trouvent un électricien et un inspecteur des impôts. On voit concrètement à quoi peut ressembler la guerre à Alger : ça ressemble au Far West. Si un électricien peut brandir une arme et tirer sur un fuyard, c’est qu’en réalité les armes sont omniprésentes. Elles sont là pour compenser l’infériorité numérique des Français d’Algérie et leur permettre de maintenir l’ordre sachant que, depuis la conquête, ils se vivent comme sous menace permanente dans une sorte de citadelle assiégée alors même que ce sont eux les occupants du pays. Ce renversement de perspective, cette inversion est au cœur de mon interprétation des ratonnades sur la longue durée. En 1954, la société algérienne est composée d’environ un million d’Européens et de huit millions de musulmans, selon les catégories de l’époque. Cette minorité française d’Algérie a conscience que la colonie ne peut tenir qu’à condition d’inférioriser en permanence la majorité algérienne.
Quelles sont, d’après vous, les causes de ces ratonnades ?
Le terrorisme des organisations indépendantistes a évidemment eu un effet psychologique très important sur les Français d’Algérie. C’est la raison pour laquelle je raconte en détails l’attentat contre Amédée Froger dès le début de mon livre. Cependant, si les ratonnades avaient eu lieu le jour même, si, au fur et à mesure que la nouvelle de l’attentat se répandait dans la ville, les gens étaient sortis de chez eux pour s’en prendre de suite aux musulmans, je n’aurais pas essayé d’éclairer la dynamique sociale profonde à l’œuvre dans l’événement. Or, les ratonnades n’ont eu lieu que le lendemain et selon des modalités montrant que l’attentat n’est sans doute pas le seul facteur de leur déclenchement.
Lorsque le 28 décembre 1956, Amédée Froger est tué, on sait qu’il risque d’y avoir des violences lors de ses obsèques. Je cite d’ailleurs dans mon livre un commissaire de police qui affirme que la prévention des violences lors des obsèques de membres de la communauté pied-noir, et surtout de personnalités impliquées dans la mouvance Algérie française, est un enjeu majeur des missions de maintien de l’ordre : il faut essayer d’éviter que les Algériens ne soient pris pour cibles. D’ailleurs, des consignes circulent pour conseiller à ces derniers de rester chez eux. Les autorités insistent auprès de la famille du défunt pour que l’enterrement ait lieu rapidement, le lendemain de l’attentat, pour éviter que des groupes d’extrême droite ne s’organisent. Cela montre à quel point les ratonnades constituent des formes de violence routinisée dans l’Algérie coloniale.
On remarque, à la lecture de votre livre, que vous ne donnez pas de définition a priori du terme de ratonnade…
Ce qui compte pour moi, c’est ce que les mots signifient pour les acteurs de l’époque. En l’occurrence, on comprend, d’après ses contextes d’emploi, que ratonnade désigne des violences racistes qui prennent pour cibles des musulmans. Le plus important n’est pas d’en donner une définition, mais de constater que ces catégories étaient tellement évidentes pour les contemporains qu’ils ne ressentaient même pas le besoin de définir ce qu’est un musulman ou un Européen – pour eux, ça se voyait, ça allait de soi.
Il s’agit là de catégories raciales qui mélangent des caractéristiques physiques, sociales et culturelles. Ce qui fait que quelqu’un est classé dans une catégorie ou une autre, c’est non seulement son faciès ou sa profession, mais aussi sa façon de s’habiller, car le vêtement est un marqueur d’identité très fort. C’est une combinaison de toute une série de critères qui fait que, quand on voyait quelqu’un, on pouvait se dire, « tiens, celui-là, c’est un Européen » ou « c’est un musulman ».
En réalité, la société coloniale algérienne est divisée en trois groupes hiérarchisés : les Européens, les juifs et les musulmans. Les Européens bénéficient d’une suprématie dans tous les domaines, alors que les musulmans sont constamment infériorisés. Quant aux juifs, ils occupent une position intermédiaire : c’est une population assimilée à la catégorie dominante, mais qui conserve une situation précaire. Comme les Européens, ils sont pleinement citoyens, sauf qu’à différentes périodes, ils sont confrontés à des flambées d’antisémitisme – c’est le cas à Alger à la toute fin du XIXe siècle, dans les années 1930 ou encore évidemment sous Vichy, lorsque l’abrogation du décret Crémieux leur retire la nationalité et la citoyenneté françaises.
Ce qui définit une société coloniale, c’est un idéal d’organisation des populations en catégories rigides et hiérarchisées – au contraire d’une société tolérante qui se caractérise par le respect de la fluidité et de la complexité des identités. Jamais cependant une telle organisation, comme dans les sociétés coloniales, ne peut correspondre à la réalité du monde social, alors il faut autoritairement et par la violence obliger les gens à rester dans une catégorie et pas dans une autre.
Votre livre commence par l’attentat contre Froger, puis vous analysez la société coloniale dans laquelle Froger évolue et qui va rendre aussi possible des phénomènes fréquents de ratonnades. Pouvez-vous parler de la troisième partie ?
Je tiens particulièrement à cette troisième partie, qui porte sur Badèche Ben Hamdi, jugé coupable du meurtre. Mon livre commence par un assassinat et se termine par la décapitation d’un condamné à mort. Le sort de ce dernier m’importe beaucoup. D’abord, parce qu’il est issu des couches les plus défavorisées de la société algéroise et en cela, il révèle les conditions économiques et sociales de l’injustice coloniale. Et puis surtout, son destin est exemplaire de la brutalité de la répression : arrêté en février 1957, il est torturé en détention, condamné par un tribunal militaire en avril et enfin exécuté en juillet. Les Français d’Algérie, qui reprochaient à la justice son laxisme, n’eurent de cesse de revendiquer l’exécution effective des condamnés à mort algériens tout au long de l’année 1956. Il est évident que tous les justiciables n’ont pas été traités de manière aussi rapide. L’administration de cette peine confirme le caractère racialement différencié de la répression que j’avais déjà pu mettre en évidence dans mes précédents travaux sur le droit et la justice en contexte colonial.
Voir Sylvie Thénault, Une drôle de justice. Les magistrats dans la guerre d’Algérie, La Découverte, Paris, 2004 et « Justice et droit d’exception en guerre d’Algérie (1954-1962) », Les Cahiers de la Justice, vol. 2, n° 2, 2013, p. 71-81.
Les différences dans la société coloniale entre Amédée Froger et Badèche Ben Hamdi se reflètent aussi dans le déséquilibre des sources.
En effet, cette attention que j’ai voulu porter à Badèche Ben Hamdi résulte d’une réflexion plus générale sur la manière dont, en histoire, nos sources et nos processus d’écriture font exister certains acteurs sociaux au détriment des autres. On sait très peu de choses sur Ben Hamdi. J’ai donc tout fait pour minimiser ce déséquilibre : il y a des détails que je ne donne volontairement pas pour brosser le portrait de Froger, l’élu, le notable, qui était un homme puissant dont les descendants ont retracé le parcours, alors qu’au contraire j’ai dû fouiller au maximum pour redonner vie à Ben Hamdi, qui était, lui, un subalterne.
D’ailleurs, le sort de Badèche Ben Hamdi n’est pas étranger au racisme à travers l’identité assignée par l’état civil. Ce monsieur a été appelé SNP (sans nom patronymique) : c’est une forme de violence par la renomination, la recomposition de liens de famille.
Dans votre livre, vous expliquez de manière particulièrement précise la géographie de la ville d’Alger. Quels liens établissez-vous entre l’urbanisme et les violences qui sont au cœur de votre ouvrage ?
Les habitants d’Alger avaient une perception de l’espace comme étant ségrégué entre Européens et musulmans. Le document qui m’a mise sur cette piste est une directive d’un commissaire de police nommé Builles, en charge du service d’ordre pendant les obsèques d’Amédée Froger, qui donne l’ordre d’isoler les quartiers européens des secteurs musulmans.
Aujourd’hui encore, lors de mon enquête de terrain à Alger, plusieurs personnes m’ont parlé de la rue Michelet, où vivait Froger, comme d’une rue où ils ne pouvaient pas aller. Une habitante de la rue Michelet témoigne spontanément après l’attentat pour dire qu’elle avait, juste avant le meurtre, remarqué la présence d’un musulman et qu’elle était passée plusieurs fois devant lui en le dévisageant. Cette ségrégation est difficile à objectiver, mais les acteurs l’avaient tellement intériorisée que pour eux elle relevait de l’évidence. J’ai voulu en rendre compte, car les violences interviennent quand, dans un contexte d’exacerbation de tensions, à l’occasion d’obsèques notamment, des groupes transgressent cette ségrégation tacite en passant d’un quartier à un autre.
Un épisode de ce type, trouvé dans les archives, m’a particulièrement marquée. Il s’agit d’un cortège funèbre pour l’enterrement d’une victime algérienne : il part de la casbah d’Alger et lorsqu’il arrive dans la rue d’Isly, qui mène au centre-ville européen, la situation dégénère. Les commerçants baissent leur rideau de fer. Certains habitants lancent depuis leur fenêtre des pots de fleurs sur les personnes qui accompagnent la défunte vers sa dernière demeure. Les gardiens de la paix tentent de s’interposer et de filtrer le passage, de manière à ce qu’un minimum d’Algériens passe par le secteur européen.
Au-delà des ratonnades à Alger en 1956 et de la société coloniale en Algérie, votre livre est aussi un manifeste « pour un autre récit de la guerre à Alger »…
L’historiographie de l’Algérie est encore cloisonnée : soit on étudie l’histoire de la colonisation et alors on s’intéresse aux catégories de population, à leurs relations et à leurs inégalités ; soit, on étudie la période de la guerre, et alors, souvent, on perd de vue la société algérienne. Pourtant, cette société a continué à exister après 1954. J’ai donc essayé de renouveler cette histoire en montrant la société coloniale en guerre. Je propose ainsi de sortir du face-à-face armée/FLN en introduisant une sorte de tierce partie, à savoir les Français d’Algérie et les groupuscules d’extrême droite pro-Algérie française.
Certaines thématiques évoquées dans votre livre résonnent de manière frappante dans le climat politique actuel.
Effectivement. À chaque fois que j’entends les discours de l’extrême droite aujourd’hui, je pense spontanément à la mouvance Algérie française. Il y a trois points de convergence qui me semblent évidents.
D’abord, la façon dont la dénonciation d’un « grand remplacement » rejoue la hantise d’une submersion démographique par les Algériens, qui était perçue comme une menace pour la suprématie coloniale. Ensuite, l’injonction à l’assimilation. Durant la période de la colonisation, les Algériens étaient de nationalité française, mais n’étaient pas pleinement citoyens. Pour éventuellement le devenir, ils devaient abandonner leur statut personnel musulman, c’est-à-dire renoncer aux coutumes incompatibles avec le Code civil. Le troisième point, c’est la catégorie de musulman justement. J’ai été très étonnée qu’elle ressurgisse, alors que dans les années 1990, lorsque j’ai commencé à travailler sur l’Algérie coloniale, on employait très peu ce terme. Je refusais même de l’utiliser dans mes propres travaux afin de ne pas reproduire le langage colonial, qui était un langage de stigmatisation. Aujourd’hui, sous la pression de l’extrême droite, cette catégorie est couramment employée et même elle a été réappropriée par des victimes du racisme qui revendiquent ainsi une identité discriminée.
C’est pourtant une catégorie que vous utilisez dans votre livre.
Ce livre est le premier dans lequel j’utilise le mot musulman, car je devais rendre compte de la vision du monde des Européens qui ont commis les ratonnades. Ils ne pensent pas attaquer des Algériens, mais des musulmans. J’aurais aimé mettre à chaque fois le mot entre guillemets pour signifier qu’il s’agit de catégories de l’époque, qui relèvent à la fois de l’assignation et de l’auto-identification, mais le texte aurait été illisible. Et puis, il fallait que mon récit corresponde aux catégories de pensée et d’action des acteurs eux-mêmes.
Lorsque je travaillais principalement sur le droit et la justice dans le contexte colonial, je pouvais encore éviter leur usage, mais dès lors que je me suis mise à enquêter sur le racisme colonial, ces catégories sont devenues incontournables…
Pour citer cet article
Adrien Minard et Lisa Vapné, « Entretien avec Sylvie Thénault. Les ratonnades d’Alger en 1956. Un exemple de violence coloniale routinisée », RevueAlarmer, mis en ligne le 14 avril 2022, https://revue.alarmer.org/ratonnades_alger/